- All
- Gallery Filter

Le ciel l'a mauvaise
d’Eléa Marini
Editions de l’Olivier
«Vivre avec un disparu, c’est comme avoir une ombre sur la nuque chaque heure qui passe. Les disparus, ils sont partout, ils sont nulle part. C’est des aiguilles dans un monde entier. Avoir ces ombres dans le dos, ça donne des vies à attendre ».
Les variations de couleurs du ciel, l’impétuosité des éléments climatiques et le chaos qui les accompagnent, apportent une structuration à ce premier roman tout à fait remarquable. Eléa Marini nous met dans les pas de Bo, un jeune d’une douzaine d’années, livré à lui-même, habitué aux absences de sa mère avant que cette dernière ne fasse partie des disparus. Il forme un trio avec le colosse Isaac qui construit sa maison par lui-même et Alma qui travaille dans une cafétéria. Ils ont été contraints de quitter, suite à un ouragan, là où ils habitaient, de tout laisser sur le champ. Cette terre trouée par les mines et dévastée par les grands vents puis par les eaux. « Les vents, quand ils emportent, ils sont coriaces et ils trimballent au large. Les morts, on les compte un peu trop ».
Trois solitudes qui s’attachent petit à petit dans l’exode, ensemble séparément. Trois êtres emplis de fêlures (« fissurés depuis des années »), d’inquiétudes et de démons. On apprend peu à peu, entre les lignes de fuite, les prémisses de ce désastre, de quel passé viennent ces trois-là.
Ils se trouvent reliés par la force des choses, et composent une brinquebalante communauté de fortune.
« Alors quoi maintenant ? L’enfant c’est une chose, mais l’homme ? Elle va devoir vivre près de lui, s’asseoir et dîner en sa compagnie, passer derrière lui aux toilettes, l’entendre tousser, rire, éternuer, respirer, le voir être là ? » Obligés de faire face, « s’apprivoisent à demi », et réinventent dans un appartement miteux une façon bien à eux de faire foyer malgré tout et indépendamment de ce qui caractérise leurs liens.
Bo est tourmenté par l’absence de sa mère, des racines se débattent dans son ventre. Mais il va suivre peu à peu Isaac qui réalise ici ou là des chantiers, quand dans le même temps Alma retrouve un emploi de cuisinière. Ainsi, après la débâcle, une fragile reconstruction semble opérer.
Beaucoup de scènes se passent la nuit, avec tout le trouble qui s’ensuit. Dans ce paysage sombre, apocalyptique, des présences parfois se manifestent, à l’instar d’un chien noir aux yeux jaunes, pareil à celui de Tout l’or des nuits de Gwendoline Soublain ou encore la créature stellaire incarnée par la figure blonde de Willie entourée de son bestiaire.
A la lecture du livre d’Eléa Marini, on pense aussi à la série Treme de David Simon et Eric Overmyer, qui rend compte de la différence de traitement qui font suite à la catastrophe climatique (« Les beaux quartiers sont récurés ! Et pas chez nous, y sont juste venus retirer les ruines »).
Un premier roman dont il faut se saisir. D’une grande justesse.
« Que sont-ils devenus ? Ceux qui tenaient les murs, fabriquaient leur chance dans les sous-sols obscurs, ceux qui arpentaient les rues, se débrouillaient et troquaient, misère contre espoir, à la recherche d’un peu mieux« .

Fragments d'en bas
de Philippe Lubrano Lavadera
Editions de la Lanterne
«C’est drôle, tout le monde a peur des cloches. Comme si c’étaient eux, le danger».
Le milieu du sans-abrisme regorge de rapports en tout genre, les monographies y sont plus rares, et avec ce livre nous découvrons un autre registre encore, quelque chose qui pourrait nous rapprocher de la non-fiction, de la littérature du réel. Pas très étonnant que ce titre soit publié aux éditions de la Lanterne, pour lesquelles « la littérature est un espace de résistance pour des voix singulières qui interrogent le réel, explorent des perspectives collectives, rendent visibles les invisibles ». Avec Fragments d’en bas, nous y sommes en plein.
L’auteur a été travailleur social, dans un foyer de Notre-Dame des Sans-Abris, pas n’importe quel foyer, peut-être celui le plus emblématique d’une époque qui perdure, d’un certain type de public aussi. Le foyer Gabriel Rosset. On y entre par cette porte en fer, écaillée, « jaune piteux », on y retrouve différents espaces, le local qui sert d’accueil de jour, le réfectoire, le dortoir, les lits de repos, plus loin encore mais relevant de la même institution, le bric à brac, et comme un prolongement la Chapelle du Prado.
C’est un centre d’hébergement inconditionnel comme il ne s’en fait plus beaucoup, à bas seuil d’exigence, comme il s’en fait encore moins : « Il pouvait se pointer raide défoncé à minuit, en retard complet pour le couchage, rien à craindre, il ne finirait pas dehors ». Un abri au sein duquel l’essentiel de ces hommes sont depuis plusieurs années et resteront jusqu’à leur mort.
Le livre de Philippe Lubrano Lavadera se décompose en 8 portraits dont celui de l’auteur, Lulu, intervenant social. On y retrouve certaines régularités d’une trajectoire de vie à l’autre, ce sont des hommes avec des parcours heurtés, faits d’infortunes, de ruptures, des corps cabossés. Les beuveries, les règlements de compte et l’auto-exclusion. « Les mecs se tapaient dessus, se réduisaient chaire et miettes, et dormaient dans le même dortoir, quasi dans les mêmes pageots pour certains. Le lendemain, ils éclusaient les mêmes boutanches, même pas sûr qu’ils se rappelaient qu’ils s’étaient cognés la veille ». Les chutes, les rechutes, les hospitalisations, la mort. C’est que les occupants de ce foyer sont là par défaut, faute de place plus adaptée ailleurs. Ils relèveraient certainement d’autres dispositifs comme les appartements de coordination thérapeutique tant ils sont aux prises le plus souvent avec des pathologies chroniques. Les prises en charge et coordination en lien avec les problématiques de santé sont omniprésentes, le prendre soin permanent.
Quinze ans après cette expérience de travailleur social, l’auteur (devenu à présent psychologue) revient dessus, « On n’avait pas le droit de le dire au foyer , notre attachement aux personnes. Pourtant il n’était question que de ça ».
L’auteur nous décrit comme il a envisagé à tâtons la relation d’aide, tout en humilité (à l’instar de ce passage si poignant, avec la reprise de cette phrase « Je ne sais pas les mots qu’il faudrait dire aux enfants des SDF… »). S’organise en acte une forme de clinique de l’éprouvé. Une présence en situation où Lulu s’arme de patience – la progression du pas à pas (« lentement mais sûrement, quasiment main dans la main, nous sommes allés à l’hôpital ») – comment il compose avec les silences (« Le silence, ça peut avoir un profond sens de l’accueil. Ça peut être le nécessaire, la vraie et unique bonne manière de recevoir. Y a des moments, le langage, faut savoir le replier, le taire. Le mien de silence a tenté de lui ouvrir grand les bras ».
Une implication de tous les instants contre la « glu du désespoir », « j’ai mis mon corps, mon être, des paroles, entre ses peurs profondes », au point que le burn-out compassionnel, l’épuisement relationnel guette en permanence. « Il m’a fichu le vertige. J’étais en équilibre sur une frontière qui pouvait, une fois franchie, me faire tomber dans des abîmes que je connaissais trop bien. J’ai senti en moi s’agiter un vieux fond de tristesse douloureuse et je ne voulais pas avoir affaire à elle ».
On est dans le « fond du tragique », dans « le noir du désespoir », et pourtant l’humanité répond à plein d’endroits, les relations d’aide qui sont décrites ici travaillent à bas bruit au maintien de la dignité des personnes accueillies.
L’illustration que l’on retrouve en couverture du livre est signée Benjamin Flao, quelle merveille ! On avait tant apprécié sa dernière BD, L’âge d’eau, on retrouve ici tout son talent.
Un livre au croisement des vécus, qui rend compte du quotidien de ces personnes accueillies. Bien plus qu’une seule collection de témoignages, le livre restitue habilement, à partir du prisme et de la sensibilité de l’intervenant, les itinéraires de vie de ces quelques personnes accompagnées, dépourvues de logement. A lire nécessairement.
« Et puis l’au-delà de la souffrance, c’est quoi ? Un gouffre ? Le néant ? Un chaos dans lequel je n’ai jamais su vraiment voir clair. Toutes nos explications s’épuisent devant une telle détresse, une telle manière de s’amocher et de se foutre en charpie. Et pourtant, il faut tenir. S’entêter autant qu’eux ».
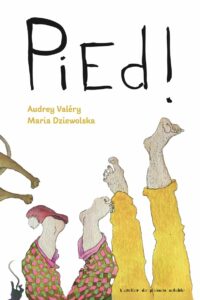
Pied !
Texte d’Audrey Valéry et illustrations de Maria Dziewolska
Editions L’atelier du poisson soluble
Album jeunesse
« Madame Ashim oubliait beaucoup mais il restait l’essentiel : l’amour et leurs mains. »
L’histoire commence lorsque Mme Ashim, un matin ne retrouve plus l’un de ses pieds… Pourtant il est bien au bout de sa jambe mais elle ne semble pas le voir… Cherchant un peu partout, elle finit devant son ordinateur, à chercher « où se cache la nuit, les matins ? ». Quelque chose semble ne plus tout à fait tourner rond. Enfin… disons que « Mme Ashim avait une mémoire trouée » qui pouvait l’amener à mélanger un peu les choses : « elle promenait ses dents, s’asseyait sur son chien, mangeait des chaises et brossait des yaourts à des heures étonnantes. »
Elle essaie bien parfois de « reboutonner sa mémoire »…
Et puis une nuit elle rencontre Basile, chanteur de bar, et tombe amoureuse…
Un album poétique pour parler de la vieillesse et de la maladie d’Alzheimer avec des enfants.
Les illustrations à l’aquarelle amènent drôlerie et féérie. Il y a beaucoup de joie et de légèreté, et c’est une bien belle façon d’évoquer ce sujet !
« Madame Ashim se réveilla, avec l’étrange impression de n’avoir qu’un seul pied. »
- All
- Gallery Filter
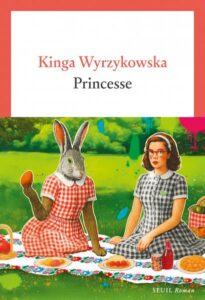
Princesse
de Kinga Wyrzykowska
Editions du Seuil
«C’est plus facile de diriger des marionnettes que des humains. De participer à une farce qu’à une tragédie ».
J’avais particulièrement apprécié le premier roman de l’autrice, Patte blanche. C’est dire la joie de retrouver Kinga Wyrzykowska pour ce second roman, tout aussi irrésistiblement loufoque.
Cette fois-ci on suit Barbara Lis qui est cadre dans l’industrie agro-alimentaire et qui se voit offrir pour son anniversaire un lapin aux mensurations extraordinaires («Avec ses vingt-cinq kilos pour une envergure d’un mètre trente, la bougresse, elle, était du genre encombrant»). Cet être hybride qui a une propension à s’humaniser n’est pas sans nous faire penser à Alistair une chimère homme-chien tout droit sortie de l’imagination d’Emmanuelle Pireyre (in Chimère, éditions de l’olivier). La promesse inaugurale de confusions animales des plus cocasses et de quelques étonnements quand il s’agit de promener l’animal dans « un gros landeaux miteux ».
Barbara va faire connaissance d’un plombier polonais, ce qui va l’entrainer à aller habiter au fin fond de la Pologne. Ces deux là n’arrivent pas à avoir d’enfants, et c’est un drame. C’est d’autant plus un drame qu’ils évoluent dans un coin où règnent de fervents catholiques, ceux là mêmes qui mènent des croisades contre l’avortement. Cela se ressent avec beaucoup d’acuité dans les différents suivis médicaux et autres accompagnements proposés au couple, à commencer par les recommandations du Père Gabriel et Natalka leur voisine « conservatrice de l’âme». A bien des égards on se retrouve ici dans une ambiance qui pourrait se rapprocher d’un des livres cultes de John Irving, L’oeuvre de Dieu, la part du diable, ou encore par la dimension freak des personnages et des soulèvements qui s’ensuivent à l’univers littéraire d’Emmanuelle Bayamack-Tam. Mais la farce prend un tour supplémentaire et confine au sublime quand finalement Barbara, devenue iconique, est qualifiée de « nouvelle Princesse du Ciel » ayant fini par accoucher de « sept enfants de nature inconnue ». Et pour que l’ensemble devienne plus déjanté encore, l’autrice fait intervenir vers la fin du récit Donald Trump, ou encore Cyril Hanouna, participant à une totale hystérisation de l’histoire.
C’est certainement l’un des romans de cette dite « petite » rentrée littéraire les plus délicieusement barrés, des plus dérangeants. Le tout servi par une écriture ouvragée. Tout à fait décapant. On en redemande !
«Elle avait quelque chose d’animal, elle ne s’apprivoisait pas facilement. Ça lui ressemble, d’une certaine façon, de mettre au monde de animaux».
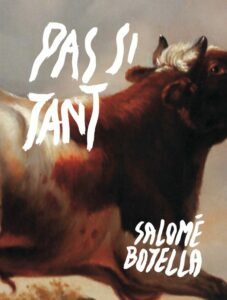
Pas si tant
de Salomé Botella
Editions de L’Ogre
« J’ai longtemps haï ce trou,
Aujourd’hui je ne pense qu’à m’y enterrer »
Salomé Botella nous propose, à travers ce premier roman, de remonter le fil de quelques souvenirs flash qui viennent marquer sa jeune existence, et de caractériser les lieux où elle a habité plus jeune. Au fin fond de la Creuse, dans le hameau de La Vergne, appartenant à la commune de Janaillat (« un endroit où Google Earth n’est jamais allé »). C’est que l’enracinement de son enfance s’est fait sur ces terres-là, dans cette vieille baraque aux murs froids, avec ce voisinage et cette famille (Mamie Marie-Laure, sa mère Hélène, ses frères Titouan, Marius et Eliott…), l’adelphité s’est fortifiée dans cette chambre partagée sous les combes («Sous ce toit on s’apprécie sûrement, mais ça reste à prouver»). L’adolescence aussi est présente, et avec elle les expériences des premières fois (« la première peau qu’on presse contre la sienne »).
La forme brève que Salomé Botella investit à merveille fait la part belle aux images qui viennent fixer une période (l’autrice retrace aussi les odeurs (« les odeurs de clopes et de fosses septiques remontent »), les bruits (« les enduros hurlent à l’horizon ») – les objets et les gestes ne sont pas en reste à l’instar de ce tracteur (« quand on le conduit on dirait que le volant tourne pas vraiment les roues »), qui rendent compte du milieu rural tel qu’il a été vécu, de ces activités à hauteur d’enfants qu’elle a eues pour tuer l’ennui, de ces petites humiliations qui restent une fois qu’elle a grandi. L’autrice précise comment le milieu nous influence : «on se fait un peu apprivoiser sans s’en rendre compte». De la même façon, elle témoigne de l’action certaine qu’a le temps sur les gens et sur les lieux (« les bâtiments présentaient des signes de fatigue similaires ; Les établissements faiblissaient comme le moral ou les articulations »).
Aux façons d’être et de faire situées répondent les façons de dire non moins situées, à ces dernières Salomé Botella consacre une postface des plus intéressantes. «Ce lien entre la langue, les usages et les lieux donne des potentialités d’interprétations multiples». Et c’est ainsi, en puisant dans certaine forme d’oralité que l’autrice arrive à façonner une écriture pleinement en phase avec son sujet.
Un hommage vibrant à ce milieu rural, qui transcende le simple témoignage, et qui reste souvent peu raconté par cette génération et qui à travers ce type de récit en actualise les représentations.
«Les gens et les lieux se muaient en une chose
Laissant place aux souvenirs
Parfois, ces souvenirs mentent,
Car on apprend bien à le faire»
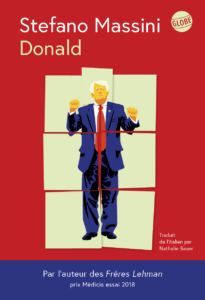
Donald
de Stefano Massini
traduit de l’italien par Nathalie Bauer
Editions du Globe
« Je déposerai
Comme marque commerciale
Non seulement mon nom
Mais aussi mon visage
Mon corps
Ma vie
Dans tous ses replis »
Il y avait eu Les frères Lehman, puis Manhattan Project. Et maintenant Donald. Trois romans en vers libres reprenant des événements marquant de la folie du monde.
Stefano Massini sait manier les mots pour qu’ils viennent nous percuter, à multiples reprises, comme des salves, ou des refrains, pour s’assurer que notre rétine se soit bien imprégnée de formulations qui vont ensuite marquer notre esprit. Ainsi, couche après couche, le paysage se dessine, les faits s’ancrent (et s’encrent) et restent en tête, comme des ritournelles (vous savez, celles qui peuvent même nous agacer car nous n’arrivons pas à nous en débarrasser). Ainsi, en refermant le livre, c’est sûr, il vous restera un peu de Donald, et cela vous agacera !
Mais de quoi nous parle précisément Stefano Massini dans Donald ? De ce chef d’Etat en devenir, bien avant sa première investiture car tant de choses se sont déjà jouées– peut-être tout ce qui explique tout ce qui fait ce qu’il est, comme il est à présent. Ces 10 minutes cumulées, « ces instants infimes fondamentaux où se produit quelque chose où l’on devine quelque chose où l’on comprend quelque chose où l’on prend une décision ». Sa naissance dans une villa de Wareham Place, d’une mère venue de l’île de Lewis et d’un père venu d’Allemagne et se faisant passer pour un Suédois, mais « il suffit de ne pas l’ébruiter ». Ses premières tentatives de roublardise et de défiance de l’ordre établi (avec une petite histoire de billet de 10 dollars en cours de récréation « un petit et banal incident d’une durée d’une minute tout au plus »). Les 1200 appartements trois pièces de Cincinnati dont « golden boy en ferait un endroit de rêve il le voyait déjà où tout le monde tous les propriétaires de portefeuilles bien gonflés il les voyait déjà rivaliseraient pour s’installer ! ». L’accusation fédérale pour discrimination raciale qui lui fait rencontrer Roy Cohn et sa seule règle « l’attaque est la seule défense possible l’attaque est la seule règle possible ». Son installation tout en haut de sa tour de la Fifth Avenue (« à partir de ce soir le roi Donald 1er habite là-haut, à 202 mètres de hauteur »). Ou encore le crash de l’hélicoptère dans lequel il devait monter en 1989, « cet hélicoptère de location doté d’un défaut de fabrication latent qui lui aurait garanti une mort certaine ».
On oscille entre envie de rire et sensation grinçante et glaciale. Car ce portrait est tout autant celui d’un homme que d’une époque qui a rendu possible son avènement.
Presqu’une fable, sans morale aucune.
« Moi
Je serai le show
Vous
Vous serez le public »
- All
- Gallery Filter

Sang chaud
de Fanny Lallart
RAG éditions
«J’ai l’impression qu’en ce moment, s’aimer consiste à se demander très souvent si ça va ».
Ecrire depuis les marges, voilà ce qui mobilise puissamment Fanny Lallart à partir de la maison d’édition Burn-Août qu’elle codirige. Sans chaud est fait de ce bois-là. Le livre est constitué de plusieurs textes écrits entre 2019 et 2025. Il mêle témoignage (« j’écris des situations que j’ai vécues et je vis des situations pour les écrire »), fiction, essai, échanges entre potes, poésie (une poésie qui essaie de faire des sutures), un texte fait de formes courtes, écrites quand l’autrice n’était pas mobilisée pour gagner sa vie. Et c’est aussi ces autres lieux, notamment ceux du travail qui font la force de ce récit de rageuse. C’est qu’en faisant le nettoyage lors de la fashion week ou lors d’un mariage dans un grand domaine, elle côtoie des « bourges ». Et parmi ces autres lieux, il y a ceux de l’intimité, du sexe, de l’amitié et de la famille. Ils offrent autant de contre-champs au récit, et l’autrice fait de ces petits espaces protecteurs autant d’antidotes pour rendre le monde plus habitable. Pareils à ces petites boites d’histoires familiales au fond des armoires qu’évoquent l’autrice, «les boites sont rarement sorties, rarement ouvertes, mais elles sont là, garantes de quelque chose ».
Fanny Lallart documente ce que notre époque nous fait, produit en terme de fatigue, d’épuisement. Peut-être pas innocent que sa maison d’édition puisse s’appeler Burn-Août. Il y a des très belles pages sur la fatigue, la «panique abyssale », l’éco-anxiété, ce dont notre société pré-fasciste s’est faite grande productrice. Fatigue qui laisse trop souvent la place au silence, « le silence propre à l’épuisement, le silence propre à la sidération ». «S’intéresser aux conditions d’énonciation de nos subjectivités signifie réfléchir à ce que nous ne pouvons pas dire, à ce que nous disons à moitié et à ce que nous disons qui n’est pas entendu ». Ces silences et silenciations à partir desquels l’éveil se travaille, l’écriture se tisse.
Et très vite se pose la question de à qui doit-on cet état de fatigue quasi permanent ? Et l’on se retrouve là vers cette vertigineuse montée en imputabilité, un peu comme Edouard Louis écrivant « Qui a tué mon père ? » et qui désigne Martin Hirsch comme responsable. «Tous les jours, faisons l’exercice de nommer nos ennemis pour se rappeler que des corps incarnent les décisions ».
Cet écrit puissant nous fait penser à Dirty week-end d’Hélène Zahavi (ed. Libretto) -livre d’ailleurs cité dans le texte de Fanny Lallart- mais aussi au texte La fin des coquillettes de Klaire fait Grr (Binge Audio Eds), on aime aussi les références marquées à Adrienne Rich, Sara Ahmed, Audre Lorde et Dorothy Allison, c’est explosif et on aime cette intensité-là. Autant de filiations sur lesquelles l’autrice s’est construite qui viennent se conjuguer aux apports familiaux. Fanny Allart écrit un passage très sensible sur ce qu’elle a hérité ou non de ses parents, à commencer par leurs ressemblances physiques «Comme elle, j’ai un reste de rancoeur entre les omoplates, de la colère dans la machoire (…) Nous voyons dans le visage de chacunes, le reflet de ce que nous n’arrivons pas à ne pas être ». Cet inventaire mêlé aux souvenirs d’enfance permet à l’autrice de sonder d’où procède ce sang chaud.
L’autrice examine tour à tour les tactiques employées pour tenir, « se faire tenir » : ici les moments de dissociation (« quand je travaille pour Chanel pendant les révoltes ») là une langue différente de la langue hégémonique, une langue gorgée de x, les rêves qu’on fait et les histoire qu’on se raconte, l’écriture sur la vengeance («Ecrire la vengeance, au-delà d’être un processus de mise en mot des fantasmes, est une forme de résolution possible de la frustration »). Le tout avec du gros son made by SCH.
Un texte d’une grande sincérité, garanti cent pour cent anticapitaliste, qui revendique à la fois une rage nécessaire, chevillée au corps, et qui réussit à rendre résolument politique la réappropriation de nos récits personnels.
«On essaye de reprendre le contrôle de nos propres sorts en inventant d’autres langues ».

Elever
d’Elsa Sanial
Editions Sahus Sahus
«J’essaie de devenir bête au contact des animaux
Débarrassée de la mission de transformer le
monde, débarrassée de la recherche de
performance, débarrassée de la compétition
et de la réussite
Je peux m’abêtir».
A hauteur de brebis, Elsa Sanial nous livre un récit quasi ethnographique de sa pratique d’éleveuse. Que cela soit dans le ton ou le recours au vers libre et au jargon du milieu (le glossaire est fort utile), mais aussi dans le défilement des saisons, l’on peut se sentir proche du recueil qu’on avait tant aimé d’Anouk Lejczyk, Copeau de bois (édition du Panseur).
Elsa Sanial nous documente son environnement, sa pratique, d’une prose résolue. Résolus comme le sont chaque éclat, chaque retour à la ligne. C’est que de détermination l’autrice-éleveuse n’en manque pas. C’est d’ailleurs certainement l’intensité de sa pratique d’éleveuse, parfaitement retraduite dans son geste d’écriture qui rend le tout d’une grande puissance. L’autrice nous rend compte de sa trajectoire de chercheuse à consultante, et de son retour à la terre, de retour dans la ferme de son grand-père aux Fayes, en Haute-Loire, du côté du plateau du Mézenc. Son choix d’être paysanne. Sauf que l’intellect n’est pas mis en jachère, de partout émergent des considérations fortifiées par une réflexivité de tous les instants. «J’ai cherché une paysannerie émancipée Mais je n’ai trouvé que des trajectoires projetées à vive allure dans le mur mondialisé – Mon travail, recoller les miettes». L’autrice relie sans cesse ce qu’elle pratique en plein air et dans quel cadre réglementaire cela se traduit, la Politique Agricole Commune et toute la galaxie des sigles garants de la sur-administration (ZDH, PDO, DPB, SST, IAE, BCAE, SAU, UGB…). Entre approche critique et fatalité, «On se fait croire, entre éleveurs, qu’il faudrait produire avec performance pour s’en sortir. Mais ce sont principalement les subventions qui nous font vivre. Quelles que soient nos pratiques ».
Elsa Sanial nous décrit en acte son travail, dans ses routines mais aussi dans ce qu’il fait au corps : ainsi les douleurs sourdes ; «Mon corps intellectuel jeté en pâture aux gestes routiniers qui viennent poncer lentement mon squelette ». ; ou lors de l’agnelage, «quand les contractions viennent je les ressens jusque dans mon utérus ». Et sans ambage, pour sortir de la carte postale pittoresque, l’autrice faisant face à «cette société malade de la mort » de revenir ainsi sur ce qui fait partie aussi du métier d’éleveuse, faire du tri, castrer, frapper des crânes pour ôter la vie sans souffrance. Elle nous partage quelques observations de terrain qui font partie intégrante de son quotidien : déceler ici une nouvelle espèce fourragère, prendre la mesure de la taille d’une flaque, voir un nouveau terrier, appréhender la maturation de l’herbe. Une disponibilité et une attention permanente, une complicité de tous les instants : « Les gratter aux endroits inaccessibles pour une corne ou un sabot. Notre lien se tisse dans l’intimité de telles relations » ; «Front contre truffe, flancs frottant mes mollets, Ongles dans la laine, Visage niché dans la toison, Nos corps sont toujours en contact ».
Dans cette immersion sensible, Elsa Sanial nous rappelle, à l’instar de ce que Marion Fayolle avait également suggéré dans Du même bois, que nos vies s’entrelacent profondément avec celles des bêtes, dans le partage des gestes et des saisons. C’est aussi au travers de « nos vies façonnées par les bêtes », que l’on découvre une autre manière d’être et de penser le monde, architecturée par ce lien vivant et essentiel.
Un petit livre à acheter (idéal pour votre futur secret santa) puis à faire circuler sans modération.
«Qui sont ces femmes sans enfants
accompagnant toutes ces naissances ?
(…)
Qui sont donc ces femmes sans enfants qui
donnent sans cesse la mort ? »
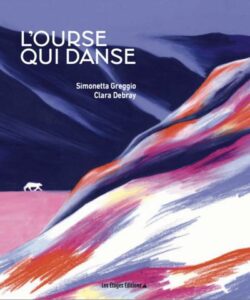
L'ourse qui danse
texte de Simonetta Greggio et illustrations de Clara Debray
Editions Les Etages
« S’il m’a fallu tout ce temps pour commencer à savoir qui j’étais, je n’avais pas encore choisi qui je voulais être totalement. »
Au départ, il y a une commande du musée Confluence de Lyon à Simonetta Greggio. Il y a quelques objets venus du Grand Nord et ayant appartenu à des Inuits. Il y a une statuette d’une ourse qui danse.
A partir de ces éléments, Simonetta Greggio a écrit un conte initiatique, écologique et documentaire, qui peut, comme tout conte, être lu à plusieurs moments de sa vie, et ce dès une dizaine d’années.
Il s’agit de l’histoire d’un Homme. D’ailleurs l’histoire commence ainsi « Je suis un Homme. » Un Homme Inuit, qui nous raconte sa vie entre deux mondes : celui des kabloonaks, les blancs (où il a grandi une partie de son enfance et est devenu professeur), et le monde des Inuits (nous ne saurons pas le nom de son village, « il est imprononçable pour vos bouches et vos langues, vous ne le retiendriez pas »).
C’est l’histoire d’un Homme, mais aussi l’histoire d’un monde qui se meurt, que les blancs ont malmené en important notamment de l’alcool, en enlevant des enfants à leurs familles, en voulant s’accaparer des terres pour leurs richesses sans penser aux dégâts qu’ils causaient.
C’est aussi l’histoire d’un Homme et de sa rencontre avec une ourse. Une relation qui commence par une lutte presqu’à mort, qui se poursuit par une lutte commune pour survivre, qui continue par une renaissance de l’Homme.
Au départ, il y a donc ce texte publié en 2020 aux éditions Cambourakis.
Et puis, quelques années après, il y a la rencontre entre ce texte et Clara Debray. L’histoire prend alors vie sous les traits de craie grasse de la dessinatrice. Les aurores boréales apparaissent, le froid glacial devient palpable, les morceaux de viande chassée prennent de la consistance – on sentirait presque la chaleur du sang qui dégouline, l’immensité des paysages s’offre à nous. L’ourse est là, menaçante et protectrice.
La sensibilité du texte est démultipliée par ces pleines pages en couleurs.
On ressort de cette lecture chamboulé.e, et si comme moi votre première lecture s’est plus concentrée sur le texte, vous aurez l’envie de rouvrir le livre cette fois-ci pour savourer toutes les nuances et subtilités des dessins et revivre ainsi l’histoire de cet Homme, qui est un peu la nôtre aussi.
« Cette histoire est la vôtre, aussi. Comme dans un miroir. Reflétée. »
- All
- Gallery Filter

Filles de vous
de Z. Hernandez
Co-éditions Terrasses et Le Sabot
«Mon nom est un concentré de départs, de haines, de guerres civiles et de fantômes ».
Et si l’histoire, celle qui prend un grand H, ne correspondait pas toujours, tel qu’on l’apprend, à celle qu’ont vécu les nôtres. Comment faire dégorger l’histoire familiale en remontant sur cinq générations, la faire parler mais autrement ? Pour ne plus continuer à « tenir-silence », à « ressasser les dépouilles », et s’il fallait recourir à une forme d’autofiction pour repriser les mémoires et contrecarrer les récits de cette grande Histoire ?
La narratrice Alma, qui est en classe prépa, «petite-fille de l’exil », porte un nom chargé d’histoires, de plein d’histoires, des histoires qui se chevauchent. Mise en abime insoutenable : « Tout est mélangé (…) en un seul paquet » ; « je secoue les dates pour tisser de longues lignes-parallèles ». A la croisée de territoires et d’époques plus ou moins lointains, depuis le départ d’Alicante en 1939 en passant par l’Algérie et jusqu’au présent de l’agglomération lyonnaise (avec de magnifiques descriptions du milieu urbain). Et ce jour d’Automne 2016, la narratrice est dévastée par l’annonce de la mort d’un très proche par pendaison. « Je te mélange à ma famille, prends des heures dans les archives, pour racler une guerre qui n’est pas la mienne, je compare les horreurs pour avoir l’impression de raconter ».
Elle pourrait feindre d’être dépassée par tout ça, mais ça la rattrape. Dans la langue de Z. Hernandez récit intime et mémoire collective sont savamment intriquées. «Je n’avais pas parié que ton vide prenne autant de matière» ; «La guerre d’Algérie bouffe ma réalité jour après jour». Ça imprime dans le corps, «La nuit, j’insomniaque, le jour j’effroie», « l’anxiété s’est logée dans mes recoins et me tient compagnie. Mon corps prend de l’ampleur pour loger mes délires ». «Immigré[e] de famille », elle a comme un besoin irrépressible de retrouver un sens dans cette famille de déracinés, une inscription dans la communauté des femmes que composent sa famille : Dolores, Carmen, Lucia, Gloria, Inès, autant de « femmes-montagnes », « femmes-valises », « femme-courage », « femme-bataille »… «Il me reste la vie pour raconter les femmes ». Ce récit est d’abord et avant tout celui des femmes qui ont accompagné les hommes soldats. «Fille des femmes de nous. Je suis petite-fille et fille de femmes de nous».
A l’appui d’archives de l’INA, en reprenant des souvenirs racontés, en pistant les photos ramenées, c’est tout un montage qui opère au service d’une narration qui embrasse plusieurs théâtres d’action. Avec une répétition confondante des mêmes mécanismes à l’oeuvre, de la prédation, de la domination, de la violence, du colonialisme, des guerres. Des « hommes-imbéciles ». « Prendre une terre ou prendre un corps, prendre une terre et en prendre les corps (…) Dans toutes les guerres sur tous les fronts, les hommes-soldats, frustration et petit-pouvoir, chair-à-rien, c’est tout ce qui leu reste » ; «Il n’y a que des hommes en travers de tout ça, qu’ils portent toutes les violences et me dégoûtent ».
Alors Alma se déchaine, se rebelle « en manif, je casse, brûle, démonte », généalogie d’une rage tapie en soi. Mais la lutte est aussi sur le terrain symbolique et l’écriture semble participer d’un recommencement possible : «Je commence à t’écrire, à te lire, à te dire. Je te sépare de moi pour te donner en image. Dans ce texte où il n’y a que des trous noirs, je prétends commencer quelque chose ». Comme pour mieux faire face aux « émeutes de nos souvenirs ».
Quelle merveille que cette autofiction historique ! Zoé Hernandez frappe, fort très fort pour ce premier roman.
«Il faut remplir le temps pour ne pas laisser surgir la mémoire»

Comme un malpropre
de Richard Gaitet
Editions Esquif
«La saleté peut être excitante mais son éradication est un plaisir encore supérieur».
Quand dans le monde anglo-saxon, les short stories et leurs nouveaux avatars appelés flash fiction ou micro fiction n’en finissent pas de trouver de nouveaux adeptes, le genre littéraire que constitue les nouvelles n’a semble-t-il pas encore trouvé grâce en France, allez savoir pourquoi. Le format nouvelles /novellas pourrait pourtant tout à fait coller à l’air du temps, ces textes resserrés requièrent un temps de lecture plutôt court. Il est donc quelque peu audacieux que de lancer une maison d’édition autour de récits courts. Mais peut-être que du moment où l’on ne prononce pas le mot « nouvelles », l’honneur est sauf et l’on préserve ainsi toutes ses chances… Comme le nom de la maison d’édition l’indique, l’embarcation est peut-être fragile, mais elle est pourtant prometteuse, en atteste les deux premiers opus que nous avions lus avec plaisir, Mona d’Aurélie Champagne et Rumba Mariachi de Fabrice Caro. Comme un malpropre ne déroge pas à nos premiers enthousiasmes.
On suit Gary qui pourrait avoir quelques ressemblances troublantes avec l’auteur, et Rita son amoureuse. On suit surtout Gary, pas à pas, en train de faire le ménage de son petit deux-pièces. Et force est de constater que ce dernier ne semble pas très à l’aise en terrain ménager. Alors, et parce que ce n’est vraiment pas souvent («il pense encore à sa mère qui accomplit ces gestes une fois par semaine depuis quarante-huit ans»), il s’y emploie. Vinaigre blanc, savon noir et « aspirateur home master » sont de sortie. Pendant deux jours de nettoyage intensif, tout y passe, miroir dégraissé, radiateur dépoussiéré, frigo décapé, secrétaire nettoyé, carreaux lavés, cuisinière astiquée, bonde vidée, rideau changé, tapis remplacé, tri de vêtements et de médicaments. Ainsi, une fois n’est pas coutume, Gary endosse les habits du «fêlé du logis» ; «Gary gante, gratte, décape comme s’il avait la mort aux trousses»; «A genoux, Gary récure sa réticence morbide à entretenir son intérieur, centimètre par centimètre».
Dans l’attente du retour de l’être aimée qui s’est absentée quelques jours, le grand nettoyage est le prélude à une réflexion sur nos intérieurs : de quoi sont-ils faits, de quelle accumulation sont-ils constitués ? C’est que les idées fusent quand on brique et certaines prises de conscience adviennent : Gary réalise que les surfaces ne restent pas intactes, qu’il convient de re-faire, de re-passer, de re-nettoyer. De même, à la lumière des quelques dépôts et autres résidus tenaces qui se seraient ici ou là incrustés avec le temps, défile en creux tout au long de ce remue-ménage, une sorte d’autoportrait sans complaisance, le narrateur réalise combien il peut-être gauche quand il s’agit de se rendre utile auprès d’amis lors de la préparation d’un repas, s’interroge sur ce qui a bien pu « bugger » dans son éducation pour qu’il devienne ce « malpropre » alors même que son frère Federico semble moins renâcler aux taches ménagères. Et de s’adresser à sa mère «Pourquoi tu ne m’as jamais appris à cuisiner ou à faire le ménage ou à ranger ma chambre ? Pourquoi Papa il fout rien à la maison à part le barbecue, les impôts les papiers les factures la voiture et tondre la pelouse ? Pourquoi il sait jamais où sont ses vêtements ? Pourquoi tu refuses toujours qu’on débarrasse la table ? Pourquoi Papa continue de montrer que c’est un effort pour lui de mettre son assiette dans l’évier ou de tendre le bras pour attraper le vin ou la moutarde ? Pourquoi tu m’as jamais appris à repasser, à coudre, à lancer une lessive, à plier mon linge, à faire mon lit, la poussière, les courses, les légumes, à découper les légumes en dés, à mettre de la crème sur ma peau, à soigner mes bobos, à préparer un gâteau, à suivre ta recette des oeufs à la neige ? (…) Pourquoi n’ai-je rien appris par moi-même ? ».
Ainsi, Richard Gaitet sait à merveille peupler les recoins de son intérieur de pourquoi saisissants. Sans ménagement, il insiste et appuie là où ça fait mal, là où beaucoup de poussières se sont accumulées, dans les points aveugles de notre éducation. Et l’on est pris, à notre tour, d’élan pour faire un grand ménage. «Homme sweet homme ».
«Ce ménage pour devenir un mâle propre il l’a fait pour lui, en pensant à elle ; c’est elle qu’il faut remercier».
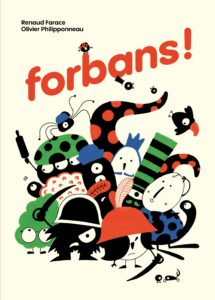
Forbans !
De Renaud Farace et Olivier Philipponneau
Editions 3 Oeil
BD tout public
« Et surtout n’oublie pas : de la précision, de l’émotion, de l’épique ! Un bon capitaine, c’est d’abord un bon journal de bord ! «
Dans un bel écrin à la reliure suisse, Olivier Philipponneau et Renaud Farace nous offrent tout à la fois une aventure humoristique en dix chapitres, une expérience linguistique loufoque avec des trouvailles lexicales surprenantes et amusantes, et une exploration artistique déjantée avec une identité visuelle forte due à des choix de bichromies vitaminées et un graphisme presqu’enfantin et efficace.
On retrouve les classiques des histoires de pirates : un capitaine crochet à l’œil bandé, des batailles, des canons, une quête d’un trésor sur une île mystérieuse, des rencontres inquiétantes (mais surtout très drôles !), des rebondissements.
C’est aussi une galerie de personnages aux noms bien choisis et d’animots-valises (contrainte tirée de l’OuLiPo et l’OuBaPo – ouvroir de Bande dessinée Potentiel) que vous retrouverez tous à la fin, tel un bestiaire. Parmi les pirates et nobles, nous avons entre autres Barack Ouda, O’Polnorth, Norbert du Nordest et O’Hisseyhow. Et Barbe-en-Tas, le père d’Eric : capitaine crochet dont on aime particulièrement ses trouvailles langagières à la pelle (« c’est pas aujourd’hui que ces maudits broute-gazons enverront les gars de barbe-en-Tas bouffer le plancton !», « par les hémorroïdes de mon beau-frère cul-de-jatte, rends–toi ! », « cette fois Comte, c’est la goutte de sang qui fait déborder le vase ! »…)
Chez les habitants de l’ile Gekoko, il y a par exemple Kot Kostar, Kot Kotontige, Kot Kokyette ou Kot Kokpit.
Et voici quelques animots-valises : l’anguillement, l’origamygale, le moustictacboum, le baobaborhum, la fourmicro-onde ou encore l’anacondaltonien. Il ne reste plus qu’à en imaginer soi-même de nouveaux !
Le rythme est effréné et pourrait presque fatiguer. C’est un rythme en fait qui convient sans doute mieux aux plus jeunes ; donc, un conseil, si vous ne vous considérez pas tout à fait comme faisant partie de ces « plus jeunes » lisez- le en plusieurs fois pour savourer sa drôlerie et son foisonnement d’idées à la page.
Derrière ce feu d’artifice de couleurs (1 par chapitre, à l’exception du chapitre 8 multicolore dans le ventre de l’anacondaltonien), d’événements, de jeux de mots et de rires, il y a aussi la recherche de la construction de soi et de l’émancipation. Car tout commence par un mariage entre Eric, mi-noble mi-pirate qui se verrait bien avoir une petite vie tranquille, et Eléonore du Nordouest jeune noble qui se révèle une véritable aventurière.
Enfin, une spéciale dédicace aux anguillemets qui éclatent les philactères et rendent les personnages inaudibles (belle trouvaille !).
Les auteurs nous offrent une expérience loufoque et rythmée qui permet, en fonction de son âge, de le lire et relire en y découvrant de nouveaux jeux de mots et références.
« Dimanche 11 novembre, 6h66, l’océan Pantouflard se déchaine, on ose s’attaquer à mon navire la Rage des Dents d’la mer ! »
- All
- Gallery Filter
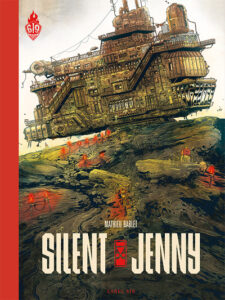
Silent Jenny
de Mathieu Bablet
Editions Label 619
BD
« Rappelons-nous de ce moment, si on a eu le désir de faire société différemment, si on a quitté les villes et Pyrrhocorp, c’est pour retrouver cette force de vie et de jouissance qui avait fini par nous abandonner. »
Après Carbone et Silicium, Mathieu Bablet revient avec Silent Jenny, une BD de 300 pages qu’il a mis 4 ans à créer, dessiner, écrire, on pourrait dire réaliser tellement le style est cinématographique. C’est son 3ème opus de science-fiction.
Dans un monde post-apocalyptique, aride et dévasté, sans végétation ni insecte pollinisateur, une partie de la population a décidé de sortir des villes et d’imaginer d’autres manières de faire société. Ils ont confectionné des monades, sortes de vaisseaux-villages à la manière du château ambulant de Miyazaki, qui ont comme règle de ne jamais s’arrêter. On suit plus précisément le Cherche-midi et sur cette énorme embarcation faite de métal et de pièces recyclées, plus précisément encore Jenny.
Jenny est une femme assez seule et silencieuse, qui a à la fois du mal à se lier aux autres (elle mange seule dans sa cabine, semble même fuir le contact d’autres femmes qui pourtant prennent soin d’elle) et à s’en séparer (comme lorsque sa grand-mère choisit l’euthanasie). Elle est portée par l’espoir qu’un jour le monde sera de nouveau pollinisé et permettra une vie meilleure, et en même temps, la dépression semble aussi très présente (avec des visions de l’incarnation de la mort assez régulières).
Mathieu Bablet crée ici un monde extrêmement détaillé et précis. Les couleurs, souvent dans les teintes brunes, et les effets de lumière rendent l’atmosphère chargée, lourde, presque suffocante. Le ciel est presque toujours blafard. L’aspect minéral et métallique est particulièrement bien rendu, dans la minutie du dessin. Certaines doubles-pages nous apportent également une vue cartographique et topographique (ce sont des pages du carnet de bord de Jenny).
On découvre aussi au fil de la lecture l’organisation complexe et codifiée des différents mondes qui se côtoient : celle de chaque monade (véritables petits biotopes), celle des manges-cailloux (tribus errantes), celle de la ville (avec son administration très stratifiée et bourrée de formulaires à remplir et de procédures à suivre).
Et dans ce monde où l’insouciance a disparu, il y a Jenny qui remplit avec zèle et ténacité sa mission : explorer chaque parcelle pour y retrouver des traces d’ADN d’abeille. Pour cela, un dispositif la miniaturise à une taille (de plus en plus) microscopique, non sans risque de calcification. Cela ressemble à une descente dans des profondeurs abyssales. Ici la contemplation des images prend du temps, tellement elles sont foisonnantes. Comme Jenny, on pourrait quelque peu s’y perdre, dans un temps suspendu. Un conseil, soyez à la lumière du jour pour profiter pleinement de tous les détails et jeux de couleurs.
La présentation serait incomplète si on ne parlait pas du rapport aux corps : abimés, comme en mutation ou décomposition, et pourtant d’une certaine beauté.
Vous l’aurez compris, il s’agit d’une lecture exigeante et passionnante à la fois, qui peut s’accompagner du vinyle Inframonde, bande-son de la BD composée par The Tonic Avenger.
« Les autres ont compris, pourquoi pas toi, Jenny ? Pourquoi tu es incapable de laisser le temps faire son œuvre ? »

Lapiaz
de Maryse Vuillermet
éditions du Rouergue
roman noir
« Oui, je suis inquiet, je guette, je surveille mais ça sert à rien, je sais pas d’où ça va arriver, mais ça va arriver, je le sens, un jour ou l’autre, un orage, un court-circuit, un incendie, et tout brûle ».
Le Haut-Jura, ses plateaux calcaires, ses combes, ses biefs, ses gouillats, ses chemins en terriné. Ses bourrasques et ses congères, «un temps à se perdre». Ses lapiaz. On y est. Au bout du bout du monde. Un paysage impressionnant à couper le souffle. Un paysage qui fait corps, qui fait mémoire «Les falaises, pour moi, c’est comme des histoires qui s’empilent, du temps qui se calcifie, qui s’infiltre dans les roches et se tient immobile ou comme des lignes au crayon noir sur du papier blanc. Toutes plissées, entaillées, fendues, mais droites, verticales, rudes, elles tiennent, contre vents et marées, solides, comme nous, oui, on s’accroche, on tient ».
Et là, avec un kilomètre de falaises de chaque côté, un pâté de maisons isolées, encaissées. En son cœur, le couple Satin, agriculteurs à la retraite, et tout contre, leur fils Bernard qui possède une petite entreprise de débardage et qui est désigné pour reprendre l’exploitation, avec sa femme Arlette et leur petit Paul, et un peu plus loin une ferme d’estive. Le décor est planté, sculpté par cette surface calcaire, ne reste plus qu’à y faire vivre une poignée de personnes au rythme de cette nature minérale et âpre. Peut-être même hostile, «le paysage s’est refermé autour d’elle, les chemins sont envahis par les orties, la vue, bouchée par ses angoisses, les vipères et les abeilles toujours plus menaçantes». La puissance d’évocation des lieux parle déjà.
Très vite, dans ce roman noir que nous propose Maryse Vuillermet, les gens du coin («pour vivre ici, il faut y être nés»), les Satin, voient apparaître un jeune couple, Isabelle et Tony, très vite désignés comme étant des hippies, qui viennent assouvir leur rêve de vie sauvage. Les uns jaugent les autres et réciproquement, «ça fait des sujets de conversation». Et le cycle commence : attraction, répulsion, indifférence, selon les personnes. Le plus enthousiaste vis-à-vis de ces nouveaux venus c’est, à n’en point douter, le père Satin. Le plus réfractaire est son fils Bernard, au rire goguenard. Du côté du jeune couple, le plus avenant et curieux c’est Tony, toujours fourré chez ses voisins d’en-dessous, Isabelle plus réfractaire au contact et apeurée par les vipères.
On retrouve très vite tous les ingrédients qui structurent le jeu du voisinage dans ce type de situation, le « nous » des « autochtones » («il n’y a pas d’inconnu, ici, on tombe toujours sur les mêmes ») versus le « eux » des « néo-ruraux », des « étrangers », des « ratraits » (terme jurassien pour désigner une pièce rapportée). Difficile ainsi de s’intégrer : «Quand est-ce qu’ils seraient des leurs, à leur place ? »
Il peut dès lors se passer quelque chose à tout moment, on le sent, on le pressent. D’autant qu’une présence interlope semble rodée, Isabelle aperçoit « une silhouette qui apparaît et disparaît quand [elle] passe ». L’hiver s’enlise et ne devient pas « artiste de la solitude » qui veut.
Maryse Vuillermet excelle dans l’art d’instiller un climat d’inquiétude qui monte crescendo, assorti à une ambiance trouble parfois de connivence parfois pesante, parfois de défiance. Ainsi ce conflit de valeurs et générationnel, «Nous, on avait tout fait pour changer, s’adapter, aller avec le progrès, et les jeunes, ils le refusaient, on n’y comprenait rien ». A ce stade de la lecture on pense fort au livre de Samira Sédira, Des gens comme eux, publié chez le même éditeur (Rouergue), et qui revient sur l’affaire Flactif, la tuerie du Grand Bornand.
«Là, j’ai pris peur et colère. Parce que je savais que ça allait mal finir». Le ver serait-il déjà dans le fruit ? Mais l’autrice sait habilement jouer avec les codes, et le potentiel fait divers – dont l’anagramme nous dit Paul Gasnier dans La Collision est le mot dérivatif – qui semble s’écrire avant l’heure («Elle sent les mâchoires d’un piège se resserrer autour d’elle, aucune sortie possible, aucune échappatoire, elle a perdu, même si elle se débat encore ») n’est peut-être rien d’autre qu’un dérivatif. Le lecteur – mais ça vaut aussi pour le couple d’anciens, les Satin – gagnerait à ne pas trop anticiper sur les événements : «Combien de fois il me l’a répété. Si je l’avais écouté ! C’était son obsession. On aurait dû s’en méfier oui, mais le mal est pas arrivé comme je le pensais, pas du tout, mais il est arrivé». C’est qu’ «un retour de branche est si vite arrivé».
Et pour démêler les origines du drame, toute une galerie de personnages secondaires, chacun un peu à sa façon dépareillé, est prête à l’emploi ; le Simplet, la vieille aux champignons, Daniel le petit frère de Bernard, sa copine et Séverine la barmaid. Tous ces protagonistes nous mènent à une fin à laquelle on ne s’attend pas : «Une erreur, et la montagne, elle pardonne pas, elle fait payer, la nuit, les lapiaz, (…) tout était prêt pour le piège qui s’est refermé».
Dans ce territoire de pierre et de non-dits, Maryse Vuillermet creuse les lignes de fracture d’un monde rural au bord de la rupture. Lapiaz capte la rumeur souterraine des peurs, des rancunes et des solitudes, jusqu’à ce que la menace, d’abord diffuse, devienne tout à fait palpable et saisissante. Un roman d’une intensité minérale, où les paysages rongent peu à peu les âmes.
«Je m’amusais avec eux, mais je surveillais, j’observais, et je me tenais sur mes gardes»
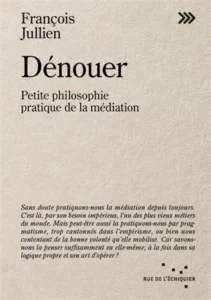
Dénouer
Petite philosophie pratique de la médiation
de François Jullien
Editions Rue de l’échiquier
«Le parti ou le pari de la médiation me paraît être précisément que le conflit puisse se dissoudre, si ce n’est se résoudre, de l’intérieur même de la situation advenue et sans qu’un Pouvoir vienne à trancher»
Alors que les pratiques de médiation s’imposent de plus en plus, François Jullien estime que l’acte de médiation est, qu’on le considère dans son intention, ses implications ou son déroulé, reste «insuffisamment réfléchi», relativement peu théorisé, «il se voit condamné par conséquent à l’empirie». En outre, il reste établi comparativement, et comme alternative, à l’acte de juger.
Ainsi, Jean-Pierre Bonnafé-Schmitt, l’un de ceux ayant accompagné en France la professionnalisation de la médiation, écrivait un essai en 1992 où il définissait la médiation comme relevant d’une «justice douce» (éditions Syros). Le médiateur apparaît ainsi comme une figure «insaisissable» : si le juge tranche, établit un arrêt, que fait donc le médiateur ? A quoi sait-on qu’une médiation est réussie ? De quoi est fait l’art d’opérer du Médiateur ?
La médiation serait ainsi paradoxalement, presque à son apogée sur le plan pratique, mais à ses commencements du point de vue théorique : «Savons-nous penser [la médiation] suffisamment en elle-même, à la fois dans sa logique propre et son art d’opérer ? ».
Afin d’initier cette entreprise de théorisation de la médiation, François Jullien nous invite à recourir à plusieurs concepts tels que le biais, l’amorce, l’incitation, la viabilité, la disponibilité, l’écart, le potentiel de situation, l’entre, la dé-coïncidence, le com-possible, autant de notions fortement inspirées pour l’essentiel de la langue et pensée chinoise dont François Jullien est le grand spécialiste.
La médiation gagne à se pratiquer « sans plan dressé à l’avance », mais en investissant dans les « facteurs porteurs de la situation », de sorte à en faire des « leviers opérants » : « faire confiance, en somme, à la capacité interne au procès des choses, autrement dit au processuel décelé au plus intime des situations, et savoir en tirer parti ». Tout l’art de la médiation se situe dans la possibilité d’introduire du biais, de l’évasif, pour remettre du jeu et sortir d’une forme d’immobilisme les oppositions tranchées. Le médiateur opère dans l’entre ouvert des deux parties (« l’entre fécond, en tension, ouvert par l’écart même de ces extrêmes »), de sorte à faire travailler les opposés, à faire advenir une fissuration puis une reconfiguration : «c’est dans l’entre que se découvre le passage ou l’issue : que se trouve la viabilité » ou encore « Aussi, est-ce dans cet entre tensionnel apparu par écart que la situation d’elle-même peut bouger et qu’un commun terrain d’entente -par débordement des positions respectives- peut émerger ».
Par ailleurs, François Jullien égratigne malicieusement quelques expressions passe-partout, à l’instar du « pas de côté », ou du « gagnant-gagnant » en montrant leur inconsistance. Il s’exerce également à une critique en règle du « compromis » : «Le compromis s’en tient à une réalité obvie et durcie, celle contre laquelle on se cogne, sans plus tenir compte de ce qui pourrait travailler plus secrètement en elle. C’est pourquoi le compromis peut être adroitement obtenu, mais ce n’est qu’une solution au rabais, acceptée faute de mieux pour éviter un heurt trop coûteux ». Il introduit aussi quelques réserves quant à la rétribution des médiateurs considérant que l’efficacité de la médiation tient plus au processus engagé qu’à un « Sujet héroïque » (signalons que le Médiateur a, malgré tout, tout au long du texte, droit à sa majuscule).
Même si l’on peut comprendre la tentation de faire des liens entre les différents sujets, on pourra reprocher certaines ouvertures qui, à la fin du texte, veulent embrasser trop large, en sautant d’une référence à la situation politique hexagonale actuelle, au conflit israélo-palestinien, en passant par le « faire-Europe », autant de sujets qui auraient mérité de plus amples développements et qui ne se satisfont guère ou que paresseusement de l’application des mêmes concepts.
Il n’en reste pas moins que ce petit texte, issu d’une conférence prononcée par l’auteur au Sénat le 9 décembre 2024, vient parfaitement lancer la collection « Petites flèches » porté par ce petit éditeur indépendant remuant qu’est Rue de l’Echiquier, et qui entend proposer des interventions « sur des sujets et des problèmes d’aujourd’hui pour que la philosophie serve la société».
Une ressource de philosophie pratique autant utile que tout à fait nécessaire.
«La médiation se fie plutôt, en se confiant non pas à l’action, mais au processuel de la transformation, à une logique de l’amorce et de la propension : non plus pour trancher en un jugement, mais pour réussir en dégageant un dénouement»
- All
- Gallery Filter

Divisible par lui-même et par un
de Kae Tempest
traduit par Héloïse Esquié
Editions L’Arche
«Il y a toujours eu un nouveau matin propre, sobre et frais comme
du linge
Qui se lève lentement
Toujours la perspective de peut-être aujourd’hui»
C’est toujours avec impatience qu’on attend le prochain recueil de Kae Tempest, mais ça vaut aussi pour ses concerts. Nous y sommes. Son nouveau recueil est paru le 17 octobre et son prochain concert se tiendra au Transbordeur ce jeudi 25. Que de réjouissances !
Avec Divisible par lui-même et par un, on retrouve Kae Tempest dans un style et dans un flow tels qu’on les avait aimés, tellement, dans de précédents recueils à l’instar de Etreins toi ou encore Courir sur les cordes.
Vivre pleinement, peut-être moins dans la nostalgie, plus dans l’acceptation : l’intention est bien là, plus assumée encore («fierté par degrés»), comme un pacte avec soi-même, comme une revendication d’une existence en propre («j’éprouve cette forte envie de trouver ma place»). On retrouve toujours une exploration sensible de soi, «la palpation de [ses] noeuds» à laquelle Kae Tempest fait référence en citant Ted Hugues au début du recueil. Encore beaucoup de solitude dans ce texte («je me sens aussi perclus que le vieux merle» ; «mon vœu le plus cher serait qu’on me fiche la paix») mais pas une solitude en soi, une solitude éclairée par la présence de l’Autre («tu me transformes en celui que je rêvais d’être»), par la communauté des «inadapté.e.s qui rendent le monde supportable» («mon peuple magnifique»), celle de la nouvelle génération qui «remonte sa capuche». En référence au titre du recueil, l’on pourrait dire que la clôture sur soi, l’autosuffisance n’est qu’une chimère. Si la formulation est poétiquement fertile, Kae Tempest n’est pas pour autant de l’espèce des nombres premiers, tant iel rend hommage et se solidarise avec toutes celles et ceux, que son éditrice, qualifie de « famille queer ». Aussi, ce titre qui intrigue (« Divisible by itself and one » en anglais) est-il le lieu de l’énonciation d’une intégrité et continuité fragiles, cette entreprise au long cours qui vise à être soi sans se dissoudre, tout en restant, bon gré mal gré, attaché au monde.
Toujours sur le qui-vive («je suis ce qui m’inquiète, je suis ce dont j’ai peur»), avec des graines de confusion semées ici ou là, inquiété par des «souvenirs dehors en cercle» («il n’y a pas de beauté suffisamment forte pour nous protéger du passé vorace»), des boucles de répétition qui pèse[nt] une tonne («s’endormir pardonné, se réveiller condamné»), des menaces-angoisses jamais éteintes («un millier de colosses minuscules dans ma poitrine qui tirent sur la corde en attendant la chute»), au risque parfois de l’«explosion» («j’ai la sensation que toutes mes coutures sont défaites»). Avec le plein d’attention à ce qui l’entoure, à ces liens avec les éléments naturels et non humains (les vieilles pierres, la pluie, la boue, les hêtres, la figue, la chenille, le chien) et aux désordres environnants. Avec des instants suspendus aux petites heures du matin («la beauté matinale»), le «flamboiement quotidien» comme rescousse, et une foi «dans les petites choses», celles qui ancrent («je m’enfonce dans le sol pour m’équilibrer»). Le tout enserré dans une forme d’extrême lucidité («je n’ai jamais vraiment pris trop garde à l’espoir (…) Ces temps-ci je rêve juste assez. Pas plus»).
Une nouvelle fois, la poésie de Kae Tempest frappe fort, touche fort, une poésie qui ouvre des fenêtres, qui ouvre sur la possibilité d’un nouveau matin.
«Si seulement on pouvait avoir ce qu’on désire
plutôt que ce qui nous force à rester sur pieds»
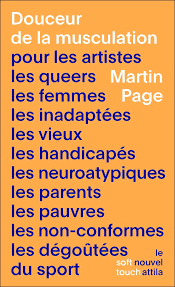
Douceur de la musculation pour les artistes les queers les femmes les inadaptés les vieux les handicapés les neuroatypiques les parents les pauvres les non-conformes les dégoûtés du sport
de Martin Page
Editions Le Nouvel Attila
«Commençons par soulever une pierre et assistons au spectacle de nos muscles qui se forment comme de nouvelles ailes».
Le Nouvel Attila a le chic d’éditer des livres aux titres qui font mouche. Ainsi le précédent opus signé Alex Tamécylia, «Les féministes t’encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme, et devenir trans-pédé-gouine ». Ici on quitte le rose pour revêtir une couverture orange et un titre à rallonge tout aussi saisissant, «Douceur de la musculation pour les artistes les queers les femmes les inadaptés les vieux les handicapés les neuroatypiques les parents les pauvres les non-conformes les dégoûtés du sport ». L’effet couverture marche peut-être un peu moins pour un libraire, quoique, mais le fait que ce livre soit signé Martin Page l’a rendu désirable à mes yeux. J’avais en effet particulièrement aimé du même auteur, Au-delà de la pénétration et De la pluie (je dois confesser n’avoir pas lu son roman récemment publié chez Les Escales, La tendresse des catastrophes). C’était pourtant pas gagné, je ne crois pas avoir une inclination particulière pour des livres sur les bienfaits de la musculation. J’y connais strictement rien en matière de callisthenies, de squats, barebell, dumbblle, kettlebell, et autre sangle TRX. Et pourtant le propos a pris, …
Ce petit livre (170 pages) est une sorte de manifeste à la fois politique et d’une grande douceur («Les muscles sont de la douceur que l’on se prodigue et que l’on prodigue»), qui parvient à retourner tout l’imaginaire qu’on peut avoir quand il est question de musculation. Avec Martin Page une autre forme de musculation est possible, plus éthique et morale, loin du culte de la performance, de l’industrie du fitness, bien loin d’une approche viriliste de cette activité physique (précisons que l’auteur est non binaire, «C’est parce que je m’assumais enfin hors de la masculinité que je me sentais légitime pour me saisir d’une pratique vue, à tort, comme masculine»). On apprend d’ailleurs au passage que selon une étude, «les femmes récupèrent plus vite que les hommes après une session de musculation». Ainsi, «pourquoi dans l’imaginaire collectif, la musculation est-elle un truc de mecs jeunes? Pourquoi accepte-t-on ça ?»
La musculation peut tout à fait être une pratique sportive inclusive et émancipatrice pouvant totalement s’adresser à celles et ceux, outsiders, visés dans le titre du livre de Martin Page. «Cette conversation avec la gravité et la matière», Martin Page en fait une réponse possible à cette question entêtante: «Comment être en bonne santé dans une société blessante et oppressive ? » : «La musculation est une réplique à ce qui me blesse». A travers une pratique régulière et individualisée de la musculation, Martin Page rend compte de comment il est possible de mieux habiter son corps, de comment il est possible de voir rapidement des «résultats», de gagner en «agentivité» : «Enfin, nous agissons sur le réel. Ce n’est plus lui qui nous claque la porte au nez». Il invite également à mieux connaître la « boite noire » que constitue notre corps. Il en fait même une pratique de résistance joyeuse, où puissance et fragilité peuvent cohabiter. Et si l’entretien du muscle n’était pas au service d’une possible domination, mais au contraire, une preuve de soin accordé à soi, accordé aux autres (savoir porter un enfant en bas âge, soutenir une personne âgée sans risquer de se faire mal). Ou comment s’affermir sans se durcir.
Une écriture claire, avec un recours (non systématique) au féminin générique qui passe inaperçu. «Reprendre les muscles au virilisme», telle est l’entreprise menée avec force et succès par Martin Page. Il n’y a plus qu’à se forger des ailes…
«Si on ajuste notre regard, une salle de musculation est simplement une sorte de cabinet de soins esthétiques».
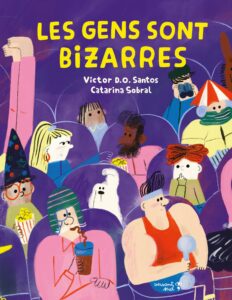
Les gens sont bizarres
de Victor D. O. Santos et Catarina Sobral,
traduit de l’anglais par Anne Cohen Beucher
Editions Versant Sud
Album jeunesse
«Tu ne me crois pas ? Eh bien, toi aussi, tu es bizarre. Laisse-moi quand-même te montrer ! »
C’est quoi être normal ? Etre bizarre ? Le petit narrateur de l’album jeunesse « Les gens sont bizarres » nous embarque pour une petite virée autour de chez lui, à la rencontre des gens bizarres qu’il voit au quotidien. Une bonne occasion pour se questionner sur la normalité, à hauteur d’enfant.
Il y a ces personnes qu’il nous présente comme son voisin toujours à l’affût de ce que les autres pourraient dire à propos de son jardin, ces hommes qui passent leur temps à se regarder dans le miroir à la salle de sport, son copain qui promène une tortue en laisse… Il y a aussi ceux qui ne sont pas à une contradiction près, comme cet homme qui s’est fait tatouer « rien n’est permanent » et qui demande de bien l’écouter tout en disant « n’écoute personne ! ». Les propos insolites de son oncle ou ce petit garçon qui dit être magicien mais qui vient tout de même à l’école (ce qui semble bizarre au narrateur). Et puis, il y a dans tous les détails des illustrations, ces personnes peut-être tout aussi bizarres.
Le dessin est naïf, on voit les coups de crayon et les traces de pinceau. Le tout est donc très enfantin et en même temps empreint de sagesse.
Les jeunes lectrices et lecteurs souriront et riront, peut-être même qu’elles et ils en profiteront pour raconter des anecdotes sur leurs rencontres tout aussi bizarres. Et il est à parier que les grandes personnes en feront de même !
Une lecture drôle, espiègle et qui amène à parler du regard des autres et à être soi-même.
«Avez-vous remarqué que le monde était rempli de gens bizarres ? »
- All
- Gallery Filter

La bossue
de Sao Ichikawa
traduit du japonais par Patrick Honoré
Editions Globe
«Combien ça grince dans mon crâne à simplement soutenir ma tête trop lourde au bout de mon cou tordu, comment ça m’écrase à l’intérieur de me tenir le bassin penché en avant, évidemment que je perds le bras de fer contre la Terre».
La Bossue nous entraine, sans concession, dans la vie de Mlle Izawa Shaka, une quarantenaire atteinte de myopathie myotubulaire qui vit dans un foyer médicalisé. Le quotidien nous est tendu comme un miroir où l’on voit les contorsions du corps, ses multiples empêchements, et tout le concret de ce corps, «de traviole», empêché, emberlificoté : les glaires qui ne passent pas, les mucosités qui déferlent, et tout l’appareillage nécessaire (corset orthopédique, cathéter, canule de trachéotomie et autre aspirateur) pour faire tenir les choses a minima. Le moindre geste est soupesé, calculé, le risque d’étouffement toujours présent. «Moi, chaque livre que je lis, ma colonne vertébrale se plie un peu plus, mes poumons se ratatinent, ma gorge se perfore, ma tête se prend le montant de la porte, mon corps s’affaisse et s’effondre pour vivre». Tout est exprimé à la première personne, à hauteur de ce corps souffrant, mais aussi désirant.
Elle est à la merci de l’aide des auxiliaires de vie, lesquels prennent une place importante dans ce récit. C’est avec elles, eux que Shaka vit l’essentiel de ses interactions sociales. Par la force de ses descriptions, l’autrice parvient à nous mettre dans cette situation d’inconfort, de déformation corporelle. Le lecteur en vient à être comme elle, comme cloué tout à tour sur une chaise ou dans son lit. Mais la claustration n’est pas totale.
Le reste du temps, pour ne pas plus (s’)étouffer, Shaka s’organise des échappées, elle fait des publi-reportages, suit des cours d’université en streaming, erre sur les réseaux sociaux, s’invente des vies parallèles, nous raconte des histoires, écrit des nouvelles érotiques sous pseudonyme. Elle a besoin de se rapprocher d’une vie plus normale, quitte à ce que ça passe par quelques subterfuges, à l’instar des assaisonnements prêts à l’emploi auxquels elle a recours pour donner plus de goût à la nourriture qu’on lui propose. Et surtout, pour se rapprocher d’une « existence standard », elle aspire à « tomber enceinte et avorter, comme une humaine normale ». Ou la métamorphose d’un corps handicapé, objet de soin en corps handicapé, sujet de désir. L’écriture se fait puissante quand elle flirte avec les affirmations scandaleuses, irrévérencieuses. Mais qui provoque qui ? Les diktats validistes sont copieusement « débunkées » – aux torsions du corps répondent les distorsions de la réalité des personnes en situation de handicap envisagées par des personnes valides, et l’on aime l’idée de prolonger ce texte avec deux essais importants, Nos existences handies de Zig Blanquer éditions Tahin party, et le recueil traduit aux éditions Cambourakis, La théorie féministe au défi du handicap.
De la provocation, de l’audace, des considérations réflexives sur le care et le sexe, de l’auto-dérision (la narratrice se désigne ainsi comme une « monstresse bossue », sa façon de décrire ses côtes ou encore ses poignets et coudes ne sont pas exempts d’hilarité). 85 pages seulement, mais tout y est.
«Plus je vis, plus mon corps craque et s’effondre. Il ne se brise pas vers la mort. Il se brise pour vivre et s’effondre comme preuve du temps qu’il a vécu».

La colonie
d’Annika Norlin
traduit du suédois par Isabelle Chéreau
Editions La Peuplade
« Pourquoi ne suis-je pas allée avec eux ? Je manquais pourtant de compagnie.
Je suppose que j’avais peur. Pas parce qu’ils avaient l’air agressif, au contraire, mais plutôt parce que : je ne comprenais pas. »
Emelie, au printemps 2023, est une jeune citadine suédoise, dans l’effervescence et le tumulte de la ville et du travail toujours plus prenant. Elle vit à cent à l’heure, aime cela, est fière de sa vie. Et soudain « tu es comme… envahie par un état émotionnel. » Burn-out que ça s’appelle. Jusque-là Emelie détestait le Plein Air (« Je n’aime pas la nature. Je n’aime pas être au grand air. Une des choses que j’ai préférées dans le fait de devenir adulte c’est de pouvoir échapper à toutes ces sempiternelles et obligatoires activités de Plein Air. »). Mais là, elle ressent le besoin d’être en forêt. Elle y passe de plus en plus de temps, jusqu’à y planter sa tente et s’isoler totalement. Enfin, c’est ce qu’elle croit, jusqu’à ce qu’elle découvre une sorte de communauté qui vient danser, se baigner, chanter sans vraiment de mélodie, remercier la terre pour chaque nourriture qu’elle lui procure, et dormir sous un arbre (elle apprendra plus tard qu’il s’agit de Grand-Sapin). Cette communauté est composée de sept individus mal agencés. « Qui étaient-ils ? Pourquoi remerciaient-ils des brochettes de pain ? Qu’est-ce qui les unissait ? » D’abord à distance, puis de plus en plus près (jusqu’à les rejoindre pendant un temps), Emelie (avec ses réflexes de journaliste) les observe, cherche à comprendre leur organisation, leurs motifs d’action. Elle se met même à prendre des notes et ce sont elles que nous lisons notamment dans ce roman. Entre les pages de ce carnet de bord s’intercalent celles du cahier à spirales de Lake (le plus jeune de la communauté) et des chapitres consacrés à l’histoire de chacun des membres de la colonie, Jozsef, Sara, Sagne, Aagny, Ersmo, Lake et Zakaria, et à l’histoire même de celle-ci.
Ce sont tous des âmes cabossées avec des raisons différentes de s’extraire de la civilisation. Ils tentent de prendre soin les uns des autres, de se réparer, de se protéger de la société extérieure. Inventant un autre rapport à la nature et aux autres, dans une quête du bonheur. A première vue, ça semble marcher : liberté, osmose avec la nature, qu’on remercie à chaque repas, droit au silence, à la lenteur. Mais y arrivent-ils vraiment ? Tous les membres ont-ils la place qu’ils souhaitent, dont ils ont besoin ? Les rapports sont-ils horizontaux et égaux ? Chacun a son rôle bien sûr (comme dans une fourmilière) mais qui soutient, porte, organise, dirige (volontairement ou non) ?
L’arrivée d’Emelie, avec son regard extérieur, pousse ses membres à faire un pas de côté, à questionner leur mode de vie, leur souhait d’y rester, leur envie ou crainte d’en sortir.
Aucune conclusion manichéenne ne sort de ce roman profond et sensible, et c’est tant mieux. La pluralité des regards et expériences amène le lecteur à s’attacher tour à tour à chacun des personnages, à se demander ce qu’il ferait à leur place, comment il se sentirait auprès d’eux.
Tantôt attirant, tantôt dérangeant, parfois drôle, souvent apaisant, tout autant que malaisant, ce roman nous plonge dans une réflexion sur la complexité de vivre aussi bien dans que hors de la société actuelle.
« La Colonie avait quelque chose de fragile, ils avaient conscience qu’elle pouvait s’effondrer à tout moment. Voilà pourquoi ils en prenaient soin avec tendresse, beaucoup de tendresse. »
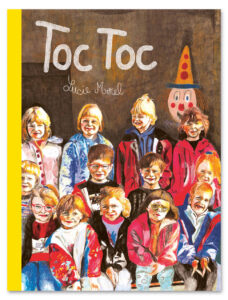
Toc Toc
de Lucie Morel
Editions Même pas mal
«Je sais que c’est n’importe quoi… mais je n’arrive pas à me contrôler».
Lucie souffre de Troubles Obsessionnels Compulsifs suite à un accident de voiture qui lui a fait prendre conscience de sa finitude. Plus elle grandit plus ses peurs deviennent nombreuses : le noir, l’univers, la mort, la mort de sa mère par accident, ne pas savoir embrasser un garçon, … Lucie est de celles qui imaginent toujours que le pire pourrait se produire, et cerise sur le gâteau, que cela puisse être de sa faute. Ces peurs l’occupent aussi car pour les contrer elles y consacrent beaucoup de son temps. La compulsion de comptage est avant tout chronophage : vérifier 6 fois que la porte est bien fermée, allumer, éteindre plusieurs fois la lumière de sa chambre, superposer 6 couches de fond de teint. Respecter une forme de symétrie ou au contraire de courbe dans la disposition des objets. Lucie passe, petite, comme espiègle auprès des siens puis en grandissant comme excentrique, un peu décalée, mais à part quelques retards que ces rituels occasionnent, la famille s’en accommode.
On la voit grandir avec « ça », ce « ça » qui mettra du temps à être nommé : c’est au cours d’un repas de famille que sa sœur aînée alors étudiante infirmière évoque incidemment ce que sont les TOC.
Et malgré tout « ça », Lucie ne reste pas que coincée entre ses TOC, uniquement mue par ce qui serait « plus fort qu’elle ». On la voit surtout avancer envers et contre tout, avec une envie d’en découdre, aller consulter un psy, suivre une Thérapie Comportementale et Cognitive, chanter à tue tête et en yaourt « Baby one more time », filer son indépendance en intégrant son propre appartement lorsqu’elle intègre les Beaux Arts de Metz. Bref, elle se réalise en apprenant petit à petit à domestiquer ses TOC.
Cette BD est très originale et inventive dans sa forme graphique : on y croise de remarquables dessins qui pourraient ressembler à des cartoons (ainsi le front de Lucie qui s’étire comme pour donner à voir l’invisible de ses pensées), l’incrustation de photos personnelles retouchées, des cartes postales, des extraits de journal intime, des extraits d’un guide pratique pour le traitement du TOC (que celui qui ne tente pas à la lecture de cette BD de s’auto-administrer le test pour déterminer son score sur l’échelle Yale-Brown se manifeste…), des coupures de journaux… Cet assemblage est saisissant et producteur de sens.
Cette BD est un bien bel objet qui permet de sensibiliser le lecteur sur ce que sont les TOC et ce que ça signifie pour les personnes qui en ont. Et c’est tout le plus de cette BD qu’elle ait été écrite, de l’intérieur, par une personne concernée. On évite ce faisant le risque d’une esthétisation ou dédramatisation du TOC, car on mesure avec les multiples exemples combien cela peut être invalidant. On n’en fait pas non plus un élément d’identité qui en viendrait à substantialiser cette situation de handicap (« dans les TOC, les obsessions peuvent bouger avec votre vie »). Et l’autrice toujours de recontextualiser, resituer les situations et les environnements dans lesquels les TOC adviennent. Le tout exprimé avec beaucoup de couleurs et de drôlerie.
On en redemande.
«Avant on appelait les TOC la « maladie du doute ». Le TOC essayera toujours de vous faire douter de vous-même. Toute la difficulté est d’apprendre à ne pas discuter avec lui ».
- All
- Gallery Filter

Même le froid tremble
de Nicole Mersey Ortega
Editions Anne Carrière
«Ici on ne possède rien, à peine son égo »
Voici un roman coup de poing. Un road-trip au cours duquel la narratrice, Rucia, accompagnée de ses deux potes, La Maca et La Moni, se dirigent vers le Nord du Chili. La fiesta de La Tirana. Elle quitte Santiago et son « château malade », l’épicerie de ses parents et sa fac d’histoire, le temps d’un été. Comme une urgence à partir : «J’ai besoin d’aller voir le désert, les volcans, les flamants roses migrer, parler à la Vierge noire et trouver enfin de l’espoir en découvrant d’autres couleurs sur la terre ». Une sacrée équipe que ces trois-là, à défier l’impossible, une volonté de survie chevillée au corps ; « ensemble, on est sataniques et puissantes, ensemble on n’a peur de rien, c’est une façade entretenue depuis l’enfance ». Et pourtant, un psychopathe rode sur leur chemin du côté d’Alto Hospicio, et leur déplacement les expose aux regards d’hommes libidineux et à leurs remarques salaces. De bout en bout, le machisme est omniprésent, les hommes, à l’exception notoire de quelques-uns, se comportent en prédateurs. Les oppressions se déclinent au masculin. Elles ont appris à en jouer, à s’en méfier surtout.
A Calama, elles participent avec d’autres, déguisées en lama, à l’envahissement d’un terrain de foot, pour dénoncer les viols impunis des filles d’Atacama. Partout, le passé qui ne passe pas refait surface, les fantômes des torturés du régime de Pinochet ne sont jamais loin. Et le potentiel de révolte est toujours bien là.
Le voyage se poursuit empreint de superstitions (Akellare, « On tisse des sortilèges entre femmes pour ne plus jamais mourir, et du plafond tombe la plume de mille âmes ») émaillées de quelques apparitions à l’instar de la Dame blanche et autres âmes en peine. Et c’est autour du vaste bidonville que constitue Calama que les trois comparses fougueuses rejointes par trois frères s’étourdissent dans une fête syncrétique haute en couleur et progressent vers la Vierge noire-qui-ne-s’avère-pas-noire « pour demander un petit coup de pouce au destin, sans rien d’autre que l’espoir entre leurs mains et la force de leur jeunesse ».
Ce roman m’a notamment fait penser à Les villages de Dieu d’Emilie Prophète tant il confronte dans un même mouvement, désespoir et noirceur à une pulsion de vie et de résilience tout à fait remarquable.
Un premier roman charnel à l’écriture sensorielle, parfois crue, délibérément vulgaire, qui touche en plein cœur.
«J’ai le ventre noué par l’aventure qui me fait peur, mais que j’envisage en fiction pour négocier avec le réel un peu d’espoir».

Café de la gare
de Paul Vermersch, Thibault Vermot & Inès Pollosson
Editions Sarbacane
BD
«Ce théâtre, c’est le nôtre, corps et âme.
On fait tout maison parce qu’on joue pas seulement un spectacle : on vit une aventure !»
Quelle bonne idée de revenir sur cette aventure collective qui a été, en un sens, préfiguratrice de ce qu’allait devenir, un théâtre contemporain libre, et plus tard encore, le stand up. Les principales figures de cette scène artistique de l’époque – fin des années 60 – défilent, Coluche, Romain Bouteille, Miou-Miou, Patrick Dewaere, Sotha, Henri Guybet. C’est que les uns les autres sont peu convaincus, et c’est peu dire, par la forme du théâtre traditionnel. «Si on se lance pas, on sera condamnés à jouer du théâtre chiant comme un dimanche chez ma grand-mère».
Du projet à sa réalisation, on suit pas à pas le collectif en train de s’organiser. Les locaux trouvés, il n’y a plus qu’à remettre à neuf une ancienne ventilerie industrielle du passage Odessa à Montparnasse. Sauf qu’aucun ne semble très à l’aise avec le maniement des outils. Il s’en faut avant que le lieu devienne emblématique. L’état d’esprit se constitue lui aussi petit à petit, « un théâtre avec l’interdiction d’interdire », où un esprit libertaire s’impose : pas de hiérarchie, un partage équitable des profits, prix des places attribués à la roulette. Cet état d’esprit créer des conditions favorables pour l »improvisation créative. « C’est fragile, ce qu’on construit. Ce soir, on a dansé juste au bord de la catastrophe…. et ça a tenu. Comme un funambule qui rigole au-dessus du vide». Ainsi, sans qu’ils ne contrôlent grand chose, alors que ça « déborde » parfois, ça « part de travers » souvent, une ligne artistique se dessine peu à peu et le succès prend.
Une très belle énergie se dégage de cette aventure humaine (« Plus qu’un théâtre, c’est notre amitié qu’on a bâtie ») énergie qui irradie également tout au long de cette BD. On apprécie que s’incrustent dans l’histoire, telle une bande originale, quelques chansons emblématiques de la période traversée, « Il est cinq heures, Paris s’éveille » de Jacques Dutronc, « ma liberté » de Georges Moustaki, « Dis, quand reviendras-tu ? » de Barbara. Une ligne sobre mais efficace se dégage du dessin laissant une belle place aux attitudes et expressions du visage de différents protagonistes. Soulignons également l’écriture des dialogues marqués par un humour certain et une verve contestataire très imprégnée des désirs et recherches d’alternative de l’époque.
Il en va, à cette période de l’année, des BD comme des romans, le nombre de parutions est important, et à défaut de pouvoir jouer à notre niveau sur cette sur-production, je vous invite à ne pas laisser passer de côté cette dernière. On passe un vrai bon moment à la lire !
«J’ai pas la dégaine. Pas la voix. Pas la gueule. Mais j’ai un truc. Un bordel en moi qui demande qu’à sortir. Si je me plante, je le ferai à fond. Si je cartonne, je voudrais que personne me le dise. Pour pas que ça devienne une habitude le succès. C’est un piège à vanne molle. J’ai pas appris à parler. J’ai appris à gueuler. Et là, j’ai des trucs à gueuler. Des trucs vrais. Ce soir, je me fous à poil».

Trois siècles d'amour
D’Eva Kavian
Editions La Contre Allée
« Quand je veux dire quelque chose que je ne sais pas exprimer, j’essaie un peu, puis ça se dilue dans les choses qu’on peut dire. »
Après une première parution aux éditions du Castor Astral, ce petit roman si atypique arrive en poche à La Contre Allée. Pourquoi atypique me direz-vous ? Eh bien, nous sommes ici en possession d’un texte qui ressemble à un conte sans en avoir la forme… en fait un texte qui ne ressemble à aucun autre. Ce qui est sûr, c’est qu’il s’agit d’une oeuvre qui surprend, d’une histoire d’amour aussi, et d’une réflexion sur l’identité, l’écriture et la lecture.
Dans ce roman il y a…
Un lieu de vacances constitué de rectangles : un de terre, un « bleu avec de l’eau dedans » et un exactement de la même taille pour construire la maison. A côté, il y a le voisin qui vit également sur un rectangle qu’il creusera jusqu’à atteindre la terre rouge, celle qui ramène les souvenirs de ceux brûlés sur le bûcher car ils pensaient autrement. Un peu plus loin, il y a une boulangerie, le Grand Café, un tabac, la supérette Aux Courses du Jour.
Quelques personnages : la narratrice – épouse du mari et mère des enfants du monde, les amis, le voisin sa fille et son cheval pas très grand, la boulangère, le médecin en tracteur, le vendeur de tabac Merci Merci, les tenanciers du café. Tous croqués avec beaucoup de tendresse (surtout les femmes qui se découvrent sensibles et sensuelles).
Une suite de petits événements, anodins mais peut-être pas tant que ça.
Et il y a l’arbre de papier et l’homme à la camionnette qui passe ses nuits dans cet arbre. Cet arbre, c’est la narratrice qui l’a fait naitre à partir de papiers dessinés par les enfants du monde. « Ici, il ne pleut pas. Pour pousser, les arbres doivent attendre qu’on ramasse des papiers, qu’on les empile. » Cet homme, c’est la rencontre que fait la narratrice et qui la fait (re)devenir femme, aimée, désirée, désirante.
Le tout narré dans une langue alliant simplicité apparente et métaphores qui suscite autant de questions qu’il ne donne de réponses. C’est ainsi qu’Eva Kavian nous emporte et que ses mots restent en tête une fois le livre refermé, avec les images qu’on s’est créées.
On avait été particulièrement touchés par L’engravement (autre livre de l’autrice également à La Contre Allée), la justesse des émotions et états mentaux des personnages nous avait saisis. Avec Trois siècles d’amour, le style est radicalement différent mais Eva Kavian poursuit cette exploration de soi, des autres, et la magie opère de nouveau.
Un coup de cœur pour ce texte, et un pour sa couverture, avec cet arbre de papier qui illustre si parfaitement ce roman-conte.
« Rien ne me permet de croire qu’ici tout existe, mais avec ce goût dans la bouche, j’ai ressenti le besoin de me lever, de regarder de plus près le feuillage blanc de l’arbre. »
- All
- Gallery Filter
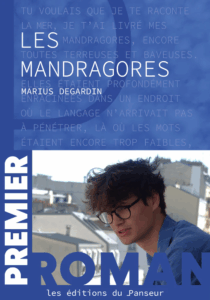
Les mandragores
de Marius Degardin
Editions du Panseur
« Oui c’est ça : il faut aller jusqu’au bout de la nuit et ne pas chercher un refuge dans son fond. Ne jamais oublier l’aube. Autrement, on se retrouve piégé, barbouillé d’ivresse mauvaise et rempli de haine pour le monde. »
L’écriture, comme matériau à modeler, malaxer, pour donner une texture unique à son histoire, voilà un point commun à de nombreux romans des éditions du Panseur. Les mandragores fait partie de ceux-là.
Marius Degardin, tout jeune écrivain d’une vingtaine d’années, choisit de donner voix à Benito, jeune lycéen malmené par la vie, tout à la fois immigré italien et titi parisien, des années 80 mais qui pourrait tout aussi bien sortir d’une autre époque.
Lui donner voix, c’est lui choisir un phrasé, des mots qui lui sont propres, lui accorder un franc-parler bourré de poésie. Et garder ce ton, ce rythme, cette coloration, tout au long du roman. Et c’est réussi, avec panache.
Donner voix à Benito, c’est aussi accéder de manière parfaitement subjective à la vie d’une famille complètement éclatée et abîmée : un père aux abonnés absents, qui a fait la guerre d’Algérie, quelques marmots et beaucoup de dégâts ; une mère partie depuis dix ans sans donner de raison et qui revient muette ; un frère ainé, Primo, grand violoniste, « vendu » enfant au chef de l’armée du père, M. de P. (qui, le prenant sous sa protection, en fait son objet) ; un second frère, Piero, pianiste jazz, peintre, devenu soudainement aveugle il y a quelques années, porté sur la bouteille ; une sœur protectrice, Chiara, bec de lièvre et crâne rasé, sage-femme qui attend le grand soir. Et bien sûr, Benito (son père aimait Mussolini, pas facile à porter comme prénom), enfin Benoit (c’est parfois pratique l’assimilation) dont la vie bascule quand sa mère annonce par une lettre qu’elle revient. « Ca a fait l’effet d’une bombe, une grosse, une américaine, le genre qui dégomme tout à la ronde et qui laisse un sifflement à la con dans l’oreille. » C’en est trop, Benito tente de se pendre et l’histoire commence « à toute berzingue ».
Alors, oui, il y a beaucoup de noirceur, de crasse (mais jamais « dégueu »). « Une fois qu’on perçoit l’incohérence du monde, on ne peut plus l’ignorer, peu importe le babillage incessant du divertissement. L’absurdité nous attrape à la gorge. On se sent si seul. » Mais aussi des moments de lumière, de joie, de poésie comme ces rencontres (Iris, Amédée, Albert, Edmée) ou ce pique-nique dans les jardins de Ste Anne, à manger des cerises. Il y a Paris, ses rues, ses pavés. Il y a ce je-ne-sais-quoi qui pourrait rappeler les textes de Mano Solo.
Il y a surtout un premier très grand roman à lire à tout prix.
« Tu voulais que je te raconte la mer, je t’ai livré mes mandragores, encore toutes terreuses et baveuses. »

Maisons d'enfance
d’auror.404
Editions Burn-Août
parution le 17/09/2025
«Parce qu’habiter, ce n’est pas juste vivre quelque part, c’est connaître un lieu, s’y sentir légitime et reconnu»
Le titre Maisons d’enfance se décline au pluriel car ce sont tout un tas de maisons qui sont ici réunies. La (double-)maison de famille de l’amoureux à Ispagnac dans les Cévennes « gorgée de luxe et de souvenirs », la MECS où Samaël travaille en tant qu’éduc, celle de la maison où il a grandi dans le bassin minier du Pas-de-Calais, mais ça peut tout aussi bien être le dortoir de l’auberge de jeunesse à Port-Tuly où il se rend l’été… Et dans certains de ces lieux, l’on est traqué par le passé, ô combien. Ainsi c’est dans la maison de son enfance que Samaël a été le réceptacle des violences physiques de son père et sexuelles de son grand-père. «Nos cages thoraciques sont noircies des fantômes de nos enfances » ; cette même maison qui le retient encore, celle vers laquelle son frère Ulysse et lui doivent revenir pour la vider, son père ayant été hospitalisé. « Ca prend du temps de s’enfuir, ça prend peut-être une vie ».
Dans Maisons d’enfance, il est aussi question d’une rencontre du narrateur avec un anthropologue, d’origine bourgeoise, spécialiste des violences adultistes, et notamment celles ayant cours dans les structures de l’Aide Sociale à l’Enfance. Leur histoire prend très vite, leurs conversations sont intenses et stimulantes mais l’asymétrie de leur relation guette («Les enjeux entre nous sont si différents. Toi, tu optimises. Maintenant que tu es référent égalité des chances à l’université, tu veux comprendre. Et moi, je déprime. Je vois l’enquête ethnographique et non le geste amical dans ta volonté de m’accompagner»), comme s’ils étaient « condamnés à ne pas parler la même langue ». Ou quand frontières socio-linguistiques (« Je sens aussi qu’on en arrive à ce point où on ne pourra être qu’au-delà ou au-deça des mots ») et topographie des corps s’entremêlent. «Dans la vie, il y a des scripts qu’on ne peut pas changer. Ça n’empêche pas de bien jouer ». Alors qu’ils sont censés signer une publication avec leur deux noms, participer à deux à un colloque, les choses ne se feront pas. Samaël se sent comme « dépareillé » quand il passe du temps avec les amis de son compagnon : « des parois invisibles isolent mon corps » ; « j’ai l’impression d’avoir été catapulté dans une série Netflix scénarisée par Bourdieu. Mon rôle y est pourri : il consiste à trahir les personnes qui me sont les plus chères ». Samaël est englouti par le syndrome de l’imposteur, «je ne comprends pas pourquoi ce garçon a voulu me faire une place dans sa vie. Il côtoie quotidiennement des gens tellement plus doués et éloquents que moi ». De là à ce qu’une forme d’emprise se niche, il n’y a qu’un pas, comme celle décrite dans D’après une histoire vraie de Delphine de Vigan.
Les retrouvailles de Samaël avec son amie-voisine d’enfance, qui témoignent de ce qu’elle avait alors entendu, lui permettent de sortir de la page blanche de son enfance. Et la fin de sa relation amoureuse agit aussi comme une prise de conscience, Samaël ne veut plus « endosser ce coldplay de dame de compagnie », il a mieux à faire, «pour contrecarrer les généalogies brisées, faire notre propre récit mémoriel et le tisser à nos mondes actuels ».
Ce texte parvient, au fil d’un tissage narratif novateur laissant une place importante aux dialogues, à rendre compte, dans ce tissu aux fibres fragiles, et comme s’ils s’actualisaient devant les yeux du lecteur, des dilemmes moraux qui accaparent Samaël, enclin à accorder et renouveler sa confiance, notoirement, à l’endroit de son partenaire amoureux, mais aussi sans cesse contrarié et rappelé aux violences subies durant l’enfance. Un premier roman qui est parfaitement aligné avec la collection qui l’accueille, et qui promeut «des textes écrits la première personne qui mêlent l’intime au politique dans une perspective fondamentalement queer et féministe ». Fort réussi.
«On voudrait que l’autre nous comprenne, nous connaisse par cœur, mais pour cela il faudrait imaginer qu’un système de vidéo-surveillance ait archivé les violences inouïes de mon enfance ».
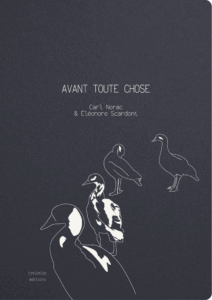
Avant toute chose
de Carl Norac & Éléonore Scardoni
Editions Cotcotcot
album poétique
parution le 17/09/2025
« le paysage
et la musique
se rencontrer »
Nous ne sommes pas très étonnés de voir arriver dans le catalogue de Cotcotcot le poète Carl Norac, cela nous semble être comme une évidence tant cette rencontre artistique devait avoir lieu … Et cette première collaboration a tout pour plaire.
Les paysages forment ici de la musique, captées sur des pierres lithographiques inspirées des sonogrammes d’Eléonore Scardoni qui n’aime rien tant que « capturer les bruits du vivant dans leur environnement ». Et en écho, la musique issue de la poésie de Carl Norac forme également des paysages. On monte crescendo en musique et on descend decrescendo en paysage. Alors qui du paysage ou de la musique avant le big bang ?
On entre dans la musique-paysage comme on entrerait dans une matière. On fait connaissance avec eux comme s’il s’agissait de personnes.
Un carnet comme toujours, très soigné, le troisième de la collection Les carnets, après Tous mes cailloux et A hauteur d’enfant, qui, devinez quoi, nous avions déjà beaucoup aimés. A quand le quatrième de cette collection ?
Cette écoacoustique du sensible nous invite à prêter l’oreille à la musique des paysages qui nous entourent. Alors êtes-vous prêts à accueillir ces « fragments d’écoute offerts au regard »?
«Peut-être, quand nous naissons avant la toute première chanson, sommes-nous déjà le début d’un paysage ?»
- All
- Gallery Filter

Transatlantique
de Camille Corcéjoli
Editions La Contre Allée
« Partout,
A chaque instant,
A chaque rencontre,
Mon corps en changement brouille les lignes établies. »
Transatlantique, c’est une traversée, celle de l’Atlantique bien sûr, mais aussi et surtout celle d’une vie et d’un corps. C’est l’histoire d’Alex qui a débuté une transition il y a déjà quelques temps et qui part aux Etats-Unis pour se défaire de ses seins. Il est accompagné de Louise, Djo et Harli, une petite tribu d’amis qu’on rêve tous d’avoir. L’énergie qui se dégage de cette équipée est si positive, pleine d’écoute, de rires et d’amour. Dit comme cela, ça pourrait faire un peu gnan-gnan, mais rien dans ce roman ne l’est. Il s’agit réellement d’une force de vie optimiste et libre.
Pourtant sa transition ne se fait pas sans heurt (une administration et des médecins peu compréhensifs, « des mecs bourrés qui ne se gènent pas ‘Hé, t’es quoi toi ?’ »).
Ce voyage, c’est aussi l’occasion de visiter des lieux queers, de rencontrer la tante de Djo, fondatrice du premier bar queer, de prendre en photo les seins d’Alex, pour ne pas avoir que des photos médicales, leur dire au revoir.
Camille Corcéjoli alterne entre narration, dialogues, mails et vers libres. Comme pour la question de genre, il refuse la binarité et sait troubler les genres. « Je suis dans le trou noir du genre. » Son écriture en fait de même créant des moments en suspension, des va-et-vient entre le monde externe et une introspection qu’il nous livre avec sensibilité, entre un voyage au présent et des souvenirs. Toujours avec humour.
En cette rentrée littéraire, impossible de ne pas faire le lien avec Paul prend la forme d’une fille mortelle d’Andrea Lawlor qui sort enfin en français.
Transatlantique parle de liberté d’être soi, de penser comme on le souhaite, de n’entrer dans aucune case, de brouiller les pistes, de tout mélanger pour créer de nouvelles couleurs, de nouveaux contours, de nouvelles formes, d’effacer les frontières et les normes.
« Je ne suis pas de l’autre côté
Mais le pied dans la porte
Pas le cul entre deux chaises
Mais élancé sur une balançoire »
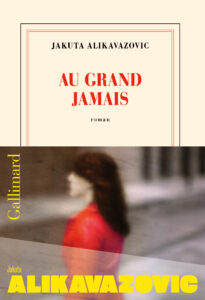
Au grand jamais
de Jakuta Alikavazovic
Editions Gallimard
«J’ai souvent écrit pour dissimuler dans et entre les lignes ce qui m’est le plus cher et qui, m’étant le plus cher, est aussi, inévitablement, le plus fragile.»
L’intention de l’autrice à travers ce très beau roman est double. D’une part, évoquer sa mère, «son acharnement à s’effacer », et sa double disparition en acte. Sa mort mais aussi le fait qu’elle ait cessé d’être poète, alors que c’est une partie essentielle de ce qui semble définir son identité. D’autre part, rendre compte comment, alors qu’elle a essayé de s’en différencier, elle est (re)devenue la fille de sa mère et, tout en en prenant conscience faire en sorte de ne pas se diluer elle-même. L’autoportrait n’est jamais très loin mais le livre embrasse plus large.
Scruter le sourire de sa mère, le détailler. Traquer sa formation, d’où il procède. Percevoir son caractère atavique, en observant le sien, en regardant celui de son fils. Et au-delà de ce sourire, quel est donc ce don qui serait propre à sa famille?
Cette mère insaisissable, énigmatique, silencieuse, sur laquelle semble glisser le passage du temps. Adepte de ce puissant silence, «spacieux» qui relie la mort et la vie. Cette mère à l’allure sans pareil, «L’élégance des mélancoliques, pour qui la vie en soi ne suffit pas – pas tout à fait ou pas du tout -, qui parfois semblent retenus au monde par la seule beauté du geste». Cette mère qui s’est attachée à s’attacher par mimétisme « la langue muette du pouvoir », celle qu’elle observait dans la famille des enfants qu’elle gardait à son arrivée en France.
Alors que l’autrice tente à l’adolescence d’inventer «geste à geste», un répertoire bien à elle de la féminité, elle en vient à réaliser qu’au final «mes gestes volés, ma grammaire physique, toutes ces contrefaçons me rapprochaient bien davantage de ma mère qu’elles ne m’en éloignaient».
Cette mère qui cultive les mystères, voyante un jour, secrétaire au sein d’une banque d’affaire yougoslave un autre, excentrique un temps, se laissant ensuite « glisser dans la banalité comme dans un bain » éternellement postée dans son salon devant son poste télé, comment déplier sa vie ?
Jakuta Alikavazovic sonde, dans le creux de sa mémoire, tour à tour les fantômes et le passé de sa mère, mais si les fantômes sont bien là, les traces du vécu antérieur de sa mère ne sont pas nombreuses, «pour l’enfance, la mère est sans avant». Elle tresse donc l’histoire de cette mère, qui demeure comme en retrait du monde, à travers le recours à la fiction : « les faits dépendent de ceux qui les racontent » ; «Et, comme une goutte de bleu colore tout un verre d’eau, une goutte de fiction suffit à faire roman ».
L’autrice dresse un puissant hommage à sa mère, tout en sincérité et compréhension, servi par une très belle écriture.
«(…) et la question de savoir ce qui relève de la réalité et ce qui relève de la fiction s’estompe, se brouille, disparaît. Tout est réel. Tout est fiction. Tout est sauvé».
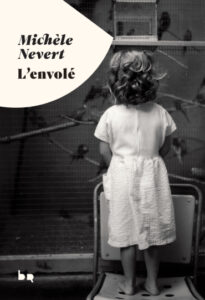
L'envolé
de Michèle Nevert
Editions du Rouergue
«J’entreprends de mettre des mots sur ton absence au moment où les témoins du drame s’en sont allés. Seule demeure encore avec moi, notre mère, que la mémoire, par ailleurs, abandonne peu à peu».
Comment rendre compte d’un événement dont on ne se souvient pas ? Se demande Michèle Nevert. L’événement en question est la mort de son frère, Jean-Claude alias birdboy, aîné de deux ans, occasionnée par une mauvaise chute dans un pré aveyronnais le blessant à la tête et le précipitant dans le coma. Non seulement la narratrice est l’enfant qui reste, qui n’a pas été la témoin de son accident, n’a pas assisté à son enterrement, à qui l’on enjoint de ne plus parler de lui, mais plus encore, elle est celle qui a subi une amnésie dissociative plusieurs années durant, elle qui ne se souvient plus des sept années passées aux côtés de son frère, et des cinq années qui s’ensuivent, consécutives à son décès, au cours desquels aucune trace mémorielle n’émerge. «En manque de souvenirs, je regarde ma peine ou ma tristesse du moment comme un élément du puzzle que je veux reconstituer. J’aspire à descendre plus bas, m’engloutir au plus profond de ma détresse, dans l’espoir de regagner le jour d’avant, celui où on t’a mis en terre. Je crois qu’une fois au plus profond de mon désespoir, dans la violence de la descente vertigineuse, ta main va rattraper la mienne. Tu vas me relever, me ramener à la surface et je vais revoir ton visage et distinguer ta voix ». Ce qui est tout le contraire de sa mère qui n’aura de cesse de se souvenir à l’excès de son fils aîné, l’obligeant à avoir recours à des psychotropes. «Ton absence a empli nos vies : celles de notre mère en la submergeant et la mienne en la creusant par le fond ».
La mort de son frère se traduira aussi pour la jeune narratrice par une enfance sous cloche, ses parents réfrénant toute initiative de sortie, l’enjoignant de rester à l’intérieur, « Ton absence m’a amputée d’une partie de mon enfance ». La culpabilité l’assaille (syndrome de la survivante) et pourtant c’est dans la littérature que petit à petit elle va trouver de nécessaires évasions.
Michèle Nevert nous relate au moyen d’une écriture ciselée, l’amour de son frère aîné pour les oiseaux qu’il aimait protéger, dessiner. Les oiseaux, la grande affaire de leur adelphité : la narratrice-autrice étant une spécialiste du chant des oiseaux et leur petit frère Daniel, un expert en la matière également.
L’autrice organise d’ailleurs des funérailles symboliques à grand renfort d’oiseaux, où les kakapo, oiseaux d’Australie, remplacent avantageusement les croque-morts. Et l’évocation d’être complétée par un sublime mausolée aviaire.
C’est dans cette façon sensible et précise de convoquer les oiseaux – les oiseaux contre l’oubli – de les dépeindre, de convoquer leur empreinte jusque dans le titre du livre, qu’on se rappelle l’écriture de Jean-François Beauchemin, je pense notamment à son si beau roman qui évoque son frère, Le roitelet. On retrouve aussi lors de certains passages une écriture qui pourrait nous rapprocher de Brigitte Giraud dans Vivre vite, notamment, quand Michèle Nevert s’inscrit dans une perspective uchronique, comme quand elle imagine son frère aîné adulte reprenant la droguerie tenant par son père. Et si…
Pendant la lecture défile une bande-son qui nous fait aller de Benjamin Clementine à Françoise Hardy, en passant par Pierre de Maere, Zaho de Sagazan, Bashung, Matthieu Chedid et Fatoumata Diawara.
Michèle Nevert parvient habilement à faire « une histoire de cette histoire » très personnelle, sans pathos. Un premier roman touchant et réussi qui par une écriture émaillée de vent, de fleurs et d’oiseaux, réunit les conditions à l’avènement d’une mémoire reconstituée, d’une poétique du revenir.
«Et tandis que mes souvenirs de toi demeurent englués, emmurés au fond du puits en béton de ma mémoire, demeurent ensevelis dans le fond de ma gorge, où ils répètent sans le suivre ton irréversible envol ».
- All
- Gallery Filter
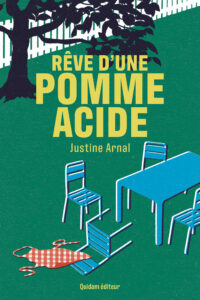
Rêve d'une pomme acide
de Justine Arnal
Quidam éditeur
«Les adultes passent leurs temps à faire oublier à l’enfance ce qu’elle désire savoir. Ils n’aiment pas les questions qui lui brûlent les lèvres. Pourquoi est-ce que grandir consiste si souvent à apprendre à feindre et ignorer ?»
Une famille et ses non-dits. D’un côté il y a la famille d’Alsace, de l’autre celle de Lorraine. Au milieu les trois sœurs d’enfance, l’étudiante, la lycéenne, la collégienne et leur mère Elizabeth Witz. «Au fil des années, l’aînée a compris. Il ne faut pas dire les choses. C’est comme ça qu’on parle autour d’elle. Il faut dire l’inverse, le contraire, ou même tout autre chose ». Et la répétition d’un quotidien, des tâches domestiques, où il ne se passe rien ou presque. C’est dans ce presque que se niche l’histoire, que se fragmente la narration, que le malheur sourde. Un peu à la façon de La semaine perpétuelle de Laura Vasquez, dans une scansion lumineuse de l’écriture.
«Tout a déjà eu lieu. Rien de nouveau n’arrivera dans ce qui aura encore lieu ». Et pourtant, dans les non-dits, dans le silence plein de l’enfance, dans cette répétition de l’ordinaire, dans cette forme active d’inertie, tout se (dé)joue. Justine Arnal excelle dans sa façon de radiographier les oscillations des gestes et atmosphère de cette famille, où l’on se méfie de tout, à commencer des autres. Où les femmes pleurent, telles un choeur, avec des torrents de larmes, qui ne font presque plus réagir et sans que personne ne se soucie ce qui les fait pleurer au juste. La résignation se propage autant qu’elle s’organise ensemble. Ici l’affliction se traite en ayant recours au suppositoire, à coup d’Optalidon qu’on se refile. «Les femmes autour de moi voulaient-elles être comprises ou consolées ? Je les consolais, elles se sentaient comprises ». Les hommes, quant à eux, comptent.
Les disputes du couple s’incrustent dans le quotidien comme un ordre des choses, «ils sont si domestiqués que cela ne leur coûte plus rien ni de les entendre, ni de les prononcer. Ils parlent, menacent, crient – et, quelques minutes plus tard, l’amnésie les gagne, la légèreté revient ». Bref, ça dysfonctionne superbement (et l’on oubliera pas au passage que Justine Arnal est psychanalyste). Et les enfants durablement témoins de tout ça et tellement lucides concernant « cette habitude commune qu’ont les adultes à disposer des enfants lorsqu’ils ont besoin d’affection pour eux-mêmes ».
Il y a ce médecin de famille, auprès de qui la mère aime se confier et qui embauche la fille aînée pendant les congés de sa secrétaire l’été. Et puis il y a ce jour qui signe la fin de l’enfance, la mère, qui « passe son temps à tenir au bord du monde », se suicide. «Dans l’impossibilité de s’extraire de ce malheur trop ordinaire». Alors se mettent à circuler tour à tour fantômes («ils existent dès lors qu’un regard les fait exister, pour soutenir les têtes trop pleines de pertes») sortilèges et langues de belle-mère. Selon une logique organique, clanique, les visages oubliés, les gestes abandonnés refont surface et viennent habiter celles qui survivent.
Absolument conquis par ce texte magnifique.
«Il faut tant de temps pour voir l’enfermement de la famille. Comment le corps s’est habitué à la cellule. Et tout ce qu’on est prêt à faire et supporter pour ne pas en sortir ».

Le désir dans la cage
d’Alissa Wenz
Editions Les Avrils
« Etre passive, être regardée, tu refuses. »
Le désir dans la cage, c’est la biographie romancée de Mel Bonis, pianiste et compositrice française ayant vécu à Paris, à cheval sur le 19ème et le 20ème siècle.
Pas simple pianiste (on cantonne alors les femmes au rôle d’accompagnatrice), elle veut être compositrice, terme qui n’existe alors pas au féminin. Par ruse, elle coupe son prénom, Mélanie, pour le rendre plus masculin. Ses œuvres sont lues, mais peu jouées. Elle décide alors d’ouvrir un salon chez elle et d’interpréter ses propres œuvres. On découvre alors que Mel Bonis est unE compositrice. Les critiques changent alors totalement, les qualificatifs dits féminins sont associés à ses morceaux : « on parle de ton ‛ charme affectueux et délicat ’, de ton ‛ expression sentimentale ’, on dit ton inspiration ‛ tendre et intime ’, on évoque tes ‛ agréables enjolivures ’ et tes ‛ idées coquettes ’, on loue ta ‛ grande sincérité ’. »
Pas simple épouse (d’un mariage qui ne se fonde pas sur l’amour), ni mère (rôle qu’elle remplira pleinement), elle s’autorise finalement à être la maîtresse de (avoir comme amant) Amédée-Louis Hettich (le grand amour de sa vie, chanteur qu’elle accompagne et pour qui elle compose de nombreuses partitions).
Elle refuse de se plier à ceux qui voudraient la rendre silencieuse, la faire taire : ses parents qui ne veulent pas (au départ) lui faire prendre de cours de piano, encore eux qui refusent l’amour qui existe entre elle et Amédée-Louis Hettich et lui préfèrent un riche entrepreneur comme mari, les critiques (tous des hommes) qui ne comprennent pas sa musique.
Mel Bonis est avant tout une femme éprise de liberté, au besoin irrépressible de créer. Déjà petite, lorsqu’elle découvre le piano qui ne sert à personne dans la maison, c’est seule qu’elle apprend, par tâtonnements. Et toute sa vie elle ne cessera de chercher les moyens de sortir de la cage dans laquelle les femmes sont enfermées.
Plus d’un siècle nous sépare de cette femme et pourtant, elle semble juste à côté de nous. C’est la force d’Alissa Wenz qui choisit d’employer le tutoiement, créant une proximité entre elle et Mel Bonis, un espace d’intimité entre les lecteurices et Mel Bonis.
Les phrases, au présent pour la plupart, sont comme scandées, dans un style déclaratif qui pose les éléments, les actent.
Un récit de vie inspirant et une musique à (re)découvrir.
« Il est question de noms que l’histoire a voulu plonger dans l’oubli. Il est question de femmes qui te fascinent, et dont tu cherches la musique. Il est question d’affirmation. »
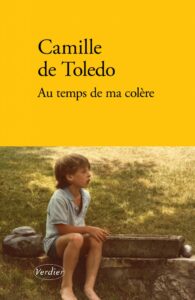
Au temps de ma colère
de Camille de Toledo
Editions Verdier
“et j’aimerais tant, moi,
après toutes les promesses déçues du futur,
rassurer l’enfant
j’aimerais lui dire : ne te précipite pas
ne te donne pas entièrement à la colère”
Camille de Toledo dialogue avec le jeune écrivain qu’il a été, lorsqu’à 25 ans, il a écrit un essai sur la chute du mur de Berlin. Le jeune qu’il est se prénomme alors Alexis et se situe en décalage avec son environnement familial, tout autant qu’avec les croyances que l’on aime se raconter alors sur la liberté, l’Europe, le progrès.
Chemin faisant, «dans le tissu serré des temps», l’auteur remonte « aux sources de la colère, une colère venue de la fin du siècle». Il souhaite mesurer l’écart qui le sépare de ce jeune écrivain, qu’il désigne par «l’enfant» et dont il cite des extraits de manière répétée, en ayant recours à «il écrit», telle une ponctuation du texte, telle une manière de mettre de la distance avec les réflexions et certitudes d’alors – «mettre son temps à distance». Ou comment l’accumulation de strates du passé individuel et collectif mais aussi les fantômes de son passé remontent de ce texte et permettent à l’auteur de mieux comprendre ce qu’il est devenu.
Il souhaite s’enquérir de «ce qui travaille à rebours de [ce] texte. C’est que plus de vingt ans se sont écoulés, ainsi l’auteur d’aujourd’hui puise dans ce «texte de jeunesse » pour extraire des traces, celles d’une désillusion (celle du grand récit de la fin de l’Histoire, des revers du Progrès, de la perdurance du mythe de 1989, du « scandale de nos fictions légales »), d’un refoulé (sa fragilité consécutive à un accident en montagne à l’âge de 17 ans), d’une émancipation (par rapport à l’hypercaste de pouvoir que forme les siens, son père polytechnicien, sa mère qui côtoie les intellectuels et politiques de la gauche de gouvernement et qui est journaliste au Nouvel Obs) avec notamment un changement de nom et une conversion au judaïsme comme pour mieux « s’arracher à sa généalogie », d’une trajectoire qui cherche à relier « vie singulière et Histoire collective » (« le continuum entre les douleurs du monde et les blessures du corps »).
L’auteur souhaitait combattre, par l’écrit puis en étant reporter (« écrire comme on agit »), l’impuissance à laquelle semble condamner les leçons de l’histoire (« le pouvoir de mémoire ») qui résonnent comme autant de « rappels à l’ordre » (« une époque où l’on ressassait les meurtres, les crimes des totalitarismes au point de s’aveugler sur le cimetière du présent ») et des mots totems («les paroles trop grandes») qui constituent les ritournelles de son enfance et devant lesquels le plus grand nombre semble se prosterner : libération du capital, marché unique, critères de convergence, lutte contre l’inflation, remboursement de la dette…
Au sein d’un même «tissu narratif», l’auteur est pris dans un double mouvement, d’un côté il en est presque à regretter la conscience lucide de l’inadaptation, du malaise et de la colère manifestés lors de sa jeunesse qui l’ont comme empêché d’être davantage du côté de la douceur, de la vie sensible, mais d’un autre, il se fait le relai des «tentatives pour relancer l’espoir », «pour ouvrir [une] voie au-delà de l’horizon clos du temps», «pour dévier la flèche du temps », «pour contourner ce qui désespère» (Porto Alegre, Gêne, Seattle, Hambourg).
Et dans les dernières pages advient une forme de réconciliation, une tentative de refaire unité avec cet Enfant qu’il a été, en évoquant son autre mère, Mademoiselle Mazet, cette « mère-maison », «mère-du-soin» qui a permis à sa mère biologique Christine d’être cette mère-du-pouvoir. Sublimes dernières pages pleines de réhabilitation et de gratitude qui laissent entrevoir un dépassement de la colère.
A partir de sa trajectoire singulière, l’auteur nous livre une réflexion stimulante et intime sur l’articulation des temps et plus particulièrement l’intrication du passé et du présent.
«Comment écrire des fictions divergentes
pour produire autre chose
que cet imaginaire
dans lequel nous baignons, nous désespérons ?»
- All
- Gallery Filter

La Destination
de Valérian Guillaume
Editions Actes Sud
«Dans l’existence, les choses arrivent. Il ne faut pas chercher à toujours tout expliquer»
Lors de l’une de nos dernières recensions, on parlait déjà avec La fabrique des timidités de Christophe Perruchas, de l’été, de l’adolescence qui s’étire, des jobs d’été. Cette fois-ci Valérian Guillaume épouse le point de vue et les émotions d’une adolescente qui a pris ses distances avec l’école qui ne lui réussit guère. Elle prête main-forte à Gigi dans sa boutique de souvenirs, un bazar-refuge, au bord d’une station balnéaire devenue passage incontournable des transhumances estivales en raison de la présence de la Pierre de l’Ange qui regorge de nombreux pouvoirs. C’est le poste d’observation privilégié de Valérian Guillaume pour décrire, de façon amusée, les interactions qui se jouent entre cohortes de touristes et population locale. La déambulation des corps de touristes, leurs habitudes, leurs desiderata. «Au fond, tous voudraient être seuls sur la côte mais, ici, le bonheur est un service accessible à tous alors ils cohabitent».
Les touristes et leur incrustation dans le paysage local, comme une caisse de résonance de la haute saison, attrapés non pas par le regard d’une sociologie des loisirs, façon Jean Viard, mais dans l’ordinaire des petites histoires du quotidien. Saturnin Prodige, Monsieur How Many, Titi, Cindy Paréo, Dickers, Rodrigue, Fonfon, Mèche et Chouillu. Et l’incontournable Gigi.
Les lieux comme le prénom de la narratrice sont tus, cet anonymat permettant à tout un chacun de se projeter ici ou là dans l’histoire qui nous est racontée. L’auteur chorégraphie cette partition des intervalles le temps des deux mois d’été : «Sur le port, les garçons garçonnent, les touristes touristent et Gigi, ben elle gigise». L’espace des différences, grandes et petites. Les hauts lieux et les recoins, les fanfaronnades et la mélancolie.
L’adolescente qu’on suit, essaie de se débrouiller avec une mère aux abonnés absents, une Gigi qui la prise un peu trop sous son aile et qui joue les conseillères d’orientation («Au fond, je crois qu’elle rêve que je me roule dans les fiches métier tout l’été»). Elle doit aussi compose ravec ses «tempêtes dans la tête» (« les mots m’arrivent en bourrasques et c’est impossible de ne pas les entendre »). Ces mots qu’elle prononce du dedans et qui la débordent tant.
L’adolescente finit par investir la grande maison de Madame, puis sa propriétaire, découvre la pouvoir magnétique d’un piano à queue qui « transforme la tristesse » : « Le piano me répondait et tous les mots de ma tête se sont mis à sortir de ma bouche. Je suis devenue hors mesure ».
Et à le fin de l’été, Valérian Guillaume, metteur en scène par ailleurs, n’oublie pas de replier le décor, chacun étant soucieux de repartir avec un petit bout de paysage, un petit morceau de souvenir : «Les touristes venaient ici pour rapporter un fragment d’été, un reliquat de joie, d’un espoir ou d’un moment qu’on ne parvient jamais vraiment à garder en soi. Mais de quoi ces souvenirs sont-ils la mémoire ?».
Un roman d’apprentissage qui fait la part belle aux interstices, aux intervalles, aux dérobées dans cette ébullition de l’été, quand tout regorge de pleins. Une lecture d’été sur l’été vivement recommandée.
«Je joue avec les touches du piano. Ma voix envahit l’espace. Je ne chante pas. Je parle les mots qui sont dans ma tête. Sans technique, sans arrangements, je me laisse faire. J’improvise. Je transforme la tristesse».
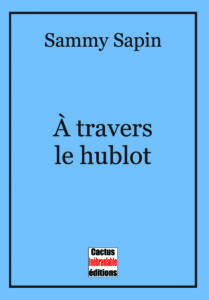
A travers le hublot
de Sammy Sapin
Editions Cactus Inébranlable
«Ce n’est pas toujours drôle d’être timide»
De Sammy Sapin, on avait aimé, mais alors vraiment beaucoup aimé J’essaie de tuer personne paru aux éditions Le Clos Jouve. On était donc plutôt impatient de voir ce que les formes brèves dont il a le secret pouvaient donner assemblées dans un petit recueil d’aphorisme dont seules les éditions du Cactus Inébranlable ont le secret.
Ces miscellanées se dégustent en suivant l’ordre proposé. C’est mieux ainsi car le désordre apparent ou la linéarité contrariée recèlent bien une logique de progression, en attestent les chiffres qui complètent les titres de certains fragments qu’on retrouve en avançant. Comme des écritures rhizomiques qui se déploieraient telle une mélodie des choses, en résonance les unes avec les autres.
On retrouve des éclats d’encre autour de l’existence et qui passent par des déclinaisons aussi variées que les crises de panique, la timidité, l’estime de soi, la singularité, l’observation comparée d’un nouveau-né et d’une grand-mère atteinte d’une maladie neuro-évolutive, le président et les extraterrestres. A travers ces thématiques et en changeant régulièrement de perspectives, l’auteur n’a de cesse d’interroger la place qui est la sienne et le sentiment d’imposture de roder toujours un peu : «A certains moments, sous un certain angle, il devient évident que le monde est une sorte de soirée un peu branchée un peu nulle à laquelle personne ne vous a spécialement convié».
Une juxtaposition de petites phrases contre l’écrasement du monde et qui sonnent justes. Sammy Sapin excelle, en mobilisant cette succession de pensées aphoristiques, à donner forme à son monde intérieur. En la matière, on n’a pas, à chaque page, l’envie d’être dans sa tête (ceci étant, l’auteur aussi forme le souhait de pouvoir s’en détacher, «Ce que je voudrais bien, dis-je à cet ami compréhensif, c’est pouvoir m’extraire complètement de ce point de vue qui est le mien»), mais lire ce recueil mâtiné de clairvoyances et d’impertinences est une promesse d’amusement assurée.
«Le secret, c’est de ne pas tout à fait être là où l’on croit qu’on est, chaque fois que l’on s’y trouve»
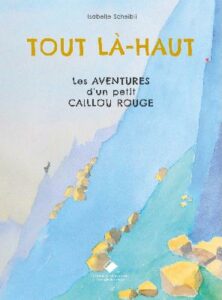
Tout là-haut. Les aventures d'un petit caillou rouge
d’Isabelle Scheibli
Editions du Mont Blanc
«Qu’est-ce que c’est, une montagne ?»
Quel magnifique album signé Isabelle Scheibli qui nous fait croiser tout ce qui compose la montagne, des gypaètes barbus, yacks, bouquetins, aigles, chamois, marmottes, vaches, choucas, loups, ours. Mais aussi des nuages, de la neige, de la glace, des alpages, des chalets, des crevasses, des mélèzes, une cascade, une rivière, un alpiniste, des skieurs. Et ce petit caillou rouge qui ne tient pas en place. C’est que l’inclinaison invite à la glissade, à la dégringolade, au rebond. D’un palier à l’autre, le petit caillou rouge ne cesse de dévaler, où donc cela va-t-il bien pouvoir s’arrêter ?
Mais de petit caillou, il n’en est pas un comme un autre, c’est une aventurine, une espèce de quartz dont les reflets peuvent scintiller de mille feux, bleus, verts, rouges, et jouer de cette variation d’éclats. Et pour rompre l’ennui, ce n’est peut être pas dans la poche d’un petit garçon que cette pierre a toute sa place, ne vaudrait-il pas la ramener auprès des siennes ?
Cet album vient sensibiliser les plus jeunes sur les transformations en cours qui altèrent la montagne et ses équilibres. Un prolongement de l’album permet judicieusement de nous faire découvrir que les montagnes qui se succèdent tout au long de l’album ne sont pas des montagnes génériques, mais inspirées de différents sites existants, du Népal, au Tibet en passant par la France, la Suisse et l’Italie.
L’auteure-illustratrice Isabelle Scheibli parvient à partir d’un assemblage d’aquarelles et d’un narratif qui s’insère magnifiquement bien à ces illustrations à déployer une histoire de toute beauté. A lire et à relire.
«Le petit caillou rouge
fait une longue glissade
jusqu’à la grande cascade»
- All
- Gallery Filter
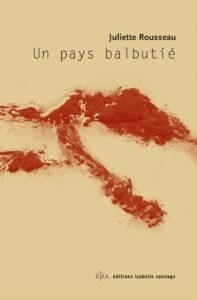
Un pays balbutié
de Juliette Rousseau
Editions Isabelle Sauvage
«C’est de savoir sentir ensemble, encore une fois, qui fait défaut. Savoir consentir».
Juliette Rousseau qu’on avait aimé lire avec Péquenaude et La vie têtue (éd. Cambourakis) revient ici avec un court texte écrit dans le cadre d’une résidence d’écriture à Plounéour-Ménez. Ça tombe bien car c’est à partir d’un pays («le nom d’un lieu qui te relie») la Bretagne que l’autrice déplie sa réflexion sur l’identité, l’identité bretonne, d’identité tout court. Sa fille Lumière ne semble pas bien savoir ce qu’il en est, mais qui sait au juste cerner ce que vient nous dire la notion d’identité ? Qu’est-ce qu’un foyer, par quoi passe l’enracinement ? À quoi s’identifie-t-on ? «où s’allume la pulpe des attaches» ? Et que vient faire la fiction là-dedans ? «Entre-accordage» de questionnements quand tu nous tiens !
A l’heure où l’identité se fait étanche, «pas de migrants chez les chouans», Juliette Rousseau plaide pour réhabiliter les liens, la relation à l’autre, et nous réserve quelques fulgurances : «On pense peut-être l’enchainement des générations comme on pense la place de l’humain dans son milieu. L’un domine, et par là, il préexiste. Dès lors maintenir cet ordre des choses consiste à établir encore et encore l’histoire de cette préexistence. Avant toi, il y avait moi. On oublie que ni « toi » ni « moi » n’existent en dehors de la relation. Que moi avant, ce n’était pas moi, c’était autre chose, pris dans un autre réseau de relations. Parenter, c’est inévitablement l’être en retour».
On se rappelle aussi comment en juin 2024, Juliette Rousseau avait gentiment répondu à notre invitation de produire un petit texte en écho à une tribune « Contrecarrer les imaginaires d’extrême droite » que nous avions initiée en tant que libraires indépendants. Ce petit texte qu’elle avait produit dans l’urgence se terminait ainsi «Parce que la rencontre, c’est inné et fragile à la fois, ça demande du soin, du temps, des droits, l’égalité, la liberté. Un certain laisser-aller et la tendresse aussi, d’un genre qui ouvre dans les bras. Ça demande des existences nouées les unes aux autres et libérées, ensemble ». Considérations autour de la réciprocité qui viennent s’inscrire comme dans un alignement par rapport à cette réflexion sur ce qu’est «un pays balbutié».
Et, pas à pas, s’esquisse ce à quoi pourrait ressembler des pratiques d’hospitalité architecturées par «une porte qui n’a pas été pensée que pour s’ouvrir et des murs poreux à ce qui vient par le vent ou la pluie, pour mieux l’en protéger» et l’agencement d’un autre rapport au monde «là où je me tiens existe bel et bien quelque chose à quoi je suis liée et qui permet au jour de naître, à la nuit de suppléer, et à nos existences de s’y déposer».
Ça donne envie de relire un autre petit texte, celui de François Jullien, publié chez L’Herne, Il n’y a pas d’identité culturelle et puis, celui cité en référence de Joëlle Zask, Ecologie et démocratie (éd. Premier parallèle).
Juliette Rousseau parvient dans cet arpentage réflexif, avec sagacité et jamais faire la leçon, à déconstruire, à partir de son «corps-lieu», les slogans et mystifications identitaires redevenus en vogue. Aussi utile que plaisant à lire.
«Et plutôt que d’être de cette terre, à quoi ressemblerait d’être avec elle ? »

western chorba
de Zélie Siakhem
Editions Le Clos Jouve
«Dans le fond, on se fabrique tous une famille quand la nôtre n’est pas satisfaisante».
Ce recueil est constitué de deux textes bien distinct mais où l’on retrouve la même force de narration très rythmée, parfois survoltée, et sans ambages. La première partie s’intéresse aux «fondations», à la famille de la narratrice, aux figures hautes en couleur de la grand-mère (Pouchkina, ou mamie Georgette c’est selon) et du grand-père (le célèbre peintre algérien M’Hamed Issiakhem, ami de Kateb Yacine), mais aussi de Katia, la mère de la narratrice. La seconde explore ce qu’il en est de la condition d’une femme de la cinquantaine qui se remet d’une relation toxique qui a duré trente ans.
Les tranches de vie aussi improbables que rocambolesques s’enchainent, une virée en Scénic pour se rendre à la crémation de la grand-mère et qui ne se passe pas comme prévu, les frasques de son fascinant grand père qui n’aimait rien tant que «faire voler en éclat tous les oripeaux de la superficialité». La vie comme une série loufoque, où les obstacles rivalisent avec l’anticonformisme et surtout, «l’humour, la joie, la drôlerie, la poésie du vivant érigés en principes fondateurs».
Dans la seconde partie, Zélie Siakhem nous propose un récit poignant et intime, criant de vérité. Il cartographie les désillusions et déconvenues nombreuses, les (con)quêtes impossibles («J’aime ça, le rejet. Courir après des types que tu ne peux pas convaincre. Je n’ai jamais fait que ça»), l’invisibilité «d’une meuf de cinquante ans». Comme pour se jauger soi à travers les autres, l’autrice élargit parfois la focale décrit ce à quoi sont confrontées ses amies, Calra, Berthille, Inès, Delphine, Hélène, Camille, le «dating fatigue» dirait Judith Duportail (éd de l’Observatoire). «Tous identiques, désespérés, chauves, affalés. J’y retourne pour me marrer, pour éjecter, fascinée. La multitude des sollicitations me glace. Je flippe, assaillie par une horde de zombies. Ne craignez pas l’effondrement, il a déjà eu lieu».
Et s’ouvre aussi à travers ce récit le témoignage de la souffrance endurée durant sa relation au long cours avec «machin». Une passion amoureuse singulièrement destructrice, d’une toxicité sans nom. Et surgit alors dans le récit, à l’écoute d’une intervention radiophonique de Giulia Foïs, la désignation du «viol conjugal». Elle dit le réveil tardif, «Faut un paquet d’humiliation avant d’accepter d’ouvrir les yeux», elle détaille la fabrique de «nappes» de culpabilité : «Le spectre d’un départ annoncé pour une femme qui saurait faire le job servait de levier constant à une humiliation récurrente. J’avais perdu droit au désir comme à la musique. Je devais consentir. Toute absence de désir était justifiée par ma faille ». Cela fait étrangement penser au narratif de la série Querer.
L’autrice détaille également, avec une lucidité intellectuelle tout à fait étonnante, ce qui constitue les mécanismes de répétition, agit par une impossibilité de « bousculer la programmation » : «Tu as développé au fil des années une sorte de sixième sens tout à fait aiguisé. Mais tu promènes ta galette au beurre et le loup peut la sentir à des centaines de kilomètres à la ronde. Il y a un mécanisme tout à fait intuitif qui te rapproche avec une constance sidérante de la pathologie qui est complémentaire à la tienne. S’il existe un déterminisme, sans doute n’est-il pas entre les mains omniscientes d’un dieu créateur, fut-il horloger, mais bien dans ta construction psychologique initiale, dans tes névroses. Jusqu’où sommes-nous libres de nos agissements ? ».
Cette introspection participe à rendre compte de la force combattive de la narratrice, qui est littéralement «remontée des enfers », et partant, s’autorise dans un double mouvement, d’une part d’adresser à sa fille comme une leçon de vie, «tu apposeras le baume des mots sur tes blessures, l’onguent de l’humour sur tes mots. La honte n’a à voir qu’avec tes idéaux. Tu auras honte parfois car tu les portes haut », d’autre part à repositionner aussi la valeur inestimable de ses relations d’amitié, ce par quoi se termine cette très belle seconde partie.
Dans un registre proche de l’autofiction, Zélie Siakhem réussit à « transcender le réel et y injecter [une] forme de poésie ». Une écriture puissante, résolument féministe, et d’une très grande liberté.
«L’histoire, je l’invente un peu. J’ai pas le choix, c’est plein de trous et du récit de ceux qui lui volent son histoire».

Pourquoi tu pleux ?
d’Anne Crahay
Editions Didier Jeunesse
« Ca me déluge le cœur. Ca me huuurle comme le vent ! »
Quelle bonne idée de ressortir en format souple ce magnifique album !
Pas facile de mettre des mots sur ses émotions. Pas évident non plus de savoir soi-même pourquoi on pleure. Alors quand un chat tout rond rencontre notre petite héroïne en pleurs, s’engage une discussion poétique pour expliquer ses larmes. D’abord, elle réplique qu’elle ne pleure pas : « alors là, pas du tout ! Je pleux. » S’ensuit une recherche de description tout en finesse à partir des différents types de pluie, de vent, de tempête. C’est à la fois tendre et drôle. De cette drôlerie complice et douce car forcément, ces métaphores nous parlent à tous.
Anne Crahaix, dont on a avait déjà beaucoup apprécié le travail avec ses deux albums (Le sourire de Suzie et Mes p’tits doigts) publiés aux indispensables éditions Cotcotcot, fait dialoguer textes et illustrations avec brio. Les fins traits de la bouche et des sourcils transmettent colère, tristesse, agacement. Les collages donnent du relief et pourraient presque nous faire penser à un petit théâtre de papier.
Un petit album à avoir sous la main pour parler autrement des émotions.
«Tu bruines, tu pleuvines, tu pleux averse ou…»
- All
- Gallery Filter

Mona
d’Aurélie Champagne
Editions Esquif
nouvelle
«Une vie pour une autre vie»
Bienvenue au Youpi Park, parc d’attraction de Gironde où travaillent la narratrice et sa collègue Flora, consolatrice en chef. Un véritable non-lieu comme dirait Marc Augé, lieu de concentration de cris d’enfants qu’il faut animer, rassasier. «En soi, le travail au Youpi n’a rien de compliqué. Gaver les gamins, tenir la caisse et briquer. Briquer, briquer, briquer. Du sol aux sanitaires, des trampolines au Dino-resto». Et à bien y regarder, la narratrice pourrait avoir quelques ressemblances avec Clara, la narratrice de Tout l’or des nuits de Gwendoline Soublin. Elle ne sont pas que dédiées à l’entretien, elles ont aussi en commun d’avoir à faire face à un deuil. Essayer de tenir en se focalisant sur la machine à granités, en tenant une «comptabilité d’orfraie». D’ailleurs ce n’est pas un hasard si le protocole que Chris le gérant n’a de cesse d’afficher partout se cristallise autour de 4 lettres, MONA, pour Ménage Ordre Nettoyage Amabilité. C’est aussi le prénom de l’enfant mort-né que la narratrice a porté. Alors la narratrice, qui développe auprès de sa collègue une théorie selon laquelle «on passe sa vie à mettre des choses à la place d’autres choses ; à combler ce qui manque avec ce que l’on trouve» finit par s’attacher à une fille qui investit Youpi Park, une fille pas comme les autres, mutique, toujours accompagnée d’une assistante familiale. «A la vue de cette petite, quelque chose en moi avait recommencé. S’était hissé hors du bourbier où je sombrais depuis Mona». Mais que va-t-il-bien pouvoir se passer à l’arrière d’une Punto quand cette fillette qui a fait l’objet d’une disparition inquiétante finit par ré-émerger, l’air de rien, dans la piscine à balles ?
Et à ce moment-là on pense fort à un premier roman qu’on avait particulièrement apprécié, Une si moderne solitude de Léna Pontgelard paru aux éditions du Panseur, ou comment Marie et Léon après avoir perdu un enfant, s’autorisent, pour l’essai, à en emprunter un.
Ce petit format qui semble être la forme qu’investit opportunément cette nouvelle maison d’édition, Esquif (on notera au passage l’excellent texte de Fabrice Caro, Rumba mariachi qui a été concomitamment publié, trois autres textes-novelas signés par Mina Zampano, Nicolas Martin et Richard Gaitet suivront dans les prochains mois) semble parfaitement adapté au temps présent où les formats courts, type série, n’en finissent pas de remporter succès après succès. Ces 41 pages sont d’une grande maitrise et, dans une belle progression, tout est délicieusement tendu vers ce moment de bascule.
Un petit «grand texte» à l’écriture tout à fait ravissante et qui vient subtilement nous saisir.
«La vérité est qu’on ne vit que sous peine d’oublier. Qu’en remplaçant les souvenirs par d’autres souvenirs. Pour que le monde devienne habitable»
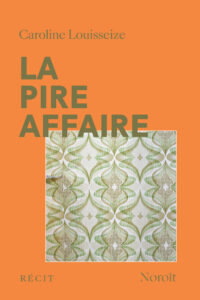
La pire affaire
de Caroline Louisseize
Editions Noroît
récit-poésie
«J’aurais aimé être de celles qui ne demandent rien
qui savent dire non
sans craindre de disparaître»
Caroline Louisseize, qui est poétesse et qui est également correctrice pour plusieurs éditeurs québécois, explore l’intime des meurtrissures de l’enfance qui remontent à la surface. Elle nous livre un récit-poésie poignant sur ce à quoi elle a été exposée durant son enfance-adolescence, ce harcèlement qui ne dit pas son nom (à dessein le mot n’est pas employé) mais qui menace grandement son estime de soi. «en noyade paranoïaque, j’apprenais l’effacement, je restais dans l’attente de vivre».
Elle dresse ce combat mené en silence et en apnée pour passer inaperçue ou normale, «falloir être soi-même : la pire affaire» : «si j’étais comme les autres, je n’aurai pas besoin de regarder l’asphalte et partout autour». C’est que les moqueries, humiliations et mépris en tout genre lui font perdre «les mots de l’enthousiasme» et ne lui laissent pas beaucoup de répit : «les fracas de toutes parts, ma parole à cœur ouvert sur la place publique, déformée, décharnée, minée», «je suis poussée d’un regard à un autre, trimballée depuis le début, en fuite». Elle apprend ainsi, en ayant recours à des stratégies de survie et à une forme d’acuité psychologique à se muer «dans l’écosystème de la battue». Et, dans cette accumulation de «petits riens» qui agissent comme autant d’empêchements à l’affirmation de soi, comment distinguer l’amie de l’ennemie et comment dire tout simplement «arrêtez».
Comme dans la cabane de Steve Dubois et Charlélie Poulin dans Asphalte de Sébastien Dulude, la narratrice aime bien s’absenter des autres, se mettre à l’écart de la réverbération du jugement de ses congénères. Trouver refuge au «royaume des bouquins» ; «en attendant, dans ma cachette face au grillage, je m’exerce à vivre. Et dans le rire je demande : la lumière, la légèreté dans la beauté fauve de l’enfance». Elle se réfugie aussi dans la «chorégraphie du sérieux», celle de la bonne élève, «l’enfant wow des adultes». Par la suite, Caroline prend la mesure des «infimes fracas» enchanteurs, à commencer par «les possibles sauvetages du rire», l’infiltration de la musique qui agit comme une enveloppe protectrice («je me glisse dans le gant des sonates, j’arpente les degrés. C’est la revanche du vacarme, le bavassage des trilles») et le pouvoir du langage («Tu enquêtes sur le sens jusqu’aux pourtours du langage, et dans le langage c’est toi qui apparais»).
Un récit poétique tout à fait percutant qu’on ne se lassera pas de lire et relire. Une bien belle découverte.
«Dans ma vie idéale, il n’y a pas d’autre validation que la poursuite d’un vieux rêve tenace, la vie rêvée. Ma vie d’adulte rêvée d’enfant»

L'île des mythes - Tome 1 : l'éveil
d’Anaïs Halard & Sole Otero
Editions Casterman
BD jeunesse
« Excuse-moi, mais tu n’es pas exactement l’élite de la magie… ! »
D’abord il y a cette couverture : on reconnait en arrière-plan Blanche Neige et devant deux personnages (nous saurons ensuite qu’il s’agit d’Isia et Sora) qui semblent danser dans un halo magique, sous le regard admiratif d’une petite fille lapin Kawaï, le tout dans les couluers vives de prédilection de Sole Otero (à qui l’on doit les BD Walicho et Naphtaline).
Puis, il y a la première double page : une carte de l’ïle des Mythes : d’emblée nous plongeons dans un univers mêlant magie et histoires d’enfants. Tous les ingrédients sont présents : sorcières, pirates, gnomes, sirènes, supers héros, monstres, mais aussi contes marins, romans, mythes, mangas, etc. Le décor est planté, et il donne bien envie de le visiter.
Commence alors l’histoire d’Isia, une jeune sorcière pas très douée qui tente de se faire accepter par un groupe, pas très sympa il faut l’avouer, mené par Blanche Neige, imbue de sa personne et pas bien sympa non plus. Isia doit prouver qu’elle est capable de jeter un sort de lacets emmêlés sur un petit garçon pour le faire tomber… Un vague souvenir des bandes plutôt malveillantes trainant dans les collèges à l’affût d’une victime pour s’amuser… Sa mère ne semble pas bien croire en elle. Pas facile de s’épanouir ainsi.
Heureusement elle rencontre sa nouvelle voisine, Sora, très douée en magie. Une amitié nait et la confiance en soi apparait peu à peu.
Cette amitié sera très utile pour le tournoi lancé par Dumésa afin de rejoindre l’ile Céleste et gagner la larme de licorne aux supers pouvoirs ! Elle pourrait bien soigner le père d’Isia qui est aveugle.
Dans ce premier tome, nous ne suivons que la première épreuve : sortir d’un labyrinthe dans lequel les attend Alice. On a hâte de découvrir les prochaines !
Si cette BD est si réussie et va tant plaire aux jeunes et moins jeunes c’est grâce à la collaboration de grande qualité d’Anaïs Halard (pour les mots) et Sole Otero (pour les dessins). Tout s’articule et se répond à merveille. Les grands yeux expressifs des personnages, leurs têtes rondes, les décors très colorés nous propulsent dans un univers magique. Les dialogues donnent du caractère et amènent un humour acidulé. Et en prime, de nombreux personnages connus se sont glissés ici et là, à vous de les retrouver !
Une BD à savourer et à partager
« Salut Isia,
Si tu rêves de participer au tournoi, tu devrais le faire. »
- All
- Gallery Filter

La fabrique des timidités
de Christophe Perruchas
Editions du Rouergue
«On vit sur des fumées, des fictions de nous, c’était doux, comme imaginer.»
De 1990 à 1994, cinq étés durant, on va suivre Christophe, alias Chrispousse, le narrateur, sur la plage de la Pège à Saint Jean-de-Monts, à vendre des pralines. A partir de ses 15 ans, on le voit s’entrainer à vaincre sa timidité. Et pas seulement en sculptant son cri chouchouboudouboudou («Ce n’est plus de l’air qui sort de mes poumons, ce ne sont plus des ondes qui vibrent, flèches et cordes vocales, c’est un objet, une couleur, une consistance»). L’auteur ne s’intéresse pas à n’importe quelle timidité, il s’intéresse aux timidités adolescentes, en filant la métaphore avec la timidité des arbres, ces espaces vides entre les branches qui leur permettent de croitre sans se toucher. C’est ce qui semble aussi caractériser la relation que Christophe et Anne entretiennent. C’est dans les projections et échanges épistolaires que leur relation platonique prend forme, comme une cristallisation des idéalisations de l’adolescence. Une «histoire qui n’en est pas vraiment une», mais qui en est une quand même. On retrouve en toile de fond cette thématique de l’amour platonique, d’un amour toujours différé («On dirait le prolongement de moi, on pense pareil, on rit aux mêmes endroits, mais ça n’est pas encore le moment nous deux (…) Avec Anne, on se dit que nous, c’est pour plus tard qu’il ne faut pas gâcher»), qu’on a tant apprécié sous la plume de Marco Lodoli, avec son fabuleux roman Si peu. Mais Christophe, s’il entretient cette relation avec Anne, à distance, c’est d’abord dans son carnet qu’il écrit des pages et des pages, qu’il aime à se raconter toutes les histoires d’amour ou de retrouvailles qu’il pourrait vivre avec Anne. «Mon écriture serrée. Je pose ici notre vie idéale, celle qui adviendra. Personne ne me lit. A part elle, par-dessus mon épaule». C’est à la fois son échappée et sa pudeur et son espace d’intimité à lui dans ce camping où l’on partage tout, avec La Oie, Lapin, Marco, Didi, Phil et Cathy.
L’auteur ausculte ce qui se trame, en souterrain, à ces âges, en matière de désir, d’envie, de solitude, de tristesse, de désillusion, de l’exacerbation des goûts (ainsi le fameux goût de métal dans la bouche qui revient à plusieurs reprises). Mais le nuancier des émotions est plus fin que ça : on le voit aussi investir des relations d’autre nature, à commencer par celle avec son frère et sa sœur, fabriquer des complicités avec Lysiane, consolider son amitié avec Yvan, approfondir l’amour avec Olivia. L’aimantation des corps qui s’expérimente. L’auteur explore aussi les états de confusion, les sentiments d’absence, la brume n’affleure pas que sur la plage, elle est aussi présente dans les têtes, à commencer par celle de Christophe mais aussi lors de cette impossibilité de se rappeler pourquoi le personnage principal se retrouve au petit matin dans une tente qu’il ne connait pas, à l’écart du groupe de pairs.
Christophe Perruchas fait montre de trouvailles dans son écriture, avec l’insert de bout de phrase en italique comme le prolongement d’échanges soliloqués, le recours à une écriture en vers libres. Comme un certain Nicolas Mathieu, il arrive avec une grande justesse à encapsuler les marqueurs d’une époque en ayant recours à des extraits de chanson qui ont marqué une l’époque (Nothings compare to U) et en faisant référence aux marques de voiture (la R5 Baccara). De sorte que ces premiers boulots-vacances, on a l’impression que c’est un peu des nôtres dont il parle.
Christophe Perruchas signe ici un magnifique roman d’initiation, sensible, sur le dépassement des premières timidités.
«Dans mon carnet
je lui continue nos vies
celles qu’on n’a pas eues
et qu’on n’aura sans doute jamais»

Jamais le ciel ni les rivages
de Philippe Gerin
Editions Gaïa
«Jamais le ciel ni les rivages ne pourront nous être confisqués. Il restera toujours quelque part une montagne bleue et une rivière verte.»
Dans un futur très proche (vers 2030 ?), la guerre s’est répandue à l’est, il est question de dresser un mur pour endiguer le flux de femmes et enfants (les Ossies) qui tentent de migrer à l’ouest et le climat est complètement déréglé (après de gros incendies, une vague de froid s’abat sur l’Europe en avril). Une dystopie bien sombre et si plausible à la fois.
Lazarus a perdu un fils, Saul, deux ans auparavant. Il fuit M, sa ville natale, pour un ailleurs qu’on ne connait pas, « il n’y a plus nulle part où aller aujourd’hui… ». Pourtant, lui semble savoir où il va, « Lazarus fait glisser son index depuis la capitale allemande jusqu’au massif montagneux ». Il a avec lui un jeune enfant migrant, Anatolyi, aveugle d’un œil et qui ne parle pas, « un enfant magicien » dont il doit prendre soin. C’est Annette, marionnettiste de Berlin, qui le nomme ainsi.
Au même moment une jeune migrante, Souliko, est retrouvée morte dans une cave d’M. Tonio, le policier en charge de l’affaire, se remémore un événement traumatisant de son enfance.
Des histoires qui se mêlent, entre passé et présent, dans ce moment comme arrêté par la neige qui empèse, qui assourdit, qui fige tout, un temps en suspens.
Pourtant, chacun avait cru qu’un avenir meilleur était possible. Lazarus y avait cru lorsqu’il avait fêté l’anniversaire des un an de la chute du mur. Tout le monde y avait cru « Wir sind das Volk ». Mais à présent c’est un mur « long de deux mille kilomètres de frontières » qu’il est question de construire. Ce sont des milliers d’Ossies qui tentent de survivre.
Chaque personnage a connu des pertes, des deuils. L’absence est là, à chaque page. Comment vivre avec ?
On avait été bouleversés par La mélancolie des baleines, par la justesse des émotions dans une atmosphère déjà de fin du monde. On se souvient de cette tempête qui amène les différents protagonistes à se retrouver dans une maison du bord de mer en Islande. On se souvient aussi de cet enfant malade d’une lucidité et clairvoyance bien plus grandes que celles des adultes qui l’entourent. Philippe Gerin poursuit l’exploration de ces moments graves, il continue de chercher, comme ses protagonistes, des espaces réparateurs dans un monde en péril.
C’est un roman assez silencieux. Les quelques dialogues sont en italique, à peine dits, des pensées tout juste audibles. Les rues, bâtiments et espaces traversés semblent le plus souvent désertés, et la neige, partout, ajoute du silence au silence.
La mélancolie des personnages nous prend forcément et nous laisse avec nos propres pensées silencieuses.
Un grand roman.
«Il y a des innocents et des fautifs partout et bien souvent ce sont les mêmes.»
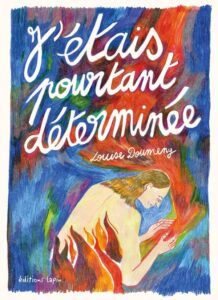
J'étais pourtant déterminée
de Louise Doumeng
Editions Lapin
roman graphique
«Il y a des gens que le tourment tient éveillés. Moi, il me tient en vie».
Louise Doumeng nous livre un journal dessiné, intime et introspectif, sur ce que c’est que de devenir adulte et artiste, les deux en un, les deux dans la même séquence. Ce roman graphique est structuré autour d’une archéologie sensible du territoire de ses 25 ans, de ses secousses, entre «défaites délicieuses, interprétations météorologiques douteuses, délires inavouables et amitiés inébranlables». On suit une galerie de personnages qui l’accompagnent dans son itinéraire de vie artistique (elle est dessinatrice et danseuse tout à la fois), à commencer par son père-en-polaire-orange, sa mère absente mais tellement présente, son papy-Paul, sa Tati Pomme, mais aussi ses potes Léonie, Renan, Etienne, Hélène, Cindy et Belette son chat, ses «petits autres» inspirants.
Les histoires s’enchainent et cette structure narrative faite de fragments est entrecoupée par des pleines pages de ciel, un ciel aux couleurs de la vie (le ciel qui brûle, le ciel tiraillé, qui se lève pour un autre jour, qui lui parle de passions, qui a une étoile de plus) et qui composent un même motif : comment être au monde avec toute sa lucidité, quand on est une femme artiste dans le milieu de la vingtaine, comment traverser les tourmentes ?
Que ce soit dans la rapport à l’autobiographie, mais aussi au format et au dessin, ce roman graphique n’est pas sans nous rappeler le travail réalisé par Julie Delporte (éditée par Pow Pown, on pense notamment à Corps vivante).
L’autrice est tenue par une réflexivité de tous les instants, elle questionne ce qui agit en elle, ses blessures, ses doutes. C’est aussi une BD sur les colères et cette force de détermination, comment ça cohabite, ce qu’on en fait. «Lors d’un stage de danse, le chorégraphe Loïc Touzé dit que la question n’est pas toujours à résoudre. Il parle de s’émanciper de la réponse, de se tenir debout dans la question ». Louise Doumeng est donc partisane de l’adage selon lequel «il n’y a pas de réponse qu’une bonne question ne sache résoudre…».
Vingt-cinq ans voire plus (on accompagne l’autrice jusqu’à ses 28 ans), c’est manifestement plus tellement l’âge des pourquoi, mais celui des comment. «Comment faire une vie d’adulte digne de ce nom ? Comment aimer les gens qu’on aime sans les anéantir ? Comment déposer les armes certains jours ? Comment les reprendre le lendemain ? Comment rendre ce monde moins dégoûtant ?». Et à cette ribambelle de «comment», il semblerait que quand elle ne répond pas à d’autres questions, l’autrice prend appui sur un poème égrainé à la toute fin comme pour y trouver trace de quelques possibilités de réponses. On (re)découvre à cette occasion la poésie d’Etienne Jodelle, et c’est tout à fait ravissant.
Un roman graphique très plaisant.
«25 ans. C’est mon âge cette année.
Dans mon imaginaire
c’était le BEL ÂGE.
Finalement c’est un bordel
SANS NOM»
- All
- Gallery Filter

Traverser les orties
de Violette Chalier
Editions du Bunker
poésie
«Dans le flot de mes mots, je t’écris pour ne pas te perdre
C’est mon passeport entre les mondes».
Ecrire (à) son père, comme on veille sur lui. Ce que Violette Chalier sonde, c’est ce père fantomatique, qui échappe («tu n’existes pas dans le tangible, mais je te vois caché dans mes contours»), c’est plus dans la veine de l’entreprise d’Hélène Gaudy dans Archipels. Mais ici d’atelier d’artiste il n’y en a pas. Le père n’est presque déjà plus là, couché, dans l’intimité de son château-«maison de pierres froides et dures» qui elle-même tient à peine debout. «Pour extraire les pierres des histoires qui vivent dans ton poumon crevé». Reclus, c’est en conversant avec sa fille, et par le truchement de son imaginaire et de ses rêves qu’il s’évade. «Mon père dort au milieu de rêves taillés en tronçons, il les a gardés précieusement par peur qu’ils ne se réalisent. Des accumulations de songes, des gousses d’ail séchées, des stylos sans encre et des porte-clefs de marques disparues. Autant d’accroches pour ne pas accepter la péremption des choses».
Ça pourrait aussi ressembler à des retrouvailles-réconciliations sur le tard («j’ai mis à sac ma colère pour fleurir des étendues nouvelles»), comme dans le livre de Gaëlle Josse, La nuit des pères. «Ce sont cinq ans de paroles qui remuent dans la maison et définissent Un te comprendre qui s’approche de l’absolution». C’est que la maladie s’impose, l’issue fatale attend en embuscade, le deuil presque déjà là. Laissant la possibilité d’une relation filiale d’aide, de veille («Je t’aime malade puisque tu me laisses m’occuper de toi» ; «C’est le cancer de mon père qui a pavé durement le sentier à peine écrite entre les orties»). Mettre l’attente à profit pour mieux saisir qui est ce père inaccessible à l’instar de son jardin qui ne se laisse pas traverser, avec des framboisiers protégés par des ronces et orties qui rivalisent d’ardeur : «j’ai accepté d’être dépositaire de cette mémoire et de cette façon bizarre d’être au monde».
C’est que dans les plis de tous ces silences, il en reste à dire, l’urgence devient alors de recoudre les paroles, chercher les traces, «recoller les morceaux et accepter de ne pas savoir». Reconstituer la généalogie des blessures, l’oeuvre du passé. Guetter ce qui reste de lui dans les échos et le prolongement de soi : «On essuie laborieusement les ombres de nos parents sous nos propres pieds». C’est que la mécanique de la répétition peut s’enrayer : «Je ne reproduirai pas les erreurs de mon père et ne chercherai pas d’excuses, De tourmentes pour mon âme, non, Je regarderai dans mes yeux clairs – héritage paternel, Je regarderai les petits rouages – inconscience. Et les ferai sauter. Je ne serai pas prophète de malheur pour mes enfants».
Violette Chalier écrit, en creux, dans des fragments, comment la figure imposée de la masculinité, «ce malentendu» a travaillé son père, et travaille aussi tous ces hommes «qui essaient d’enfiler les costumes de militaires, d’autoritaires, de bons pères». «Je regarde passer les hommes flanchissant, soutenant une masculinité fébrile, qui fait mal, pleins d’ardeur de prouver ce qu’ils ne sont pas». Ainsi, «Y a-t-il du plaisir à être un homme que l’impératif de la domination illumine et illusionne ? ».
L’autrice intercale avec justesse quelques passages où le père s’exprime directement – à chaque fois précédés de la mention «il dit»- comme si ces passages avaient été écrits sous sa dictée, introduisant une forme de contrechamp au point de vue de la narratrice, l’une des deux filles du père, qui lui-même alterne entre le «je» et le «tu». Comme un moyen narratif d’entr’apercevoir l’intériorité du père qui «arpente l’écoulement lent du temps» ou comme une ultime tentative pour ce dernier de s’évader encore, de ne pas se laisser enclore par les seules perceptions de l’autre.
Une traversée de l’intime en poésie, d’une délicate justesse.
«Il y a un lieu étrange
Où le cri pour l’amour
Se cache derrière le repoussoir»

Rust River City
de Joe Daly
traduit de l’anglais par Fanny Soubiran
Editions l’Association
BD
«Ce mec-là, il a une connaissance fine et rare de ce qu’il est, de sa place dans le monde, il sait ce qu’il est dans le monde, et plus important encore, il sait ce qu’il n’est pas.»
Joe Daly empoigne de manière serrée le lecteur de sa nouvelle BD, Rust River City. C’est qu’il n’y a pas d’échappatoire. On suit Dean qui vient de se faire licencier. Il encaisse plutôt mal le fait que son job soit désormais confié à des chinois. Et cette décision ne peut pas plus mal tomber : il est veuf depuis deux ans et a deux enfants à sa charge. Il n’a pas le choix, il se doit d’accepter un emploi sous-payé dans le fast-food local Planet Chicken où il endure les pires humiliations.
Dean est le visage de celui qui lutte en permanence. D’une infortune à l’autre. Chacune de ses embauches ressemble à une embuche supplémentaire. L’âpreté de son existence ne fait pas mystère auprès de ses enfants, l’aîné se proposant même de travailler à son tour pour l’aider.
Dean a fait la guerre du Vietnam, et il semblerait que le syndrome post-traumatique soit toujours agissant. Aussi, il aimerait bien qu’on lui reconnaisse ce passé de GI, mais c’est peine perdu, à chaque fois qui le mentionne, ses interlocuteurs n’en ont que faire. Il n’a droit à aucune considération, excepté celle de Rufus son petit chien. La seule chose qu’un richissime producteur de cinéma est prêt à lui reconnaître n’est pas tout à fait à son goût, Dean a du mal à imaginer devenir acteur de « cinéma pour adultes de qualité », selon l’expression euphémique consacrée. Mais a-t-il le choix de refuser ?
Dean rentre chez lui harassé de ses journées à rallonge, on le retrouve là en position horizontale. Les pages défilent et l’on sent bien que c’est aussi un être empêché, fragilisé qui se carapace derrière cette représentation de brute épaisse, à l’instar de Lenny dans Des souris et des hommes. «Je suis un dur… mais pas tout à fait… parce que j’ai les pieds très délicats et très sensibles… comme des petits petons de bébé… donc faudrait que je me retrouve des souliers pour pieds délicats… ».
Le travail avec les couleurs réalisé par Joe Daly est tellement réjouissant, un jeu avec trois-quatre couleurs se déploie pour rendre lumineuses les planches, embraser Rust River City et ses occupants. Une véritable fulgurance de couleurs qui donne vie aux ombres, à une atmosphère inquiétante et des personnages interlopes qui émaillent le récit. Les personnages paraissent d’une taille disproportionnée, coulés dans le même moule d’inadaptation : il est parfois difficile de faire la différence entre un adulte et un enfant. Les visages tout en rondeur sont uniques, celui de Dean est dominée par cinq proéminences: deux yeux, deux pommettes et un nez, composantes d’un visage expressif condamné à être en permanence interloqué par les situations qui se présentent à lui. Les pommettes saillantes sont comme des excroissances qui rappelleraient combien les protagonistes n’ont de cesse de se cogner. L’ambiance est suffocante et les relents homophobes et conspirationnistes ne manquent pas. Le récit convoque un narratif hyper réaliste tout en donnant l’impression d’assister à la fin d’un monde promis à une implosion prochaine.
Joe Daly n’hésite pas à nous offrir aussi quelques incursions dans le fantastique, que ce soit aux abords de l’institut Nothwoods ou dans cette scène improbable où Bergman, jeune lycéen, ami de Danny, le fils aîné de Dean, s’incruste l’air de rien dans le cours de Mme Benway dans un lycée qui n’est pas le sien. Scène n’étant pas sans nous rappeler un épisode saisissant du livre de Luc Dagonnet, Scarborough.
Bergman pourrait tout à fait incarner une sorte d’avatar adolescent de Dean, tant il semble lui-même et les autres dans leurs interactions avec lui être alignés avec ce que Goffman désignait par le «sense of one’s place». Ainsi Bergman explique : «Les adultes… tu vois… c’est comme si… enfin ils sont juste obligés d’accepter ce que je dis, tu sais… C’est comme si j’avais une sorte de pouvoir sur eux… ou peut-être que juste ils en ont rien à secouer de moi… tu sais… c’est peut-être ça mon pouvoir… quoi qu’il en soit…. en général ils laissent couler, tu vois… J’ai un peu l’impression de me laisser couler dans la vie, en fait… les adultes… juste ils acceptent ce que j’ai à dire… ils sont pas choqués ni même intéressés par moi… donc juste ils vont genre… opter pour la voie de la moindre résistance avec moi, tu vois… et voilà…. c’est comme ça que je m’y prends…. comme ça que je roule ma bosse…». Comme un lointain écho à la figure de «ce mec-là» que semble admirablement personnifier Dean aux dire du producteur de cinéma, «Ce mec-là, il n’est pas là pour prouver quoi que ce soit à personne… sauf à lui-même… il n’est pas là pour tromper qui que ce soit… il ne fait pas semblant… il n’attend rien en retour… et c’est ce qui donne à ce mec-là son aura profonde».
Rust River City est une BD qui fait le plein de rugosités, et vient nous bousculer. Vivement le tome 2 !
«Ces mains, elles servent à bâtir… mais elles peuvent servir à détruire…»

Jours scintillants
de Morgane Bellec
Editions Le diplodocus
« Soleil, je t’aime. »
Morgane Bellec aime « les jours blancs, les jours clairs et les jours chauds », elle aime les jeux de lumière, les gros plans, les arrêts sur image, les instants volés, embrasser du regard un grand paysage ou se concentrer sur de tous petits détails. Nous, on aime cette lecture en suspens, qui nous amène à nous poser, à respirer lentement et surtout à prendre le temps de contempler ce qui nous entoure. Les choses toutes simples et qu’on oublie trop souvent de regarder.
L’économie de mots nous aide à entrer dans cette lenteur. Et surtout, surtout, ses dessins au crayon de couleurs pastels nous font ralentir encore. Ici, on admire les cils d’une jeune fille, les reflets multicolores et l’ombre qui se pose délicatement sur sa joue, comme une caresse. Là, c’est à travers un voile de rideau qu’on entr’aperçoit un jardin fleuri. On sent presque la brise entrer par la fenêtre nous souffler dans le cou. En tournant la page, on se retrouve à la fin d’une journée devant une mer d’huile, le soleil nous chauffant la peau doucement. Puis nous nous retrouvons à hauteur d’insecte, à recevoir « les rayons de soleil tamisés par les feuilles ». Et l’exploration se poursuit, toujours avec autant de sensibilité et délicatesse, laissant apparaître cette jeune fille par transparence à travers des draps qui sèchent et volettent, jeu d’ombres et de silhouettes.
Un poème fait de mots et dessins pour le plaisir des petits et des grands.
« Cette douce chaleur sur ma peau. »
- All
- Gallery Filter
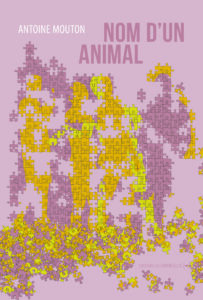
Nom d'un animal
d’Antoine Mouton
Editions La Contre Allée
«Les conversations rebondissaient d’une personne à l’autre. Sur le dos de l’animal que nous formions. Peut-être un âne. L’animal de l’enfance».
Antoine Mouton revient ici avec un cinquième titre publié aux éditions La Contre Allée. Ce texte est composé d’une forme hybride qui emprunte tout à la fois au récit, à la poésie et au témoignage. L’auteur a commencé à écrire ce texte lorsqu’il s’est éloigné d’un emploi salarié de libraire. Il y traite de ce que le travail charrie comme représentations, images, réalités, expressions toutes faites («Et voilà le travail»), mais la proposition excède la seule réflexion autour du travail, on y croise aussi son père, et des considérations établies à partir des présences-absences, des rencontres et d’un dialogue avec soi, par-dessus soi. A ce propos, Bérénice Bichat, dans un des derniers bookclub (émission radiophonique), tenait le propos suivant, «quand on s’adresse à soi-même, on le fait en vers libres», on est donc pas étonné que ce soit la forme prédominante de ce livre.
Le texte résiste à toute entreprise de catégorisation et c’est certainement très en phase avec ce que l’auteur annonce d’emblée «je chéris les espaces où je suis sans fonction». C’est que l’auteur nous parle, comme à partir d’un ancrage impossible (« Si on me demande d’où je viens, je suis embêté car je ne suis pas né ailleurs ni très loin, et pourtant je n’y suis pas resté ») de plusieurs endroits à la fois («il y a des endroits où je suis partout»), de plusieurs lieux («j’ai vu le monde de plusieurs intérieurs, de mille hublots. J’ai toujours tout recommencé repris souffle et socle touché terres »). Il le fait à partir de son monde à lui, en cultivant une distance, « entre le monde et moi, de l’air, de l’eau, du langage» et à partir de plusieurs personnes (procédé rendu possible par l’insert de témoignages qui émaillent le récit). A partir de son enfance aussi (« quand on me demande d’où je viens, je réponds : d’enfance »).
Le travail s’avère être vite insaisissable («le travail m’est tombé des mains, où avais-je la tête?» ; «Comme si le seul véritable travail avait été d’enfouir et perdre trace »), mais qu’importe, Antoine Mouton n’aime rien tant qu’entrer dans les mots, s’engager à travers eux (« langage m’engage, me dis-je »). Un tritureur des mots, «je voudrais dire chaque jour le même mot, et observer l’infime mouvement qui le broie, le déplace, le condamne ou le sacre. Lancer ce mot à travers un récit, pour voir ce qui lui arrive d’inattendu. Comme il se plie, résiste, se modifie. Comme il tombe en désuétude. L’accompagner. Changer avec lui ».
Explorer, « au fond du temps » leurs contours, leurs fissures, leurs accords, leurs écarts, leurs égarements, leurs débordements, leurs désuétudes, leurs «au-delà». C’est ainsi qu’en retournant le travail comme une pierre, il retrouve trace de son père («si j’avais soulevé le mot travail, j’aurais trouvé mon père. Mon père vivait sous le travail. Quand il rentrait à la maison, on ne le voyait pas. On voyait que le travail»).
Antoine Mouton semble plus de celleux qui entretiennent une distance amusée avec cette affaire de travail (« Ce que je préfère dans le travail, c’est d’en chercher un qui m’irait. Pourvu que ça ne m’arrive jamais. En fait je cherche un travail, mais ce n’est pas vrai »). On ne se l’imagine pas se faire des shoots aux phéromones du travail, et pendant son auscultation du mot travail, il s’allonge dedans, «question de patience et d’attention».
Il positionne ici et là des bribes de questionnements, sans cesse à recommencer, ouverts sur la reprise : « Quand tu poses une question à une question, ça s’ouvre ». Tel un funambule, il aime « rester en suspens au-dessus des surfaces », histoire de se jouer des cases. Débusquer les pièges : «grand égarement, la langue. On attend l’inouï. Mais le quiproquo a pris sa place».
Loin d’une leçon de chose qui ferait un détour par le tripalium, Antoine Mouton s’attache à faire dégorger le mot, rendre compte de ce que le travail fait faire, fait dire ou fait taire. A l’instar de ses amis «burn-outés» : «Le mot burn-out a privé mes amis de leur histoire. Ils disaient : j’ai fait un burn-out, et rien de plus. Ils n’entraient pas dans les détails. (…) J’ai l’impression que les gens qui se servent de ce mot sont en réalités employés par lui pour en faire la promotion. Qu’ils se mettent au service d’un phénomène, sans plus pouvoir atteindre ni nommer l’endroit en eux que le désastre est venu toucher.»
Le texte est également émaillé de réflexions sur le temps, «On n’est pas sûr de percevoir le temps dans l’ordre. On suit des lignes karstiques, brisées » ; le temps qui passe, qui court, qui saute, qui creuse, qui comble, il faudrait « se détacher du temps, entrer dans la durée. Flotter par-dessus la vie ». Le temps qu’on ne rattrapera pas : « quand j’ai compris mon père, c’était trop tard. (…) Je ne prendrai jamais mon père dans mes bras ».
Et cette réflexion qui affleure autour de la transmission du nom de famille, de la filiation, ce nom irréductible aux histoires de Panurge, d’Abraham, d’Ulysse. « Pas facile d’être un mouton particulier. Pas facile non plus d’être parmi les humains et pas seulement à part ou à côté ». Antoine Mouton prête attention aux noms qu’il donne, mais aussi au nom qu’il n’a pas choisi, qu’on lui a donné, à la naissance, qui lui a été transmis «Je porte le nom d’un animal, mais c’est d’abord celui de mon père » et qu’il transporte avec lui : «Je porte un nom. Je le trimballe à travers la vie ».
Quelques mots pourraient permettre d’esquisser l’entreprise à laquelle se livre, l’air de rien, Antoine Mouton : à partir du nom qui lui est propre et du mot travail, dessiner en poésie des figures communes, parler des gens, de ce qui ne va pas, nous faire réagir, nous faire sourire. Faire des liens, en toute singularité. Nous percuter comme la météorite avec Ann Hodges. Les idées sautent comme un mouton, et on rebondit avec. Ce texte est particulièrement réussi !
«Par l’écriture
je voudrais me débarrasser de la honte
pour me charger de la douleur.
Rétablir les circulations d’une peine à l’autre
-qu’une tristesse vienne en éclairer mille autres.
Et qu’aucune ne s’impose contre celle des autres.
Qu’aucune blessure ne cherche à se hisser sur la pointe des pieds,
comme un ministre trop petit».

Une histoire d'ours
d’Eowyn Ivey
traduit de l’américain par Jacques Mailhos
Editions Gallmeister
« La cabane derrière elle était désormais chaude et domestiquée, et devant elle c’était la forêt froide et sans fin, la nuit durant laquelle Arthur avait disparu. »
Une histoire d’ours est une histoire d’ours mais surtout d’humains. Il y a Birdie, jeune femme un peu fantasque qui vit en Alaska avec sa fille Emaleen. Sa vie de serveuse ne l’épanouit pas vraiment. Elle ne se sent pas à sa place et rêve de nature, d’évasion, de changement. Emaleen, 6 ans, vit dans les histoires qu’elle invente avec Thimblina, petit être vivant caché dans un dé à coudre qu’elle porte toujours avec elle (« elle ne savait pas exactement à quoi Thimblina ressemblait. Peut-être à une libellule, mais sans les gros yeux effrayants et les pattes épineuses, ou peut-être à une fée avec des ailes de papillon et sur le front, de longues antennes très fines »). Il y a aussi Della, la patronne de la Wolverine Lodge qui emploie Birdie, qui joue un peu la confidente, un peu la grande sœur. Syd, un brin philosophe. Et puis Arthur, cet homme taciturne, mystérieux, qui passe de temps en temps mais vit surtout dans la montagne. Arthur a quelque chose de particulier qui attire Birdie, il n’est pas comme les autres clients qui prennent bière sur bière ; lui boit de la tisane, a une présence spéciale, animale. L’attraction opère entre eux et Birdie décide de partir avec sa fille vivre avec lui au milieu de la forêt. Mais qui est vraiment cet homme qui connaît le nom de toutes les plantes en latin, semble marcher sans jamais se fatiguer, ne vit que dans le présent ? « Chaque chose, chaque temps, tout ça, c’est maintenant » ; « je dis que tous les temps, tous les possibles, sont maintenant. »
Il paraît aussi qu’un ours rode dans cette forêt et qu’il faut s’en méfier.
À la lecture, on pense à La Pommeraie, lu dernièrement, pour le rapport fusionnel entre une mère et sa fille, isolées de tout, en harmonie avec la nature, et pour la fraîcheur de pensée de l’enfant, si proche d’Emaleen.
On pense forcément aussi aux Mangeurs de nuit de Marie Charrel, à cette femme griffée par un ours blanc et celles qui se camouflaient sous des peaux d’ours. Il y a cette même tension entre attirance et crainte de l’animal, ce même rapport à la nature, ce même besoin tout à la fois de lien et de solitude.
Un roman qui vous prend et vous emporte à des milliers de kilomètres, au cœur d’une nature sauvage et magnifique.
« Que se passerait-il s’il n’y avait plus rien de sauvage ni d’effrayant dans les bois ? Ça ne serait peut-être pas si chouette de se tenir à la lisière des arbres. »

Sangliers
de Lisa Blumen
Editions L’employé.e du moi
«Mais c’est la vraie vie, internet aussi !
T’as beau faire des vidéos de qualité et être intègre,
si t’as que 1000 abonné.e.s, ça payera pas le loyer»
On avait aimé l’univers de science-fiction qui ressortait de sa précédente BD, Astra Nova, avec déjà un travail de couleurs formidable, c’est peu dire qu’on attendait la nouvelle BD de Lisa Blumen. Ici, on est dans tout autre chose, pas très loin des dérives que dépeignait Delphine De Vigan dans Les enfants sont rois. Là aussi, il est question de unboxing, mais pas seulement. L’autrice nous fait toucher du doigt le quotidien d’une influenceuse, Nina, par ailleurs, MUA (make up artist), comprendre, maquilleuse professionnelle. Quotidien codifié par l’image et l’apparence.
Nina est très suivie sur sa chaine ‘ninamakeup’, elle doit en permanence proposer des contenus (filmer sa morning routine), faire des tutos, répondre aux sollicitations de ses sponsors de l’industrie cosmétique, quand ce n’est pas à celles, insistantes, de son agent qui est du genre à lui mettre la pression (« Atterris, bordel ! Si tu veux rester dans le milieu, faut que tu prennes tes responsabilités et que tu bosses même si t’as pas envie ! »).
Elle est aussi suivie par un homme à capuche qui semble zoner devant chez elle. Un stalker et Nina a beau essayer de se persuader qu’il ne lui veut rien de mal («Il est juste… passif. Il ne veut pas interagir avec moi, il ne cherche pas à me parler, ni à me toucher, il veut juste regarder»), la récurrence de sa présence finit par l’insécuriser et devenir malsaine. Mais cette présence qui ne se cache pas, n’est pas sans lui rappeler les autres personnes qui la scrutent et qu’elle ne connait pas : « C’est un peu comme ceux qui regardent mes vidéos, sans jamais commenter ni s’abonner. Ce sont juste des présences invisibles et muettes qui me scrutent. On dirait des fantômes ». Certaines présences ont beau être virtuelles, le jour où Nina se réveille avec plus aucun contenu sur ses comptes, plus aucune follower, c’est la catastrophe.
Nina est aussi confrontée à des dilemmes moraux : on l’incite à faire de la publicité pour un mascara, produit qu’elle ne valide pas du tout («je ne sais pas si t’as lu la composition, mais c’est une usine pétrochimique, le truc !») et pourtant, contractuellement, elle se doit d’en parler favorablement. Nina doit donc se dépatouiller avec tout ça, et c’est aussi ce qui force l’admiration du personnage.
De tout cela nait une profonde solitude, qu’elle rompt tout juste lorsqu’elle voit Uma, l’ingée son, qu’elle a rencontrée sur un tournage et avec laquelle une complicité nait.
Cette BD dépeint avec force un sujet quelque peu délaissé par la fiction, celui de la marchandisation de la beauté féminine combinée à la violence de l’exposition médiatique. Le récit est également émaillé de scènes où on la voit de plus en plus exposée à des micro-agressions et à des formes de sexisme ordinaire.
Lisa Blumen manie avec brio, aux feutres à alcool, le pantone rose, en jouant sur les continuum de cette couleur.
Et le sanglier me direz-vous ? Sa présence dans le titre, mais aussi, l’air de rien, sur un tableau suspendu dans la boutique où elle va faire réparer sa caméra, ou encore en fin de BD vient brouiller les pistes. Le sanglier sème le trouble, vient enlever un peu de rose à l’histoire. A la fois hallucination et chimère, il incarne cette présence menaçante, beaucoup moins évanescente que le spectre de tous ces regards insaisissables (à commencer par le fils d’Uma) qui décortiquent et commentent les posts quotidiens de Nina Makeup. Nina ne serait-elle pas celle qui en vient à être traquée comme l’est le sanglier ?
Une BD qui vise juste et qui gagne à être mise dans beaucoup de mains.
« On te demande juste d’être jolie et divertissante. »
- All
- Gallery Filter

Toutes les époques sont dégueulasses
de Laure Murat
Editions Verdier
«Doit-on réécrire nos livres pour ne pas offenser les sensibilités ? »
Pas facile d’écrire sur ce petit livre alors qu’il bénéficie déjà d’excellentes critiques. Il y avait comme une urgence à m’en saisir et c’est tant mieux que cela ait agi comme tel.
Rappelons que Laure Murat est professeure à l’UCLA, pour dire que de sa place elle entrevoit bien de quoi il en retourne de ce qui fait office de «guerres culturelles» ou du « politiquement correct »
Très vite le ton didactique est donné : l’autrice nous invite à une éclairante et salutaire distinction entre ce qui relève de la réécriture, « pour réinventer à partir d’un texte existant, une forme et une vision nouvelle » – elle aime à citer en la matière Sacrées sorcières de Pénélope Bagieu et le livre à paraître en français de Percivall Everett, James ; et ce qui relève de la récriture, «pour désigner tout ce qui a trait au remaniement d’un texte à une fin de mise aux normes sans intention esthétique ».
«La récriture n’est pas une fausse bonne idée. C’est une vraie mauvaise idée, qui ouvre la voie à tous les abus. Car jusqu’où remonter dans le temps et sur quels textes intervenir ? Pour corriger quoi ? »
On comprend mieux là où les récritures se perdent quand on suit les exemples que convoquent Laure Murat : Agatha Christie, Roal Dahl, James Bond. Ces récritures, ou « nettoyages approximatifs » paraissent plus relever de la cosmétique (d’une « demi-mesure »), en changeant le titre ici, euphémisant un terme là, alors que toute l’économie du texte, l’intrigue dans son entièreté continue à faire le lit de stéréotypes sexistes, racistes ou antisémites, c’est selon. D’autant que certaines indignations restent sélectives : on ne trouve guère de pourfendeurs de Game of thrones alors qu’on n’est pas loin d’assister à un viol et un inceste par épisode.
Finalement, ces entreprises de récriture, d’ « arasement » seraient plus conduites pour se conformer à des canons marketting, faire en sorte que l’œuvre puisse continuer à « correspondre aux attentes des nouvelles générations ». Ce faisant, ces aggiornamentos opportunistes permettraient surtout de préserver la « valeur lucrative » des œuvres concernées. Sans compter qu’il s’agit aussi d’une attaque en règle de la littérature, dans la mesure où «seul l’auteur devrait être en droit de modifier son texte».
L’autrice revient aussi tout à fait à propos sur la controverse qu’il y avait eu sur le recours aux sensitivity readers. Elle indique en quoi Kevin Lambert avait eu, s’agissant de la littérature contemporaine, complètement raison d’en revendiquer le recours.
Laure Murat rappelle tout l’intérêt du travail de contextualisation (via les préfaces, postfaces et autres notes de bas de page) : « la préface est le dispositif idéal pour mettre de l’intellect à la place de l’affect qui brouille les meilleurs esprits, et fournir des outils capables de transformer la souffrance et le ressentiment des gens ciblés en objet de réflexion ».
Laure Murat, par la force des exemples convoqués, la rigueur de son argumentation, réussit parfaitement à remettre un certain nombre de choses à leur place, ou les pendules à l’heure, c’est selon, et sans pour autant «penser contre son camp».
«Que faire avec ces œuvres populaires mais qui ne répondent plus à nos critères et diffusent des stéréotypes dont il est plus que jamais nécessaire de se débarrasser ? »

J'étais dans la foule
de Laura Tirandaz
Editions Héros-Limite
poésie
«Tous les arrondis des visages
Il ne reste que des présences
trouées de lumières
Inscrire le destin de chacun
de chacune
sur ses traits».
Faire de la ville une expérience, une innocence : s’anonymiser dans la foule, traverser les espaces, scruter l’infinité des visages («une femme visage ouvert», «visage de prophète», «visage à court-circuit», «visage serrure»). Au croisement de l’urbanité : les corps passent, l’époque aussi : « sur les quais, dans les rues éclaboussées, lumière urine, Une existence comme une pièce à décorer ».
Laura Tirandaz explore ce paysage minéral, ce « décor mélancolique », écoute (le «bruit des pas trop harmonieux pour ne pas être une menace », « le bruit de ma pluie », les « voix étouffées dans le nid de la gorge »), regarde, regarde encore et rend compte de ses observations urbaines «la ville dessine de nouveaux traits, quelques millimètres de drame intime». Des observations qui se font au niveau du sol, des pieds (« un vêtement à terre », « on s’est mis à ramper » ; « la peur roule jusqu’à son pied ») comme pour mieux appréhender les dénuements des lieux, des êtres («le café froid auquel il se résigne, un fond de nuit, Quelqu’un à qui on a enlevé la peau et les verbes »).
Elle nous offre une traversée poétique, d’un déplacement à l’autre. Jeu de rapprochement : «Nous nous sommes croisés qui avait avalé quoi ? Qui envahissait le rêve de l’autre ? Nous avions la même insomnie, la même honte ».
Et si c’était dans ces interstices d’urbanité que l’autrice reconfigurait son propre paysage, «à espérer que les lignes se séparent pour un plus bel espace».Tout en se méfiant des béances et de leur attirance ambivalente (« le goût des portes qui feraient mal»), et de se rappeler de la nécessité de s’agripper pour ne pas tomber (« si tu pouvais me coudre une main »)
La nuit, toujours à portée de paupière, n’en finit pas de s’étirer, favorable aux «lianes du sommeil» et au travail des souvenirs.
Une poésie qui se fait l’écho de réflexions qui se situent dans les bruissements et l’expérience de la solitude, comme pour mieux questionner l’identité et de quoi se compose le collectif. Une poésie qui participe, avec son jeu de contrastes, à faire de cette expérience subjective, propre à l’autrice, une expérience sensible où le lecteur peut se reconnaître et aimer se perdre à la fois.
«S’organiser pour laisser
aux matins blancs
un dernier message
une douceur d’ortie
le temps d’apparaître»

L'éveil de Tirésias
de Camille Bordes
Editions La Boite à Bulles
« Dis donc, depuis quand être une femme serait une punition ? »
Camille Bordes s’était penchée sur l’histoire de Tirésias lors de ses recherches en histoire des arts sur les représentations symboliques des serpents dans l’antiquité. Ecrire et illustrer une BD sur cette histoire mythologique lui permet également de traiter de la question de genres qui l’intéresse particulièrement.
Tirésias, c’est ce célèbre devin aveugle de Thèbes. Mais qui connaît ses métamorphoses ? Camille Bordes choisit de développer cette partie de sa vie, autrement dit du moment où il voit Athéna nue et se voit transformé en femme jusqu’à sa rencontre avec Zeus et Héra où il deviendra aveugle et devin. Entre temps, il (ou plutôt elle) doit s’habituer à son nouveau corps. Pour cela, elle est accompagnée de sa mère Chariclo, avec laquelle elle s’exerce à un jeu de poste botanique, et d’un groupe de jeunes femmes. Elle découvre ensuite cette force de vie interne par le biais des règles, du plaisir sexuel avec Hermès et de la maternité. Mais lorsque certains évoquent deux apparences et identités successives, Tirésias insiste sur le fait qu’il n’en est rien, elle est bien toujours la même. «Et crois-moi, enfermer hommes et femmes dans des rôles étriqués est une erreur. Je pense qu’il existe justement une infinité de façon d’être. Et pas seulement deux ! »
Au bout de sept années elle redevient homme et Zeus et Héra en profitent pour le questionner sur le plaisir masculin et féminin. Sa réponse offusque Héra qui le prive de la vue. La suite étant davantage connue, Camille Bordes préfère s’arrêter là. Ainsi, elle se concentre sur ces quelques années de transformation et d’initiation au monde féminin.
Pour servir cette histoire, elle peint les illustrations à la peinture à l’huile dans un jeu de couleurs pastelles amenant des ambiances parfois oniriques, parfois très réalistes (on en ressentirait presque la chaleur du soleil). Et c’est dans ces alternances que les couleurs opèrent au plus juste. On prend d’ailleurs toute la mesure de ce travail des couleurs lors des pleines pages qui jalonnent le récit.
L’ensemble est doux et délicat. Même les serpents ne sont pas très menaçants, au contraire, l’un d’entre eux (jaune tacheté de rouge) vient régulièrement converser avec Tirésias.
Le récit invite à faire des liens avec d’autres histoires de déesses et de dieux, c’est comme un défilé de divinités qui se présentent à nous, avec pour certains passages de vrais approfondissements proposés (cf. Caenis qui devient Caené). En refermant ce livre, histoire de poursuivre cette incursion dans la mythologie grecque et Tirésias, on a envie de reprendre certaines lectures : celle de Jean-Pierre Vernant, comme L‘univers, les dieux, les hommes, le recueil de Kae Tempest, Etreins toi, ou encore la BD de Séverine Vidal et Marion Cluzel Le seul endroit.
Camille Bordes parvient à travers ce récit initiatique à aborder, de façon renouvelée, la question de la fluidité des genres et des personnes transgenres et sans que cela ne se pose, avec gravité, en terme de problématique. Une première BD particulièrement réussie.
« J’ai été métamorphosé par une déesse. J’ai été femme, mère, amant d’un dieu et, pour couronner le tout, me voici désormais aveugle ! »
- All
- Gallery Item

Quand viendra l'aube
de Dominique Fortier
Editions Grasset
«Ces jours-ci, le plus souvent, je suis heureuse par éclairs. Ils durent parfois quelques minutes et parfois des jours. Le reste du temps, je suis inquiète, soucieuse, impatiente, souvent tout cela à la fois. Je ne suis pas sûre de croire au bonheur comme à un état habitable à long terme.»
Tout d’abord, la couverture du livre interpelle… On y voit un oiseau, des surfaces à l’aquarelle dans différentes teintes de bleu, quelques lignes. A mieux y regarder, on peut voir un deuxième oiseau et peut-être que certains traits sont des gouttes de pluie qui tomberaient de nuages. Et puis c’est un petit format d’une centaine de pages… Un petit livre d’art ? Un livre jeunesse (ou plutôt de ces albums qui peuvent être lus à partir de l’enfance mais conviennent tout aussi bien à des adultes) ? Je dirais qu’il s’agit d’une forme d’art, celle d’agencer les mots et de faire apparaître des mondes, il n’est pas pour la jeunesse mais parle de la jeunesse de l’autrice et de celle de son père, et même s’il n’est pas à proprement parler un livre de poésie, celle-ci est partout, à chaque page.
Dominique Fortier nous parle d’elle, de son père qui vient de mourir, des paysages qu’elle aime parcourir, des auteur.ice.s qui la touchent (Leonard Cohen, Emily Dickinson, Rebecca Solnit, Sartre, Camus, Orwell, Ronsard, Bobin et bien d’autres). Une succession de très courts textes, des pensées posées sur le papier, provenant du « bout de fil de l’écheveau où s’emmêlent cet été rêveries, regrets et souvenirs », « ces souvenirs que j’égrène une goutte à la fois ». Il est question de nostalgie et de manque, et de bleu car « le bleu est la couleur du manque et de l’ailleurs, de ce qui se dérobe. C’est la couleur de la nostalgie. »
Au fil des pages, le bleu et toutes ses variantes viennent se diluer dans le ciel (« d’un bleu très pur, d’une beauté absurde, allant de l’azur jusqu’au céruléen »), l’eau (gouttes, pluie, océan, flaque, fleuve,rivière), la lumière (« clarté bleutée »), jusque dans les textes de Rebecca Solnit que l’autrice convoque dans un large extrait.
Ne vous reste donc plus qu’à ouvrir ce récit tout en retenue. Et surtout prenez votre temps de le lire. Vous pouvez d’autant plus vous le permettre qu’il est relativement court. Alors, prenez le temps de laisser imprimer chaque mot sur votre rétine. Laissez-les se transformer en images, en idées, en temps suspendu. Ils viendront à n’en pas douter résonner avec vos pensées et peut-être même certains de vos souvenirs.
« Je me réveille à l’aube avec cette scène au bord des lèvres, au bord des cils, au bout des doigts, en tous cas il faut me dépêcher de la raconter »

La magie du burn-out
de Lisette Lombé
Editions Le Castor Astral
«Habille ton regard de la lumière des poétesses. (…) Vois comme le ciel t’appartient. Sens comme ton cœur bondit dans ta poitrine et ne demande qu’à être respecté».
10 ans après, s’adresser à des semblables sous forme de lettres, aux burnies («camarades de fatigue») et parler de son expérience du burn-out, tel est le programme de Lisette Lombé. L’adresse est soignée, il faut dire qu’elle a été travailleuse sociale et est reconnue désormais comme poète. Des lettres avec tout plein de post-scriptum pour dire sa trajectoire d’entrée et de sortie du burn-out, par où elle en est passée pour dépasser les «bornes poussières» et se rendre sur l’autre rive, tout en convenant que «la rémission n’est pas synonyme de guérison». Le tout avec une grande honnêteté, avec aussi cette conscience aiguë du «privilège que j’ai de pouvoir transformer mes émotions en objets artistiques» ; «ma capacité à capturer ma colère et à la transformer en textes porteurs d’espoir».
Revenir sur ce «voyage souterrain», sur comment elle a pu longtemps passer à côté des signes avant-coureurs («inaccessible aux sirènes de mon éreintement» (…) «je carbure aux trompe-l’oeil», «j’étais tellement diminuée que j’ai laissé cette remarque de ma responsable s’insinuer en moi comme un poison et attaquer mon estime»), jusqu’à la paralysie et cette prise de conscience tardive : «Vital que je cesse de mensonger, de m’irrespecter, de m’épouvantailler en vain! Je veux redevenir moi! Je ne veux pas crever en derviche mécanique, clouée à une danse de fourmis ! Je veux redevenir moi !». L’autrice renseigne tout en précision ce qu’il en a été de «l’entrebâillement des impossibles», comme une façon de cartographier les fragilisations et moments de fatigue, les différentes dimensions du burn-out («la vase communicante s’épanche à toutes les cachettes de mon existence»), comme pour mieux être «capable de reconnaître les symptômes avant de replonger dans le rouge».
Ce qui compte, selon Lisette Lombé, ce n’est pas tant la déflagration mais ce qu’on en fait. Comme un écho au livre paru aux éditions Eres, Réussir son burn-out (sous la direction de Corinne Le Bars). «La magie du burn-out est de nous pousser dans nos retranchements (…) de nous jeter dans des buissons de ronces dont les épines nous égratignent comme autant de piqûres de rappel de nos aspirations profondes».
Elle incite «les bonnes personnes qui ont tendance à oublier qu’elles sont de belles personnes» à s’essayer à une série d’exercices qui pourraient s’apparenter à du développement personnel sans se ranger parfaitement sous cette étiquette, via des questionnaires, des exercices d’écriture ou de créativité, via de «l’auto-louange»… Et surtout, elle rappelle l’importance qu’a constitué le recours au collectif, à sa «tribu organique» (Lisette Lombé a créé le collectif L-SLAM) dans sa guérison : «qu’elle est douce cette communion de fragilités apprivoisées». Lisette Lombé remet donc au centre l’importance de ce que Hartmut Rosa qualifie d’ «oasis social de résonance» : «C’est cette capacité à faire corps collectif qui sauvera nos propres carcasses, j’en suis convaincue». En outre, elle n’oublie pas, dans un exercice facétieux auquel elle se livre à la fin, et intitulé, «carte d’identité poétique», de rappeler ces multiples naissances, et ce jour où elle est devenue slameuse.
15 missives comme autant de tentatives de comprendre ce que le burn-out signifie pour soi et pour les autres, comme 15 heureuses tentatives pour, comme diraient Viviane Châtel et Marc-Henri Soulet «faire face et s’en sortir». Un livre tout à fait utile.
«On pourrait dire qu’il y a un avant avant burn-out et un après après burn-out».

Plus loin qu'ailleurs
de Chabouté
EditionsVents d’Ouest
BD
«J’ai rêvé de partir, j’ai été contraint de rester… alors je suis parti en restant».
Alexandre Bouillot travaille la nuit, il est gardien dans un parking. Il a depuis de trop nombreuses années une «vie de hibou», «je ne fais que passer à côté de tout». Les grands espaces, les sensations fortes, il les vit par procuration, en lisant Indian Creek de Pete From ou Construire un feu de Jack London. Il est décidé à partir faire un trek en Alaska. Mais rien ne se passe comme prévu, le voyagiste avec qui il devait partir a fait faillite, le vol est annulé. Il se demande alors ce qu’il pourrait bien faire.
Son corps parle pour lui, une belle entorse va l’immobiliser 6 semaines. C’est alors qu’il décide de voyager au pied de son chez lui. Pour ce faire, il loue une chambre, en face d’où il habite. Et il s’emploie à remplir un carnet de voyage. Et à partir de ce lieu, il prospecte, observe inlassablement. C’est que le dépaysement peut aussi opérer tout près de là où l’on habite.
Ses béquilles l’obligent à faire attention où il marche. Le contraignent à prendre son temps. Ou comment faire de nécessité vertu. Il recueille ce qu’il trouve, les objets délaissés, les restes d’un passage, les emballages abandonnés, les listes de courses perdues, «des petits bouts de vie». Il rassemble des éléments hétéroclites dans son carnet de voyage. De cette collection-transformation nait une réflexion qui le saisit au vif, l’exhorte à «reconsidérer le négligeable». On fait le rapprochement ici avec le livre de François Dagognet Des détritus, des déchets, de l’abject. Une philosophie écologique (éd. Corti) ou encore au très beau livre de Gaëlle Obiegly, Sans valeur (éd. Bayard).
Se dessine alors le nouveau programme de notre protagoniste : «réapprendre à regarder. Vois à nouveau tout ce que le routinier et le familier ont largement filtré, mis de côté, élagué».
C’est à partir de ces micro-observations que les premières couleurs de la BD affleurent, les fruits, les étals, les panneaux signalétiques, le ciel, les vêtements. A partir de ce moment-là qu’en plus de leur donner vie dans son carnet, le contemplateur apporte à coup de craies de menues transformations à la ville, à l’instar du street art, conférant ici ou là une forme de poétique aux messages urbains.
C’est qu’il s’en passe des choses au pied de chez soi, aux «quatre coins de sa rue». Et des choses qui passent inaperçues pour beaucoup pour peu qu’on soit happé par son téléphone, par son quotidien. Alexandre s’assoit sur un banc qu’il partage avec un SDF, lequel en tant qu’ancien botaniste en sait un rayon sur les plantes sauvages des villes, mais aussi, sur la vie de notre contemplatif. Alexandre comprend ainsi qu’avant de devenir observateur il a été observé.
Des dessins en noir et blanc comme aime s’y consacrer Chabouté, avec ici une forme de mélancolie, de sensibilité tout entière saisie dans la fragilité de l’instant présent. Ravissant.
«Se nourrir délicatement de chaque situation, de chaque événement, guetter chaque détail, cueillir des yeux chaque instant. Apprivoiser le temps, le freiner, l’arrêter, valser avec le futile et l’insignifiant».
- All
- Gallery Item

Une marche à soi
de Christophe Pellet
Editions L’Arche
«De nulle part et de partout,
à la recherche d’un nouveau lieu,
d’une nouvelle vie».
Christophe Pellet a fait la Fémis et est réalisateur. Cela se voit nettement à travers sa manière d’écrire où se détache des voix et des images situées, avec une mise en porosité sans cesse renouvelée entre réalité et virtuel.
Le récit trace, en vers libres, une reprise en main de soi à travers la marche. «Une marche, simplement. Antalgique, marginale et improductive». Avec la ville comme traversée, comme décor, comme contact («la ville, mon corps, enlacés dans le même mouvement»), comme lieu où se perdre. Une ville multiple et générique faite d’un peu d’Athènes, d’un peu de Rome, Paris et Berlin.
C’est qu’il en faut des détachements pour s’extirper de ses assignations, se déprendre de ses enfermements. Exit le boulot, exit l’être-aimé-emmuré, exit «le monde écran». Puis se reprendre, se recentrer, retrouver son rythme, se ré-appartenir, ré-apprendre à voir («Le regard n’est pas arrêté, tes yeux t’appartiennent à nouveau, ils ne sont plus captifs, ta marche les guide. Elle suggère tes impressions»), ré-écouter sa voix, se reconnecter à soi, à son propre flux, à son enfance, se reconstituer un paysage. Ne plus s’oublier. Se remettre en état de marche : «ma tête se désemplit, ma marche me désencombre. Mes pas sont ceux, premiers, du nouveau-né».
Christophe Pellet propose une variation autour de l’être aimé, du courlis cendré, de la ville et de l’estuaire un jeu de combinaisons qui nous fait penser irrésistiblement à Eva, Piotr et Tom que Perrine Le Querrec, fait évoluer au sein d’univers parallèles (in Les pistes, éd. Art et Fiction).
Et puisque «notre chambre à nous, du côté de la Silicon Valley, on nous l’a dérobée : la chambre à soi, elle n’existe pas», c’est à travers le mouvement de la marche («une marche à soi, c’est encore possible ») que des prises de conscience agissent : «Et je prends conscience, voilà ce qu’a été ma vie : prisonnière d’un sous-sol obscur traversé d’un mouvement constant et imposé (…) Ne jamais faire un pas de côté. Longtemps j’ai fait du surplace dans le néant». Ces incursions, remises en perspective, ne sont pas sans nous faire penser au roman Palais de verre de Mariette Navarro (éd. Quidam). L’auteur entretient à dessein le trouble, se moque d’une vision trop unidimensionnelle : qui de la narratrice ou du courlis cendré sauve qui ? Qui de la narratrice ou de l’être aimé a possédé l’Autre ?
Et à la fin du texte, l’être-aimé-quitté s’incruste dans la fiction, comme une façon de nous rappeler combien la transformation reste fragile, combien l’empouvoirement peut rapidement s’atrophier. Un antidote à une croyance par trop magique en la force de l’écriture («l’écriture ne peut rien») sous couvert de revirement.
Un texte qui fait habilement jouer ensemble les différents points de fuite de la narratrice. A lire et pas forcément en marchant.
«Ô cruelle douceur des temps, sur la ville et l’estuaire il descend. Sur l’être aimé, sur le courlis cendré, il descend».
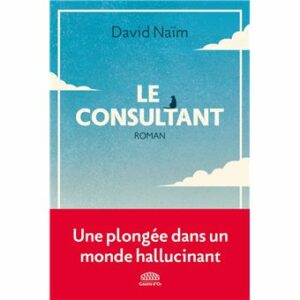
Le consultant
de David Naïm
Editions Goutte d’Or
A paraître le 14 mai 2025
«Simon souffrait incontestablement d’un cancer de discernement stade 4»
Simon Maïmonide est consultant et ça se sait. Il adore prêter attention à sa présentation de soi lorsqu’il rencontre des collègues de sa femme prof. Il adore impressionner, même si souvent il n’impressionne que lui-même. Pour beaucoup de ses collègues, il passe même pour cruel. Qu’importe, il s’emploie à progresser dans la hiérarchie d’un cabinet de conseil international. Sa course n’est pas même ralentie par le burn-out qu’il fait peu de temps après son intégration dans sa firme, ni par les quelques couleuvres qu’il se doit d’ingérer (à l’instar du management par l’empathie). S’il doit se départir de quelques low-performers c’est que ça fait partie du jeu après tout. C’est qu’il aspire à grand, toujours plus grand, il rêve d’une villa XXL au Cap Bénat. Promu « associé », il n’utilise plus que les files Sky Priority, est devenu membre Gold chez Air France, et après être devenu le directeur de ConsoTech, fruit de la fusion de deux directions concurrentes, et avoir retouché son profil LinkedIn, il fait partie du club très resserré des Highly Compensated Partners et touche enfin le graal lorsqu’il est invité au Leadership Summit à Abou Dhabi.
Simon est agaçant de par son arrogance mais sa stature de « perdant magnifique » en fait aussi un être attachant. C’est qu’il multiplie les maladresses auprès de son entourage et une entreprise interne florissante de déni semble prospérer. C’est qu’il ne comprend pas qu’il ne se souvienne pas, mais alors pas du tout, d’un certain nombre de situations préoccupantes. Le cancer de sa mère, les conditions de sa rupture avec Judith.
Simon connait par cœur les acronymes, spécifications et autres ponctuations de la novlangue du consulting. («Une ponctuation, un et à la place d’un ou, c’est grâce à ces détails qu’on convainc. Les chiffres, les raisonnements ne servent qu’à établir les fondations pour y croire, pas la croyance elle-même. Pour ça, il fallait ce que Simon appelait «le coup de polish Roland Barthes », en hommage au sémiologue»). Il joue avec les tips et méthodes toutes faites, les 3-6-9, les 3C, il structure sa pensée en bullet point, rédige des slides (moins il y en a mieux c’est), élabore même son propre concept, celui de management exponentiel. Il adore résoudre des problématiques organisationnelles à haute densité de complexité. Il pense «out of the box», sait suspendre son esprit de loyauté quand il faut, serpente entre ses supérieurs, Jean-Claude, Marieke et la big boss Athena.
Ce roman pourrait relever de la non-fiction tant certaines séquences, pourtant d’un cynisme sans nom, paraissent vraisemblables, du fait aussi que son auteur est lui-même consultant (mais qu’attend il pour être écrivain à temps plein?) et donc particulièrement renseigné sur les logiques à l’oeuvre dans ce secteur. Ce livre m’a fait penser à celui de Vincent Pettitet Les Nettoyeurs (ed JC Lattès paru il y a déjà 19 ans), on y retrouve la même exploration satirique des arcanes du consulting, et avec une montée en généralité autour de l’absurdité d’une approche purement quantophrénique et de ces machines à évaluer que sont les bureaux de consulting. Une même insolence se dégage quant aux habiletés à l’oeuvre pour domestiquer les clients pourtant donneurs d’ordre. Mais aussi une restitution assez bluffante de l’esthétisation de la puissance à l’oeuvre dans ces milieux (avec la force des images, de la bonne formule pour rafler la mise, à l’instar de sa référence à Rauschenberg qui permet à Simon de remporter un important marché).
Ce qui fait que ce roman n’est pas un énième roman à charge contre cette forme de « bullshit job », pour reprendre l’expression de David Graeber, c’est qu’il y a énormément de dérision. L’auteur ne se contente pas de dénoncer, il s’attèle aussi à une forme d’analyse à feu doux, et parfois désopilante, du principal protagoniste, sachant que l’autocritique c’est certainement l’endroit où Simon a le plus de mal à faire preuve de clairvoyance. Quant au discernement, il doit consulter Wikipédia pour s’assurer ce que cela signifie vraiment. C’est surtout sa femme ou son collègue Antoine qui le pousse à voir les choses différemment. C’est aussi à la mort de son chat Sultan, alors qu’il voudrait, comme une offre de réparation par rapport à toute une série de rendez-vous manqués, que le kaddish soit dit, qu’il prend la mesure de son éloignement de la « vraie vie« .
«Le monde est cul par-dessus-tête. Quand tu penses qu’il y a des salopards qui gagnent des millions pour faire des jobs toxiques quand les emplois utiles crèvent la dalle».
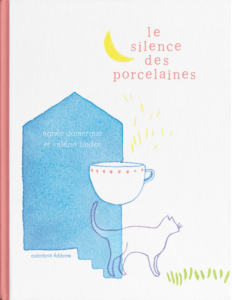
Le silence des porcelaines
d’Agnès Domergue et Valérie Linder
Editions Cotcotcot
Album jeunesse
« Deux notes de musique
au vent des quatre saisons »
Après Idylle paru en 2021 chez le même éditeur, le duo Agnès Domergue (au texte) et Valérie Linder (au dessin) se reforme pour notre plus grand bonheur. De nouveau, comme dans chaque ouvrage publié chez Cotcotcot éditions, la poésie est au rendez-vous.
Si les chats peuplent souvent nos albums-jeunesse, ici pas question d’aventure trépidante où l’animal serait humanisé. Non point de tout cela. Ici, le chat est un chat, se comporte comme un chat. Il ronronne, joue, se blottit en boule, sort parfois ses griffes, laisse ses « moustaches au vent », se déplace avec agilité, sans jamais rien casser, tout juste en faisant tinter les porcelaines japonaises. Il est libre comme le sont les chats, c’est d’ailleurs lui qui décide d’entrer dans la vie de la narratrice (« jusque sous mon toit je l’ai suivi ») et d’en sortir un jour sans prévenir (« un jour gris il est parti sans moi et sans un bruit »).
Ce chat qui s’est immiscé un soir d’été dans sa vie, traverse l’album telles des empreintes de souvenirs, auxquels l’aquarelle vient donner vie par touches qui s’imprègnent dans la mémoire comme dans le papier, par superpositions et se diluent aussi parfois, s’estompant au fil du temps.
Ces aquarelles d’une douceur infinie nous évoquent le travail de Lili Wood, mais depuis qu’on a reçu les leporello et cartes postales signés Valérie Linder on sait que l’ensemble signe une identité en propre qu’on aime tout particulièrement.
Une lecture où le temps s’écoule lentement tout comme la une tendre nostalgie
« Et comme une rangaine
le bruit des porcelaines »
- All
- Gallery Item

Bassoléa ou l'herbe dans le ventre
de Juliette Mézenc
Editions La Contre Allée
«rien de plus urgent à faire que prendre le temps, prendre le temps de creuser, insister, se faire mineur de fond, c’est ma ferme intention, comme ça que je traverserai les horizons de la terre»
Bassoléa est oppressée par le monde, elle a été exposée à des situations répétés d’enfermement (dans un riad à Marrakech en compagnie d’une cantatrice, avec les enseignements qui lui ont été donnés, au sein d’une ferme restaurée, en hôpital psychiatrique). Elle n’en peut plus de ces mises au vert subies. Aussi elle provoque sa propre expérience de retrait du monde extérieur, en investissant ce qui se passe sous terre. Elle décide littéralement de s’enterrer en concevant une véranda sous-terre, sorte d’extension de sa cave et lieu privilégié de contemplation de tout ce qui se joue au niveau des champignons, bestioles, nécrophores, bactéries, protozoaires, racines et autres radicelles. «Une main sur la tête, une main sur le ventre», elle observe et hallucine de tout ce qui grouille sous elle, de comment les feuilles mortes se transforment en humus. Elle s’escrime «à traduire dans le monde des humains l’art de vivre des microbes» nous plongeant dans «une immersion complète dans les sciences de la vie et de la terre».
Bassoléa nous livre une critique sans appel de notre société consumériste avec le travail comme point de centralité «on continue tous à travailler comme des dingues, à travailler toujours plus pour enlaidir toujours plus et bousiller toujours plus, et tout ça pour faire tourner l’économie». Et s’insurge contre cette difficile sortie du tout-travail, «c’est la peur qui leur ment, la peur de sortir de l’ornière qui a pris le forme de leur corps, à force, et c’est pourquoi ils n’ont plus le temps de se nourrir correctement, le temps d’aimer n’en parlons pas, même les morts ils n’ont plus le temps de les accompagner, il faut que ça aille vite, au pas de charge, ils n’ont pas que ça à faire, ils sont bien trop occupés à tuer la vie aux quatre coins de la planète».
Bassoléa prolonge son questionnement autour du corps qu’elle va laisser à sa mort, souhaitant ne laisser aucune trace de son passage sur terre. Ne souhaitant absolument pas finir dans un caveau, elle s’imagine «se fabriquer une chair tendre avec et par la danse» de sorte à se rapprocher d’un corps bio, recyclable et qui n’empoise pas ces petits habitants qui peuplent le monde souterrain («mettons que je meure le corps plein à craquer de psilos et donc de psychotropes, qu’est-ce que ça fera aux microbes?).
L’écriture est constituée d’une suite ininterrompue d’idées qui s’enchainent, comme un flot continu matérialisé par un très faible recours au point. Les virgules quant à elles rythment le texte tout en amenant des micro respirations. Le texte se prêt particulièrement bien à la lecture à voix haute. Le texte étant court, c’est d’ailleurs vivement recommandé de l’approcher ainsi.
Une ôde au vivant, aux petites bêtes, à la petite vie qui compose le dessous du monde.
«respirer c’est l’affaire de toute une vie, respirer c’est l’affaire, la grande affaire de la vie, ce n’est pas rien, c’est phénoménal, c’est la merveille des merveilles, et personne pour s’extasier, ou même s’étonner».

Tout l'or des nuits
de Gwendoline Soublin
Editions Actes Sud
«Puisqu’en brûlant tout revient.
Puisqu’il a brûlé.
Puisqu’il peut brûler encore».
L’illustration de couverture signée Benoit Paillé, et ce titre tout droit sorti d’un poème de Guillaume Apollinaire (Nuit rhénane) forment déjà une bien belle promesse. Peut-être dans ce temps de surproduction littéraire qu’on continue à vivre (ou subir c’est selon), ce sont là deux éléments réunis qui permettent à un premier roman de se frayer un chemin. Le reste est à l’avenant.
On suit Clara qui exerce en tant qu’aide-ménagère au sein de l’entreprise Sourire Services, aux côtés de Monia, Véronique et Stéphanie. Elle enchaîne le ménage chez des particuliers, parfois 7 maisons par jour, jusqu’à 45 heures hebdomadaires. Clara est celle qui volontiers supplée ou compense les absences ou démissions de ses collègues.
Très vite on comprend que Clara a dû faire face à un drame, elle a perdu son mari, Ivan. Le chagrin est immense. Elle doit composer avec cette absence, «s’occuper à des riens pour orchestrer le temps et mieux le voir filer».
Se perdre dans la répétition des gestes professionnels, «à la limite de l’extinction» : «c’est ce qui la tient : faire sans discuter, sans préférence, sans avis, faire, ni plus ni moins, faire ce qu’on lui a demandé, pas faire comme elle pense, ni faire ce qu’elle pourrait, ne surtout pas imaginer, avancer»).
Se perdre à compter les battements de son cœur, à réaliser des inventaires mentaux du nombre de cadres, de livres, d’ampoules, de chaises, de meubles, de bibelots des maisons qu’elle nettoie, à réciter l’éternel poème de ses huit ans, à scroller frénétiquement les annonces des sites qui recensent les animaux perdus, car oui, elle a récupéré un chien, Le Chien. Elle ne s’embête pas à l’affubler d’un autre nom, car ce n’est pas son chien, ce gros chien noir qui l’attend devant la maison. Ce chien qui n’en fait qu’à sa tête qui l’épuise de sollicitations, qui la réclame sans cesse et avec lequelle elle arpente les abords du bois à côté de chez elle.
Se perdre dans des rêves qu’elle ne vivra pas, comme les «si petits rêves d’Angleterre», Brighton qui est comme à portée de main mais qui se dérobe continuellement. «Ces rêves que Clara craint, dans lesquels les mots qu’elle n’a pas exprimés le jour prennent la forme de fantômes abusifs la nuit».
Se perdre ainsi la nuit, cette nuit qui l’effraie, la présence d’Ivan qu’elle ressent «dans le flou de ce demi-sommeil».
Se perdre dans des promenades interminables à assouvir les besoins du chien, «elle retrouve dans cette marche de fin de journée la même dynamique rythmique que dans le ménage, le lent mais certain effacement de la pensée dans l’exécution systématique des mêmes gestes : avancer, avancer, avancer».
Et c’est à cet endroit, à l’orée du bois lorsque des ombres affleurent et des animaux se consument sous l’orchestration de l’homme du bois, que se localise toute la puissance de l’écriture de Gwendoline Soublin, empreinte d’une forme de réalisme magique qu’elle convoque. Clara profite de ses excursions nocturnes pour faire parler des animaux en train de passer de vie à trépas, «Clara a vu les feux de la veille mettre bas les ombres des nuits suivantes». Cette brèche fantastique qui vient embrasser ce qui se joue dans l’inter-règne (cette intrication entre monde végétal, minéral et animal) prend forme lors de ces nuits étirées et se fait révélatrice du prolongement des présences-absences propres au deuil. «Tout se décale, se décalque : du jour ou de la nuit, de la forêt ou de la ville, des humains ou de tous ceux qu’on appelle animaux, voit-on seulement encore les limites ?» Ces passages où Clara se met en quête des voix ne sont pas sans nous rappeler le roman de Jeanne Beltane Les poumons plein d’eau (éditions des Equateurs).
C’est un roman que l’on traverse d’un souffle, happé par cette jeune Clara qui s’emploie à trouver les manières d’inventer sa propre consolation.
«C’est toujours la nuit.
La nuit, sans tête ni pieds, la nuit ce puits sans fond.
Clara use la nuit à force d’y marcher
Les semaines passent. Les mois. Les siècles».

Du pin sur la planche
de Bron, Lein, Ostermann
Editions 2042
BD
« Pour remplacer ce meuble, plusieurs solutions s’offrent à vous. »
Un meuble se casse et vous voici retourné.e en enfance dans un bon livre dont vous êtes l’héros.ïne (bon, pas toujours facile d’écrire en écriture inclusive, heureusement le livre est en typographie BBB Poppins TN, avec des glyphes permettant facilement l’inclusion). Choisir le type de meuble à mettre à la place de l’ancien, le moyen de se le procurer (« Ikae », « Ammeüs, rue de celui qu’on croyait connaitre mais en fait non », « la menuiserie locale » ou encore se lancer dans la fabrication soi-même ?), le bois, sa forme… On est tous passés par là et on ne réalise pas toujours les conséquences que cela pourrait avoir (sur son logement, sa santé mentale, sa santé tout court, la planète). Et bien, Bron, Lein et Ostermann y ont pensé pour vous et vous propose de tester de multiples alternatives et de voir ce que cela pourrait donner. Des propositions à des dilemmes qui nous parlent tous un peu, d’autres dignes de livres de science-fiction ou de visions déjantées… Il fait bon rêver un peu non ?… A moins que cela ne tourne au cauchemar et à la mort… D’où l’enjeu de bien choisir ses trajectoires à chaque page !
Avec en prime des illustrations acidulées et pleines d’humour.
C’est ludique et sarcastique à souhait, et en prime on apprend des choses par exemples sur les COV, ces composés organiques volatiles contenus dans les colles des agglomérés par exemple et qui peuvent provoquer des cancers…
Un petit livre drôle et écolo, ça fait du bien
« Catastrophe ! Votre chat a détruit votre meuble préféré. Que faire ? »
- All
- Gallery Item
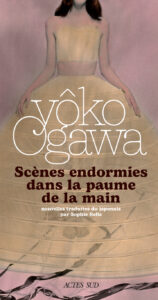
Scènes endormies dans la paume de la main
de Yoko Ogawa
traduit du japonais par Sophie Refle
Actes Sud
«La petite fille sait que les quelques centimètres qui séparent le haut de la boîte du sol créent un espace particulier, et que cette petite boite à outils qui pourrait être aisément piétinée prend ainsi une hauteur qui la met hors de portée des humains».
Ce livre est constitué de huit nouvelles, huit textes courts qui condensent des petites expériences, qui prennent toute leur importance ressaisies dans un petit espace, une unité de lieu souvent confinée, à l’écart du monde. C’est comme si Yoko Ogawa s’escrimait à réduire le cadastre du réel, à le diffracter, à ce qui se joue dans une petite boite à outils , dans un étui à chausson devenant boite aux lettres, à l’intérieur d’un bridge, aux inscriptions fragiles camouflées au niveau de la vaisselle, dans un théâtre factice, dans la librairie de la voiture à cheval, dans une machine à coudre, une licorne miniature, de minuscules chenilles arpenteuses. On va d’un personnage à l’autre, tous engoncés dans des rôles qui les dépasse ou qui nous dépasse (ainsi la personne qui vit dans le théâtre et qui se sacrifie pour que personne ne commette d’erreurs sur scène, ainsi la dame de compagnie qui fait figure de comédienne décorative), d’un espace de solitude à un autre, dans une subtile tension où tout menace de se disloquer, de trébucher tellement la fragilité menace (beaucoup de personnages se tiennent dans un corps frêle), mais où tout finit par tenir dans des répétitions et dans les surprises de la routine (à l’instar de la personne qui va assister aux 79 représentations d’une même comédie musicale). Il y a des parallèles qui s’opèrent, à l’usine de couture répond l’usine de transformation des métaux, des éléments de décor se dédoublent d’une nouvelle à l’autre, l’évocation d’une grotte, d’un camphrier, d’une boite à bento.
Yoko Ogawa aime jouer avec les échos, les réciprocités, les mises en abime pour troubler le vide de certains existences, on prend ainsi plaisir à lire la nouvelle Etreindre la licorne qui est émaillée de référence à la pièce La ménagerie de verre de Tennessee Williams.
Il y a des choses qu’on préserve pour soi, à l’abri, comme précieuse strate de son existence, à l’instar des différents programmes de spectacle réceptacles d’autographes. Il y a les croyances qu’on se crée (la figure des geckos enlacés-infinis comme symbole de fertilité) et les amulettes qu’on s’accapare pour exorciser les violences sous-jacentes de notre société.
Yoko Ogawa par la mise en scène de ses personnages, par l’acuité de leurs observations, par ses décors soignées, par ce décorticage du temps qui file, maille après maille, nous aide à mieux percevoir la beauté du monde quand cette dernière s’incruste dans de petites choses, dans des petites attentions (celles de la tante Laura qui badigeonne le cou de la narratrice de feuilles d’abricotiers afin qu’elle retrouve sa voix ; l’émotion procuré par un autographe reçu). Yoko Ogawa n’en finit pas de tisser son motif dans un en-dedans d’imaginaire tout entier situé dans «un petit bloc de calme».
Quand le temps consacré à la lecture ne cesse de se rétracter, le format que constitue les nouvelles est décidément une bonne réponse pour répondre aux nouveaux enjeux posés par l’économie de l’attention, tout comme cette façon si subtile de pactiser avec le monde onirique pour s’éloigner de la violence et du vacarme du monde tel qu’ils s’actualisent jour après jour. Et si un doute subsiste, il vous suffit de prêter attention aux toutes premières phrases de chacune des huit nouvelles pour être définitivement conquis. Yoko Ogwa est talentueuse, on le savait, mais on prend plaisir à le redire.
«La cheffe de service réfléchissait à la grotte du bridge où se cachaient les créatures. Un endroit très proche, mais qui lui apparaissait aussi comme une île isolée à l’écart du monde».
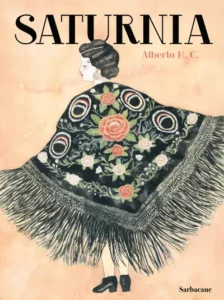
Saturnia
d’Alberto Martin Curto
Editions Sarbacane
BD
«Je leur parle de loups… alors que je suis dans la gueule de l’un d’entre eux…»
L’atmosphère si particulière qui transparait de cette BD passe par le recours à des vignettes aux contours flous, des couleurs souvent froides et comme délavées, des fonds à l’aquarelle qui se dilue comme dans les souvenirs pourtant toujours persistants.
Au départ, on ne sait pas bien qui est la narratrice. Qui nous dit : «Je sais… Je sais bien… Le passé est toujours là. Le passé…» ?
C’est une histoire de femmes au début du XXème siècle en Espagne. Il y a Inès, qui élève seule ses deux filles Roseta et Agueda, dans le secret car il n’est pas accepté de vivre seule avec des enfants. Les deux filles s’inventent des histoires et rêvent de sortir de chez elles. Elles sont condamnées à regarder discrètement le monde à partir du balcon.
Il y a la vieille voisine acariâtre, Apolonia. Il y a aussi Aurora, le chat-monstre, la «fille de Frankenstein». Et puis il y a Clavel le jour, Clavel de Luna la nuit. Quelques fantômes, une poupée symbolisant l’enfant jésus, des papillons de nuit, des mites, un chat porteur de messages. Et ce châle, qui se transmet de mère en fille dans la famille, transformant Inès en papillon de nuit, «un saturna géant» ! «Je suis une mite qui déploie ses ailes et sort du placard pour se battre dans le froid de la nuit».
Inès a une force de résistance chevillée au corps. Comme une nécessité de survie face à un extérieur où menace et précarité s’additionnent. Face au poids de la religion qui se rappelle sans cesse, et où sorcellerie et superstition ne sont jamais très loin. Inès et Clavel, s’entraident, se prolongent, les noctambules incarnent une véritable sororité.
Alberto nous emmène entre souvenir, rêve et cauchemar et avec en arrière-fond les soubresauts de l’Histoire. Peut-être est-ce le lieu, peut-être est-ce l’époque, mais on ne peut pas s’empêcher de penser à l’univers de Carlos Ruiz Zafón. On imagine fort bien Alberto M. C. mettre en images ses histoires à l’atmosphère brumeuse et qui n’est pas sans nous rappeler celle de cet album où la sensibilité affleure à chaque vignette.
Tout cela à travers les yeux des deux fillettes. Une histoire à la fois onirique et effrayante, en clair-obscur.
«Saturnia : grand paon de nuit, le papillon le plus grand qu’on trouve dans la nature».

Sortir du ventre du loup
de Charlotte Melly
Editions La ville brûle
Album jeunesse
«Peut-être… Peut-être qu’elle…»
Le Petit Chaperon Rouge est mangé par le loup mais tout va bien puisque le chasseur ou le bûcheron vient ouvrir le ventre de l’animal et sortir la petite fille de là ! … Mais qui peut bien penser que tout va bien alors qu’elle a été mangée avant d’être sauvée ? Peut-on vraiment dire qu’elle est saine et sauve ?
Parce qu’il y a trop d’enfants qui subissent des violences ou vivent des situations traumatisantes. Parce que c’est utile d’en parler avec tous mais que ça ne va pas de soi d’évoquer de tels sujets avec des enfants, il y a la littérature jeunesse et il y a Sortir du ventre du loup.
Charlotte Melly imagine dans cet album la suite du Petit Chaperon Rouge et tous les états par lesquels la fillette pourrait passer. Et forcément, on ne peut pas dire que tout est bien qui finit bien. Sa vie continue. Et c’est à ce moment que l’histoire commence, dans cette imagination des possibles (pas très gais il faut bien l’avouer) : elle cherche à se cacher, se protéger. Parfois muette, parfois très en colère. La peur est là. L’isolement, la tristesse.
Mais c’est qu’elle a des ressources, alors elle apprend à voler ou à creuser des passages secrets. Ça ne suffit pas, son corps lui dit qu’il va mal : elle se gratte, s’arrache les cheveux.
Elle tente de se transformer, se déguise (on découvre la cousine de Peau d’âne : Peau de loup). Elle déménage, rêve de partir dans l’espace, s’échappe du réel et de son passé. Elle cherche de quoi se réconforter, auprès de qui trouver refuge.
Mais ça ne va pas de soi de sortir de ce trauma : «Elle traverse des hauts et des bas».
Des phrases courtes ou ponctuées de virgules, pour décrire son état ou tenter d’en sortir, comme pour les scander, les lancer… et reprendre son souffle.
Le texte nous frappe, les illustrations aussi. Parfois uniquement au crayon ou fusain, parfois avec des aplats texturés, de couleurs vives ou contrastées pour souffler le chaud et le froid.
La fillette n’est qu’une silhouette blanche, comme effacée, extraite du monde. Mais lorsqu’enfin elle se met à écrire, elle reprend forme et vie.
C’est un album qui s’accompagne, forcément, et qu’on ne lira pas trop jeune. Mais il faut le lire car il est utile et beau à la fois.
«Est-ce que tu t’es déjà demandé ce qu’il se passe après, dans la vie du Petit Chaperon Rouge, une fois qu’elle est sortie du ventre du loup ? »
- All
- Gallery Item

La Pommeraie
de Peter Heller
traduit de l’anglais par Céline Leroy
Editions Actes Sud
« La Pommeraie
Ce soir le parfum des fleurs de pommier
et le murmure du ruisseau
se faufilent par la fenêtre ouverte
comme autrefois nous parvenait le son des dix cordes.
Notre fille dort malgré le vacarme au fond de mon cœur. »
Frith, apprenant qu’elle est enceinte, se décide à relire son passé et celui de sa mère, Hayley, en ouvrant le coffret qu’elle lui a légué. Cette boite contient des poèmes chinois écrits par « la princesse Li Xue qui vivait dans l’Ouest du Sichuan au début du VIIIe siècle », que sa mère a traduits en anglais.
On comprend qu’un drame est survenu mais on ne sait lequel. On comprend aussi rapidement que la relation entre Frith et Hayley était forte et singulière, et que leur vie dans une pommeraie du Vermont l’était tout autant. A six ans, la fillette ne va pas à l’école mais dévore les livres, fabrique du sirop d’érable, récolte des pommes et est la princesse d’un royaume imaginaire. Elle a la compagnie d’Ours, leur chien, et parfois de Ben, un enfant un peu à part. Elle et sa mère ont aussi la compagnie de Rosie, artiste tisserande, et parfois de quelques rangers qui viennent offrir de la viande braconnée.
C’est une vie un peu hors du temps et du monde, où l’observation de la nature a une place importante, les odeurs, les couleurs, et le souffle du vent. Où l’attente et la perte traversent chaque moment, même joyeux. La nostalgie est sous-jacente, presque palpable sans qu’on sache forcément à quoi elle est reliée. « L’absence produit elle aussi un bruit qui peut être aussi bruyant que ce qui l’a précédée. Parfois elle est même plus bruyante. »
La force de ce roman, c’est ce tissage entre courts instants présents où Frith découvre les poèmes et leurs traductions (parfois plusieurs du même texte), retours dans l’enfance et ces poèmes chinois qui semblent tout autant écrits au VIIIe siècle en Chine que dans le Vermont, alors que Frith est toute jeune. Comme si l’acte de traduction avait relié ces deux époques, ces deux lieux, pour donner une matière encore plus intense à la mémoire de cette vie passée dans la pommeraie, chaque poème venant éclairer d’une lumière spécifique ces fragments de vie.
Un roman qui nous invite aussi à prendre le temps de l’introspection.
« La joie nécessite-t-elle la sécurité ? Je n’en suis pas sûre. Non pas que ma vie avec Hayley ait été dépourvue de joie – nous vivions des moments joyeux, presque tous les jours. »

Bleu d'août
de Deborah Levy
Editions du sous-sol
traduit de l’anglais par Céline Leroy
«Mes doigts avaient refusé de se plier à Rachmaninov et j’avais commencé à jouer autre chose».
Deborah Levy nous invite à suivre les pérégrinations d’ Elsa M. Anderson, pianiste virtuose de 34 ans aux cheveux bleus.
L’autrice qui s’est penchée à plus d’une reprise sur l’exercice de la biographie, à commencer par la sienne (Prix Fémina étranger 2020), ne cède en rien à l’illusion d’une trajectoire biographique, elle s’autorise une évocation hélicée de la vie de son héroïne pianiste, au gré des cours de piano qu’elle donne en Grèce auprès du jeune Marcus, ou à Paris auprès d’Aimée, au gré des conversations qu’elle a avec Marie ou Rajesh ses amis. A travers aussi un kaléidoscope d’images flottantes, à l’instar des lamas aperçus dans la voiture jaune, des fourmis qui investissent une baignoire, les chevaux d’Ipswitch, les oursins de Perros, un piano Steinway aux touches d’ivoire.
C’est qu’Elsa se lance à la recherche de son double à défaut de se trouver elle-même. Qui est donc cette personne qui a acheté la paire de petits chevaux mécaniques qu’elle désirait tant et à qui elle a subtilisé son chapeau ? Quelle relation continue-t-elle d’entretenir avec Arthur Goldstein son professeur de piano qui l’a adoptée quand elle avait 6 ans? Qu’est-ce qui résiste de la sorte au point qu’Elsa refuse de prendre connaissance des documents qui pourraient lui en dire plus sur ses origines et ses parents biologiques ?
En plein récital à Vienne, devant une salle pleine à craquer venue l’écouter, elle prend ses libertés avec le Concerto n°2 de Rachmaninov avant de quitter la scène de manière anticipée («C’est vrai que nous avons perdu le deuxième concerto pour piano de Rachmaninov, (…) mais pendant deux minutes et douze secondes, nous avons écouté Elsa M. Anderson jouer quelque chose qui nous a coupé le souffle»). Mais de quoi cet élégant auto-sabordage, cette sortie de scène, cette sortie de la tristesse de Rachmaninov, au faîte de sa carrière, est-il le nom ?
Entre crise artistique et crise identitaire, elle est résolue à tourner le dos à ce «vieux monde», ces «vieilles rengaines»… Celle qui reste orpheline («le silence assourdissant de ma mère») se projette en son double et recompose ses fragments de sa vie comme pour jouer une nouvelle partition, comme une nouvelle «musique intérieure» écrite au présent.
Avec une écriture empreinte de nostalgie, qui associe en permanence fibre artistique et désir d’émancipation, Deborah Levy n’en finit pas de nous bluffer.
«J’avais des bleus à l’âme de la même couleur que mes cheveux».

Les Gugusse en vacances
d’Emilie Gleason
Editions Atrabile
«Vous souhaitez aujourd’hui vous engager juridiquement afin de payer moins d’impôts et socialement pour vous conformer au diktat marital et faire plaisir aux parents».
Ils sont 5 dans cette famille : Boris, Doris, Balou, Éléana et Ted et chacun y va de son excentricité. Leur programme : se rendre au mariage de leur cousine Alegzandrine dans le Yolcame, pays où les tacos de betterave à la vapeur et les gaufres salées au panais font figure de plat national. Rien ne se passe vraiment comme prévu, toute une série d’empêchements viennent retarder leur départ. Et quand ça semble finir par se normaliser, d’autres imprévus guettent, à l’instar du sac poubelle qui a été confondu avec le sac de pique-nique. Et pas si tôt arrivés, les ennuis reprennent de plus bel (remontée d’eaux usées, colonie de fourmis rouges, quand leurs hôtes sont aux prises pour l’un à une brulure au premier de ré, pour l’autre à une péritonite). Les obsessions des uns répondent aux maladresses des autres, le pire et l’absurde sont toujours à portée de main. A l’insu de leur plein gré, tout semble s’organiser autour de la loi de l’emmerdement maximum.
Les couleurs éclatantes accompagnées d’une tornade graphique renforcent le rythme soutenu de cette BD hi-la-ran-te.
Envie d’une BD qui vous fasse rire ? Allez-y foncez !
«Le trafic est perturbé sur l’ensemble de la ligne, en raison d’un incident de panne de signalisation et d’un malaise voyageur et d’un accident de personne et d’une erreur d’affichage et de…»
- All
- Gallery Item

Soleil rouge
de Johanne Lykke Holm
traduit du suédois par Catherine Renaud
Editions La Peuplade
« A l’intérieur de ses paupières, les visages des enfants de son rêve apparaissent à un rythme régulier, comme si les images lui étaient envoyées depuis un endroit lointain dans l’univers, la dimension des enfants non nés qui palpite, un ordre sacré. »
Lire Soleil rouge c’est entrer dans un univers où le temps est comme distendu et les lieux à la fois proches du réels et comme sortis d’un pays imaginaire. C’est une expérience cinématographique où chaque détail du décor, la luminosité, les couleurs, tout est millimétré. C’est comme entrer dans une serre, dans une parfumerie un peu particulière, dans une cuisine ; les odeurs sont à l’honneur. C’est naviguer entre rêve et presque-cauchemar. C’est prendre le temps de ressentir plus que de comprendre. Lire Soleil rouge, c’est tout cela à la fois et c’est ce qui en fait un roman incroyable.
C’est l’histoire d’India, jeune femme universitaire sans enfant (il n’est pas question pour elle de devenir mère, non, vraiment, trop «peur que quelque chose de désagréable ne se transmette en héritage ») et de Kallas son amoureux, sans enfant également (non, vraiment être père ce n’est pas pour lui, il s’était « promis de ne jamais être un père »). Nous sommes dans une ville qui porte le nom du fleuve qui la traverse (mais quelle est cette ville ?). Il y fait chaud et moite, l’été enveloppe tout, ralentit et exacerbe tout. India et Kallas sont beaux (« tu es belle comme la nuit », « tu es beau comme l’aube »), ils vivent une relation amoureuse magnifique. Pourtant quelque chose de latent nous laisse à penser que tout n’est pas si lisse, si simple (ou est-ce l’habitude de lire des romans où les relations ne peuvent pas être simplement belles ?). Kallas a une amie d’enfance, Desma, à l’aura mystérieuse ; India une amie de la fac, Nadja, qui l’aide à garder les pieds sur terre, à ne pas se perdre dans les méandres des œuvres d’Henry James, son sujet d’étude. Un jour, ils partent tous deux dans la riche demeure au bord de mer de Desma. Et puis débarquent trois enfants, seuls, qui n’ont nul par où dormir. Il n’est pas possible de les laisser partir dormir sur la plage, mais il n’est pas possible non plus de les garder. Un incendie se propage soudain. Les autorités locales sont entièrement dédiées à ce fléau et il n’est plus question pour elles de gérer la situation administrative de ces enfants. India et Kallas emmènent donc Alexander, Domenico et Grimaldi en ville.
Commence alors un temps d’apprivoisement, de découverte de sensations et d’émotions jusque-là inconnues aussi bien pour les enfants que pour India et Kallas. C’est quoi être parent ? Ca veut dire quoi former une famille ? Est-il possible de vivre longtemps dans cette bulle hors du temps ?
Johanne Lykke Holm, par l’intermédiaire d’une traduction fine et ciselée, nous happe dans son univers fait de tensions, de sensibilité à fleur de peau et d’onirisme.
Un des plus beaux romans lus ces derniers temps.
« La lumière est chaude, saturée, comme dans un lieu enchanté où un essaim de lucioles serait prisonnier d’une boule de verre. »
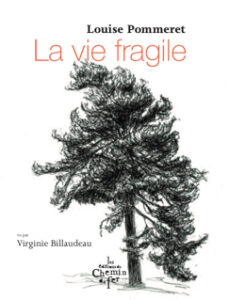
La vie fragile
de Louise Pommeret
Illustré par Virginie Billaudeau
Editions du Chemin de fer
«Cette nuit nous allons te la raconter, l’histoire. L’histoire de la maison, des présences qui l’ont traversée, incrustées dans la pierre, enracinées dans le sol, elles sont traces, sédiments».
Nous avions quitté la semaine dernière la Haute-Loire avec le livre Après le virage, c’est chez moi de Marie Kock, on la retrouve avec celui de Louise Pommeret. Cette fois-ci on se retrouve du côté d’une maison sur «un bout de montagne» vers le Mont Pidgier. Cette maison est vouée à démolition. Une route doit passer, nécessité impérieuse oblige, tout doit être détruit, «sans pitié, ni procès». «Demain les fragiles périront dans le chaos des basaltes». Il y a donc urgence à faire l’ « éco-biographie » de ces lieux.
On n’est pas là comme dans la BD de Marion Fayolle, la Maison nue où ce sont des âmes en peine qui se sont rassemblées dans un lieu pour y cohabiter et survivre, chacun avec leurs névroses, on a plus affaire à un chant du cygne polyphonique, fait de ce que animaux, végétaux et minéraux ont retenu du temps passé ensemble, avant que les «hommes de la route» et leur bulldozer se présentent à eux. Les voix humaines ont comme déserté. Tour à tour, telle une assemblée, ce sont l’hêtre puis la mousse, la croix, le pommier, la vigne vierge, la rigole, la ronce, la chouette qui font part de ce territoire vécu. En s’adressant à la dernière occupante des lieux, ils reconstituent le temps long qui les a constitués (Ainsi la mousse qui proclame, «j’ai mis un siècle à devenir ce que je suis aujourd’hui, le coussin des rêves d’enfants. Une poignée de secondes pour un siècles de rêves…»), la mémoire continuée (les témoins non humains de ce «petit cosmos» local prolongent à tour de rôle cette histoire racontée) de ce morceau de terre qui s’est enraciné, de ses occupants, à commencer par la lignée des Marsand et les cycles d’amour et de souffrance qui s’ensuivent (les années du Monstre, les années de la Catastrophe). «L’histoire ne retient-elle que le bonheur, ou le malheur. La tiédeur n’y a pas sa place».
En lisant, La vie fragile on pense bien évidemment à l’A69 censée relier Toulouse à Castres, mais plutôt qu’un développement militant sur l’ineptie de pareil projet, c’est plus la chronique des chaines d’interdépendance, et de l’infra-perceptible dont il est question. «Pourras-tu leur dire (…) que chacun de vos êtres est relié à un autre, et que cet autre habite un règne voisin du nôtre ? Que sans cet invisible qui vous unit à nous, vous n’êtes plus grand-chose, peut-être réduits à rien ?».
La dernière partie du livre laisse la place à «l’échouée», la dernière à avoir vécu en ces lieux, qui s’est métamorphosée au contact des êtres vivants qui peuplent ces lieux et qui peuvent prêter à la rêverie (les fées dans les hêtres, l’oiseau philosophe et l’homme-hibou). Ceux-là mêmes qui ouvrent à l’expérience troublante de «l’interrègne».
Celle qui devient à son tour la narratrice témoigne de l’hospitalité de tout ce petit «peuple du Pidgier». «Pour la première fois je suis restée quelque part ; j’ai cessé d’être atome, poussière, particule, j’ai désiré enfin m’incarner dans la pierre, dans la feuille, dans la sève. (…) La maison était terre ferme face au milieu d’un océan de doutes et de peurs». Au contact de ces autres présences fragiles qui dénoncent («Nous qui ne pouvons ni fuir, ni fermer nos paupières, nous sommes condamnés à voir»), elle fait tout à la fois «peau neuve» et «communauté sensible». Un regard nouveau est porté et une prise de conscience opère : «Plus besoin d’araignée si plus de mouches, plus d’insectes, plus de vermisseaux, dans le meilleur des mondes le nuisible, on a sa peau ! On nous en débarrasse. Ici nous sommes le rien qui existe. Ils vont construire une route là où il n’y a rien». Un bel hommage à ces lieux défaits qui sont passés pour immuables mais qui ne le sont plus, à ces êtres-palimpsestes qui retiennent quelques précieuses traces de notre passage.
«Plus lieu d’être, plus d’être-lieu. Une ferme inhabitée de l’an 1910 ? Plus lieu d’être, plus d’être-lieu».

Vents de mémoire
d’Yves Nadon (texte) et Nathalie Novi (illustration)
Editions D’eux
album jeunesse
«cinquante-deux drapeaux, alignés sur trois cordes. De quoi faire voler sa vie dans le jardin !»
Là-bas et ici. Dharamsala au nord de l’Inde, souvenirs de vacances, souvenirs d’enfance. «Montagnes, vallées et moines». Et puis, emblématiques de ces paysages, les «lungta», ces drapeaux de prière tibétains. «Le vent les faisait vibrer et, selon les tibétains, les prières, portées par le vent, chantaient et imprégnaient l’air partout où celui-ci les trimbalait». Et l’enfant au cœur de cet album décide «d’emmener cette idée» chez sa grand-mère qui a perdu la mémoire. Il relie cette image faite de drapeaux multicolores qui flottent dans le vent à sa grand-mère qui oublie. Cette pensée est matérialisée dans l’album par un fil rouge qui les relie tous deux. On voit l’enfant à quatre pattes s’atteler à préparer des rectangles colorés où il inscrit les «moments de vie» de sa grand-mère. Les images défilent, les souvenirs s’impriment. Un encerclement par des drapeaux, un peu de vent, et la magie opère, «grand-maman est devenue toute souriante, d’un coup, comme synchronisée avec le vent, et un flot de souvenirs l’a inondée». Et la dynamique prend, d’autres souvenirs d’autres personnes se mettent à voler portés par le vent.
L’histoire est magnifiquement servie par les illustrations de Nathalie Novi, parfois le texte est en retrait et là intervient le défilement de véritables peintures, en pleine page, faites des souvenirs de la grand-mère. Une sarabande d’objets, instants, personnes, lieux composant la trame, mais aussi une poétique des souvenirs. Ou comment faire des enfants des grands-parents, et des grands-parents des enfants.
Un album qui fait vibrer notre corde sensible.
«Indépendamment d’où soufflerait la brise, encerclée par ces drapeaux, grand-maman recevrait par le vent ses souvenirs»
- All
- Gallery Item

Après le virage, c'est chez moi
de Marie Kock
Editions La Découverte
«Je désire une maison à moi pour pouvoir me donner l’asile si j’en ai besoin».
Ce livre pourrait être assurément un prolongement de l’essai de Mona Chollet, Chez-soi, une odyssée de l’espace domestique. Marie Kock y développe une réflexion sur ce que peut bien signifier la notion de «chez soi», n’hésitant pas à rendre compte de sa propre expérience.
Pour Marie Kock, ça se passe en Haute-Loire, dans le hameau du V., dans le pays du Meygal. Elle partage sa géographie intime de l’endroit, son biotope d’émerveillement (la forêt derrière la maison, le chemin qui mène au ruisseau, le coin aux champignons, celui aux airelles…). Pour ce qui est du paysage en tant que tel, même si elle n’a de cesse de le rechercher partout où elle va, elle convient qu’elle n’arrive pas à le décrire suffisamment, «les éléments que je pourrais tenter d’accumuler restent des clichés qui ne pourront jamais égaler le tout qui me saisit quand je le regarde», d’où l’enjeu qu’elle dessine, comme une antidote à la bougeotte, «ce que je veux, c’est arriver à lire le monde qui est déjà sous mes yeux».
Bien consciente d’être une «privilégiée de la mobilité», elle renseigne le parcours qui a été le sien, de logement en logement, de ville en ville, persuadée que «le lieu où l’on habite n’est pas toujours celui où l’on se sent chez soi». La preuve à l’appui, elle rend compte de ce qu’elle a ressenti lorsqu’elle a rejoint tour à tour, sans trop se cogner (allusion reprise à l’autrice citant elle-même Perec in Espèces d’espaces) Lille puis Paris, puis Marseille -autant de lieux d’arrivée qui ne cessent d’interroger son lieu de départ- et avec cette illusion tenace d’avoir la possibilité de recommencer à chaque fois une nouvelle vie. Et l’autrice d’interroger : peut-on dépasser son ancrage initial constitué du lieu de son enfance ? «Je me demande ce qu’il me prend de courir partout pour trouver un endroit où planter mes racines».
Marie Kock développe plusieurs perspectives critiques, vis-à-vis des classements des villes où il fait bon vivre, vis-à-vis d’une approche identitaire du territoire («Quand se battre pour son bout de terre devient une question d’identité construite contre les autres»), vis-à-vis de son rapport à la propriété («c’est la peur de l’effondrement, intérieur autant qu’extérieur, qui me fait basculer du côté de la propriété»), vis-à-vis du mépris manifesté à l’endroit de ceux qui ne seraient jamais partis de leur ville d’origine, vis-à-vis de ses propres projections, «Mon rêve de vie simple est un rêve de rentière. Ma petite maison dans la prairie est une version de luxe de l’Ehpad. Et je ne vois pas qui va bien pouvoir payer la note».
Marie Kock prolonge sa réflexion sur quoi repose la poursuite du lieu rêvé. En plus des lieux imaginaires (à l’instar d’Arrakis la planète imaginaire de l’univers du Cycle de Dune), cela pourrait s’apparenter pour elle à un retour en arrière, vers les lieux de son enfance, vers «ce paysage qu’[on reconnaît] comme le sien». «Au moment du choix définitif, c’est ce lieu, aussi littéral que symbolique, que l’on espère retrouver. L’image qu’on se façonne tous et toutes de notre dernière demeure est peut-être finalement ce qui se rapproche le plus de celle qu’on se fait de la maison. De là où l’on voudrait être si l’on avait pas à s’accrocher à nos identités sociales, à flatter nos égos abîmés, à accepter l’insupportable ou le médiocre parce qu’après tout c’est la vie. Ce moment est celui où l’on peut faire la dernière boucle. Où l’on peut décider de l’endroit où faire le noeud».
A mi-chemin entre l’essai et le témoignage, ce livre est écrit avec une grande honnêteté, et indépendamment d’éventuelles origines ligériennes, l’on doit être nombreux/se à se reconnaître dans cet itinéraire de questionnements, somme toute, pas si personnels que ça.
«Depuis que je suis en âge de payer un loyer, je me demande où va commencer ma vraie vie, quelle sera ma vraie maison, l’endroit dont je n’aurai pas envie de repartir».

Les apprenties
de Zoé Jusseret
Editions Frémok (FRMK)
BD sans texte
Quel bel objet que cette BD au format singulier qui nous fait découvrir deux jeunes filles qui s’aventurent dans un paysage marqué par trois immenses pylônes électriques, immensités qui surplombent un horizon dévasté. Un corps de femme git au milieu exposé aux charognards. Dès cette scène inaugurale on sent s’établir entre les deux personnages une relation empreinte de soutien réciproque. Elles vont prendre soin des restes de cette personne. D’autres atteintes et effrois les menacent. Heureusement qu’il y a quelques moments de pause, comme ce bain dans cette étendue d’eau émaillée de fleurs et plumeaux rouges. Heureusement aussi qu’il y a ce filet protecteur rouge dans lequel elles s’emmaillotent. Heureusement qu’il y a aussi les aînées auprès de qui on peut trouver refuge. Le récit offre dans une forme de torpeur ambiante de délicieux moments de contemplation.
Un volcan fait irruption et c’est tout un monde insoupçonné qui se révèle, des créatures outils font leur apparition. Les deux amies exfiltrent un être-fourchette. Mais l’asile est dur à donner dans ce monde fait de désolation. Les abris sont vites détruits et les forêts calcinées. Heureusement qu’on peut compter sur le recours à la présence des disparus. Les esprits rodent et des métamorphoses, des versions augmentées d’elles-mêmes sont toujours possibles. Grandir pour prendre le dessus, pour engager la bataille. L’envie d’en découdre gronde, le besoin de se rebeller est là.
C’est un conte saisissant où le merveilleux opère ici et là par petites touches, où la sororité s’établit en actes. Petit à petit, l’espoir qui s’incarne par le plus petit des collectifs et se conjugue au féminin pluriel, est bien là, à portée d’étreinte. Aussi dérangeant que délicat.

Comment attraper une licorne ?
De Davide Cali, traduit de l’italien par Carole Pasquier
Illustrations de Sara Arosio
Editions Versant Sud
Album jeunesse
«En fait, ce n’est pas facile d’être une licorne.»
Tout le monde sait ce qu’est une licorne… Ou du moins pense savoir ce que c’est. Mais les connait-on si bien que cela ? Sait-on où les trouver et surtout ce qu’elles aiment ? Davide Cali se pose toutes ces questions et amène le jeune lecteur à se les poser avec beaucoup d’humour. En tous cas, il a son avis sur la raison pour laquelle c’est si difficile de les trouver : elles « préfèrent rester incognito » ! Pourquoi ? A vous de le découvrir en lisant l’album !
Cet auteur aime collaborer avec des illustrateur-ices différent-es, ce qui colore, donne une touche particulière à chacun de ses albums. Cette fois, il a travaillé avec une jeune illustratrice avec qui il avait déjà réalisé un documentaire jeunesse sur la question du temps (malheureusement pas encore traduit en français). Sara Arosio a été gardienne de musée à Milan, peut-être cela l’a-t-elle inspirée pour la chasse aux licornes au début de l’histoire ? En tous cas, on aime retrouver des tableaux connus (mais comme les licornes, les connait-on si bien que cela ?) détournés pour faire apparaitre des licornes. On aime aussi les couleurs pop qu’elle utilise, donnant une saveur de bonbon acidulé à chaque page. Enfin, la multitude de détails donnera envie, c’est sûr, au jeune lecteur de lire et relire cet album, pour chaque fois découvrir de nouveaux éléments et imaginer de multiples aventures pour les deux enfants que nous suivons et bien sûr rêver les vies possibles des licornes.
Les albums de Davide Cali sont souvent drôles, toujours sensibles et à coup sûr font réfléchir petits et grands. Une fois encore, pour notre plus grand plaisir, c’est chose faite !
«Pour tout dire, le premier problème, c’est : en débusquer une.»
- All
- Gallery Item

Primevères fantômes
d’Orée Li
Editions des Lisières
«par le chemin du rêve
au-delà d’épiderme
se rendre
à l’évidence de la cellule»
Faire mutation en cinq actes, se faire végétal.e, voilà l’itinéraire de poésie proposé par Orée Li. Alliance avec les fleurs, des plus connues aux inconnues («touffes de fleurs flottantes, touffes de fleurs sans nom») un bouquet de métaphores et de couleurs, avec du jaune comme fil conducteur, «plus jaune que jaune seulement», du jaune moutarde, du jaune jonquille et des brassées de mauve-violet («J’écris d’un Groenland violet dans le ventre»). Au contact charnière d’auteur.ice.s inspirant.e.s, Barbara, Rachel Carlson, Ananda Devi, Anne Dufourmantelle, Emmanuele Coccia.
La métamorphose opère : «Quitte à perdre quelques pans de mon humanité, j’adopte la forme des racines androgynes, de la terre dans le ventre et du sang dans la bouche pour que tout cela pousse. Plantes et poèmes s’accouplent comme le font les sorcières». Les principes actifs de cette mutation et de la poésie qui en procède («il fallait des poèmes qui puissent donner le courage de la métamorphose») se répercutent aussi en «boucle de vie» : «Mon corps danse comme une folle pour raconter la symbiose inespérée».
Orée Li déploie une puissance d’écriture qui vient «entre les friables de la pensée, mes failles qui se cherchent», en réponse à la disparition de sa mère et qui s’exprime aussi à partir de ce lieu défait («nous habitons là dans les ruines») et incompréhensible («je ne connais pas encore le nouveau sens du mot effondrement»), et vis-à-vis duquel il s’agit de faire face : faire émerger «des échafaudages et des cabanes de brindilles», «une nouvelle grammaire», «réfléchir à la suite du rêve», faire apparaître un autre récit qui «s’enclenche avec la force fragile du chèvrefeuille dans les ruines». «Ni propreté, ni politesse, ni perfection, j’écris depuis les décombres et les ravins parce que j’aimerais donner à boire à l’enfant que j’ai été, aux enfants que nous étions, les regarder agir et penser, de la sève plein les tempes» ; «Je trace quelque chose dans l’urgence du désir de vivre encore avec les herbacées». Et «cette tornade d’altérité» fait école : «il y a dans presque tous les territoires non réglementés par l’imagination humaine des personnes qui ont découvert des brèches et qui suivent actuellement le processus».
La poésie sensorielle d’Orée Li est aussi innovante («je voulais inventer une nouvelle histoire»), telle un laboratoire d’écriture, avec le recours à une police de caractère post-binaire (BBB Baskervvol) qui sait «enjambe[r] la frontière barbelée des genres».
Ce recueil nous fait penser, en puisant dans la langue et les sensations de l’enfance à cet immense recueil qu’est Nourrir la pierre de Bronka Nowicka (éd. Corti). Il nous évoque aussi, dans un tout autre contexte, dans ses rapports à la mort («La poésie c’est fait pour faire des arcs-en-ciel avec les armatures de la mort»), à la dégradation, à la métamorphose, à Végétal d’Antoine Percheron (éd. Les Belles Lettres).
Accompagné.e des fleurs, Orée Li fait l’expérience d’apprentissages («Les fleurs m’ont appris à dire mon corps qui n’avait jusqu’ici pas trouvé de famille adéquate (…) leurs mouvements se rapprochent de mon langage et de la façon dont fonctionne mon esprit»), à partir desquels elle développe une poésie toute verticillée plus que versifiée et nous communique un «sens de l’émerveillement» tout à fait salutaire. Il est tout à fait réjouissant de constater, à travers ce chemin de poésie, qu’effectivement, «dans certaines têtes les choses s’imaginent autrement».
Nous aurons la chance d’accueillir Orée Li le 4 avril à la MJC.
Et désormais, à la question c’est quoi de « l’écopoésie« ? Je crois savoir désormais quoi répondre.
«Pourquoi quand je prononce les mots prunus, citron, grenadier ou même pâquerette quelque chose de mon corps se transforme en miracle ?»

Mon vrai nom est Elisabeth
d’Adèle Yon
Editions du sous-sol
«Comprendre transforme la souffrance en colère, et la colère ne résout rien. Mais la colère a un pouvoir : elle éventre les paravents. Et les fait tomber, elle les brise, elle déchire le tissu avec le bois dont ils sont faits».
Plusieurs semaines déjà que ce formidable texte a été publié et je n’avais pas eu le temps de m’en saisir. Comme une légère frustration de voir fleurir ici et là des papiers dithyrambiques à son propos et de devoir repousser l’accès à cette non-fiction. Les vacances m’ont permis d’en étaler sa lecture, d’en admirer sa facture.
Adèle Yon travaille tout à la fois l’archive et les récits familiaux pour essayer de reconstituer ce qu’il en a été de la vie son arrière-grand mère Elisabeth, celle qui a été photographiée à multiples reprises (notamment par l’oncle de l’autrice) et qui présente un visage mutilé «deux trous, un de chaque côté du crâne», photo qui tranche avec «le visage rond et arrogant des photos de jeunesse». Ces photos participent de l’image que les membres de la famille, notamment ses descendants se sont fait d’elle, de cette créature surnommée Betsy. Celle qui, diagnostiquée schizophrène, a fait l’objet de 17 années d’internement psychiatrique, et d’une lobotomie. «Une histoire à tenir cachée».
Adèle Yon poursuit le cap qu’elle s’est fixé, où les jalons de sa thèse et de l’enquête familiale se confondent : elle remonte la lignée maternelle, découpe (comme elle le fera pendant une année de césure avec des carcasses, ou comme elle le fait avec des oignons en compagnie de son grand-père) les témoignages, retisse les boucles de paroles, exhume les registres des centres d’archives, retranscrit les entretiens, relance les protagonistes malgré les dénégations, les oublis, le poids du silence, les demi-mots, les trous de mémoire. Et jusqu’à s’interroger sur de quoi sont faites les archives («Les archives, comme les histoires que l’on se raconte pour grandir, sont des paravents. Elles dispensent une réalité codée, fractionnée par les plis de l’objet, en grande majorité recouverte, et dont nous ne voyons que le haut, le bas et les interstices»). Qui croire face à cette profusion de récits et à l’absence de dossier médical ?
L’autrice exhume les correspondances, les carnets de recette de son arrière-grand-mère (et sa recette des «cervelles farcies») redécompose les moments de la vie de cette dernière, les circonstances dans lesquelles sa trajectoire de vie s’est enserrée, les interactions qu’elle a eues avec son entourage, à commencer par son mari et ses parents. Adèle Yon est mue par ce souci de «faire jaillir une représentation sinon exacte du moins adéquate de ce qu’a pu vivre Betsy».
Dans un échange épistolaire qu’elle adresse à son mari qui est mobilisé par la guerre, Elisabeth, celle-là même qui revendique sa liberté, veut être actrice de ses décisions dans une époque où cela n’était guère admis, s’exprime ainsi «Pour me rendre heureuse je vous demande aussi de considérer mon tempérament. Le tempérament, c’est un tout que l’on ne peut modifier sans se tuer physiquement et moralement. Pour cela je suis obligée de vous demander de me considérer comme je suis : comme une personne qui a besoin de beaucoup d’air physiquement et moralement ; je ne peux pas vivre en vase clos». Comme une quasi prophétie auto-réalisatrice : cette attention qu’elle requiert de la part de son mari, elle n’y aura pas droit, et Elisabeth fera les frais de cette somme de décisions, comportements autoritaires, abandons et trahisons (grossesses répétées, internement, insulinothérapie, lobotomie, retour chez ses parents).
L’autrice montre très bien en quoi la lobotomie qui a été pratiquée à l’insu d’Elisabeth n’avait pas pour objet d’agir sur les causes de son mal-être mais intervenait «pour prendre à la racine des comportements qui portent préjudice au cadre familial et social». Contenir et non guérir.
C’est tout à fait saisissant que de voir se déplier l’histoire familiale, ses traumas, ses icônes, ses colères, ses souffrances et leurs transmissions à l’oeuvre mais aussi en arrière-fond l’histoire de la psychiatrie et son évolution à partir de la sectorisation (réforme qui constituera du reste le principal motif de la sortie d’hospitalisation de Betsy), mais également la monstrueuse histoire de la lobotomie transorbitaire et de ses artisans-bouchers (à commencer par Walter Freeman, ses pics à glace, sa lobotomobile et son homologue français Marcel David). Une documentation tout à fait édifiante qui vient comme un complément à l’ouvrage qu’on avait présenté pour les fêtes de fin d’année, On mass hysteria de Laia Abril qu’on recommande toujours aussi chaudement. Hystérie et schizophrénie, même combat ? A tout le moins, on n’en peut escamoter la fabrique d’une même violence sociale et institutionnelle sur le corps des femmes. Adèle Yon développe également tout un propos sur la représentation de la folie, et comment elle est essentiellement vécue par sa famille comme relevant d’une transmission génétique, relevant des corps, et non occasionnée ou majorée par des causes environnementales.
Ce que j’ai aussi apprécié à la lecture de ce livre hybride, c’est le soin accordé par l’autrice-chercheuse à vouloir resituer avec précision la configuration de l’instant, le contexte d’énonciation des verbatims des personnes de sa famille ou des professionnels rencontrés. On saisit mieux à ces endroits pourquoi la parole résiste (avec tout un tas de bouclier de protection du style «le passé c’est le passé») ou encore est rendue possible. On saisit aussi ce que ces éléments font vivre à l’autrice personnellement («J’ai le cerveau qui éclate depuis la matrice»). Ainsi, l’autrice explore avec une grande honnêteté, dans une forme d’auto-socio-analyse (d’insight?) son propre rapport à la colère ou à sa propre peur, entretenue depuis l’enfance, d’être folle ou juger comme telle.
Les dernières pages remettent en récit, en place l’histoire d’Elisabeth, et en pièce sa mystification, en pièce aussi la fresque familiale marquée par une hagiographie de l’arrière-grand-père et de son père («et si l’histoire venait [encore] d’au-dessus ?»). Et dans ce qui dépasse ou explique cette histoire, il y a une part conséquente qui est imputable au contrôle patriarcal tel qu’il a été pratiqué à l’endroit d’Elisabeth.
Adèle Yon parvient indubitablement à rendre justice à Elisabeth, et au rang des premières réhabilitations, même si cette dernière n’est que symbolique, elle lui restitue/redonne son vrai prénom, et le titre institue ainsi le commencement de ce processus de réhabilitation.
Livre d’une étonnante puissance. Très chaudement recommandé.
«La colère est ce que nous avons en partage, nous, les descendants de Betsy, ce qu’elle avait, elle, avant, ce qu’on lui a pris et qui vomit en nous».

L'arbrophone
de Donatienne Ranc
Illustrations de Barim
Editions Du Pourquoi Pas
Roman jeunesse
«Tu n’y peux rien toi, Lou… Mais vous autres les Hommes, vous vous croyez seuls sur Terre avec votre pétrole, votre plastique, vos pesticides, vos pitreries. Pourtant vous n’êtes qu’une infime partie du monde.»
On avait déjà beaucoup aimé La Kahute de Donatienne Ranc aussi aux Editions Du Pourquoi Pas. Il était déjà question d’abri et d’écologie. Cette fois, nous ne sommes plus sur une île mais dans un arbre et le vieil homme a laissé la place à une jeune fille d’une dizaine d’années, Lou. Les méfaits de la pollution sont toujours présents, le réchauffement climatique menace les arbres. «La forêt s’étiole et s’inquiète. L’eau sous terre se fait rare pour abreuver nos racines, le soleil se fait brûlant sur nos fruits, l’air colle sa poisse sur nos feuilles.»
Un roman qui pourrait nous rappeler ceux de notre jeunesse : une fillette bien débrouillarde, avec des rêves d’enfant et une autonomie déjà d’adulte, des parents tout juste en toile de fond, des cabanes dans des arbres. Sauf qu’il ne s’agit pas d’une simple petite histoire «gentillette», ce texte est aussi un véritable appel à une prise de conscience écologique et c’est la jeune génération qui pourrait bien sauver les forêts (les adultes ici ne comprennent pas grand chose, et surtout sont bien trop occupés et oublient vite l’essentiel).
Par une nuit d’été, Lou dormait dans sa cabane, construite dans les branches du châtaigner du jardin avec l’aide d’Amandine, 16 ans, fille du garagiste et sacrément bricoleuse. Soudain, elle semble entendre des pulsations provenant du tronc. Vive et curieuse, elle comprend vite que l’arbre a son propre langage et si elle en trouve le code, elle pourra le comprendre et communiquer avec lui. S’ensuit la construction d’un appareil incroyable : l’arbrophone ! Mais qu’a-t-il à dire à Lou, à nous, cet arbre centenaire ?
Barim a illustré cette histoire en donnant à Lou des faux airs de Fifi Brindacier (on retrouve ses jolies tresses rousses), et c’est vrai qu’on pourrait leur trouver une jolie filiation. L’écureuil acolyte nous observe de ses yeux tout ronds. Le châtaigner est massif, presque géant. Et l’arbrophone semble prêt à nous livrer ses messages.
Une fin ouverte, qui se termine comme se terminerait une histoire qui passerait de bouche à oreille. A force on ne sait plus bien d’où elle vient, on ne sait plus bien si elle est vraie ou pas, quelques éléments ont peut-être changé. Mais l’essentiel reste bel et bien en mémoire et elle continue ainsi de vivre et de garder en alerte enfants et peut-être plus grands.
Les arbres parlent, qu’on se le disent, et ils ont encore beaucoup de choses à nous apprendre, les enfants aussi !
«Je suis immobile, la tête contre le tronc. Soudain, je sens des coups étranges dans le bois. Comme un rythme sourd, une percussion lointaine.»
- All
- Gallery Item
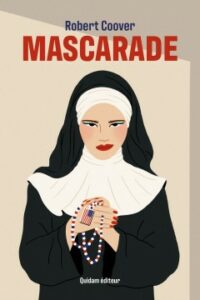
Mascarade
de Robert Coover
traduit de l’anglais par Stéphane Vanderhaeghe
Editions Quidam
«Les murs semblant s’écarter sur leur chemin, comme si l’appartement s’étirait pour faire de la place à tout ce beau monde».
Prenez un penthouse situé tout en haut d’un building. S’y joue une fête sans queue ni tête. On y croise des personnages, comme il est si bien dit dans la préface «créés à l’image de l’Amérique», «tous plus verbeux les uns que les autres», qui «ne peuvent prétendre à autre chose que de rester les mauvais acteurs qu’ils sont dans cette farce métaphysique et grinçante dont l’enjeu les dépasse allègrement». Le ton est donné. Tous les protagonistes semblent être des caricatures d’eux-mêmes, à commencer par un trio de musiciens improbables venus ambiancer les lieux. La grande réussite de ce texte tient pour partie dans le maniement amusé par l’auteur d’un «glissanto narratif» : les narrateurs se suivent et se passent le relais parfois même au sein d’une même phrase, autorisant ainsi de multiplier les points de vue, de rendre possible qu’une chose en amène une autre. Une somme de je, une somme de jeux.
Des gens qui n’auraient pas eu à se croiser se retrouvent dans cet espace-temps qui se prolonge le temps d’une soirée. Si le lecteur est un peu perdu dans tout ça c’est que la promesse de cet imbroglio narratif est tenue. Comme les invités qui ne savent pas très bien comment ils se sont retrouvés là, on cherche à savoir qui pourrait bien être les hôtes, et l’on se rend compte que les propriétaires des lieux peuvent en cacher d’autres et certains protagonistes ont leur remplaçants (barman, serveuse…). L’illusion fonctionne à plein, à l’instar de l’absence de serrure sur les portes ou de l’ascenseur hors service, à l’instar des pièces qui se forment et se déforment tout comme l’intrigue. Les participants sont contraints de jouer la comédie («cette soirée doit être un putain de cauchemar pour un rationaliste»), de suivre le mouvement, d’une pièce à l’autre, d’un fragment de conversation à l’autre. Jusqu’au toit-terrasse d’où sont jetés certains importuns sans que cela ne produise quelque émoi. Ça grouille de monde, l’effervescence carnavalesque est à son comble : une galerie de personnages chamarrés et égotistes se dessine, de l’agente immobilier, à l’écrivaine, en passant par la nonne, une femme qui n’en finit pas d’accoucher ou encore un prof qui réfléchit sur l’intelligence en essaim. Somme toute, des êtres de solitude qui tentent de survivre à leur façon («Mais pourquoi est-ce que l’on tient à ce point à l’idée même de survie ?»), tous, déraisonnables, vaniteux et ironiques à souhait, affairés «aux activités d’usage dans les soirées : ils boivent, ils flirtent, il s’échangent les tuyaux rémunérateurs, se gavent d’amuse-gueule, puis rient la bouche pleine, s’enlacent et se cognent le nez, se pincent les fesses chacun leur tour».
Toute la vacuité des existences adossée au formidable chaos d’un pays se trouve avalée en tourbillon dans cette mascarade bien sentie qui se fixerait pour horizon d’attente une danse macabre.
Un lecture certes parfois difficile qui se mérite donc mais une fois adopté le style si singulier de l’auteur, on en ressort bluffé.
«L’abrutissement pourrait bien être la seule option qu’il nous reste, si on veut survivre sur cette planète patraque».
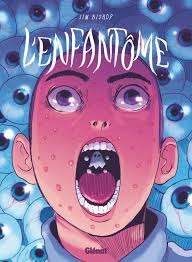
L'Enfantôme
de Jim Bishop
Editions Glénat
BD
«Le monde nous apprend à marcher sur la tête et essaye de nous faire croire que c’est bien».
Après les BD Lettres perdues, puis Mon ami Pierrot, L’enfantôme constitue le troisième volet de la «trilogie de l’enfant», mais il peut tout à fait se lire indépendamment des deux premiers.
On est au Collège et la bienveillance n’est pas au programme. L’un s’appelle le «boutonneux», la seconde «la bizarre». Ils se démènent face au regard des autres et contre une institution qui ne leur veut pas du bien et des parents qui leur mettent une pression inconsidérée. Ou comment les figures de l’autorité s’érigent en force.
Cette année est décrétée comme étant une année décisive, et le conseiller d’orientation, Monsieur Marano-qui-a-la-tête-qui-menace-d’exploser a décidé que si ces deux cancres échouaient, ce seraient à leurs parents de les tuer. Tel est le programme de motivation.
Autour du manga Pimple Attack, nait une relation d’amitié. Ils se serrent les coudes pour survivre à cette pression qui rend complètement «dingues» leurs parents, «Tout ça, parce qu’ils veulent être bien vus du système», car au conformisme punitif du collège répond celui des parents.
Plus loin (dans la deuxième partie), changement d’ambiance : on les retrouve en être-fantôme, «les grands esprits se rencontrent», toujours en recherche de sens, toujours hantés par ce jugement, tout en disqualification, qui leur a été porté et qui continue à produire ses effets («Mais cet œil qui nous juge… c’est ça qui nous a tués»). L’histoire paraît recommencer, de nouvelles humiliations sont en préparation, Monsieur Marano est devenu directeur du Collège, il les punit avec des lignes d’écritures «je suis nul». La conseillère emploi y va aussi de son verdict «vous avez écrit que vous aimeriez être gérant d’un magasin de jeux vidéo. Vous n’avez même pas le bac. A la limite, je peux vous trouvez un poste pour rayonnage». Les jugements en cascade, l’insupportable à son paroxysme.
Jim Bishop déploie toute une palette pour rendre compte de cet insupportable, les aplats de couleur sont démentiels, et l’auteur sait jouer avec les codes du manga et de l’horrifique – on est parfois pas très loin de l’univers d’un Junji Ito.
«Perso, je rentre pas dans votre jeu de bourrage de crâne qui nous amène tous au même endroit. On le sait qu’on va tous crever. Alors laissez-moi y aller à mon rythme».
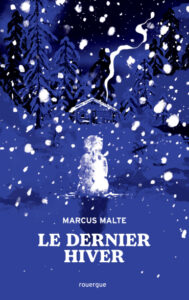
Le dernier hiver
de Marcus Malte
Editions du Rouergue
«Nous parlâmes de rêve. Nous parlâmes d’amour. Nous parlâmes de ce qui brille. De l’éclat des astres, de nos astres, quels qu’ils soient. Nous parlâmes de ce qui vaut la peine.»
Pas évident de s’adresser aux ados. Quand ils sont « lecteurs« , généralement ce sont de très bons lecteurs qui aiment lire des « pavés« . Quand ils « n’aiment pas lire« , leur proposer un court roman comme ceux de la collection Doado des éditions du Rouergue pourrait être une bonne alternative, sachant que la qualité littéraire est à chaque fois au rendez-vous. Pour autant, ça ne va pas de soi… Et c’est bien dommage car ce court roman est une pépite qui mérite d’être lu quand on a déjà quelques références historiques et littéraires. Il ne faut donc pas être trop jeune, ou alors en faire une lecture accompagnée d’un adulte.
Mais de quoi parle Le dernier hiver ? Il s’agit d’un portrait du monde sur trois siècles, un monde qui va mal et se réchauffe inexorablement. Pour nous raconter cette histoire, Marcus Malte (qu’on connait aussi bien pour ses romans jeunesse qu’adulte) choisit un narrateur un brin décalé (et en même temps directement touché par le changement climatique) : un bonhomme de neige. On pense tout de suite au poème de Prévert et ce bonhomme de neige adopté et réchauffé par la cheminée. Ici, l’être de flocon naît et meurt plusieurs fois, à des époques et lieux différents de la planète. Il a chaque fois des parents et compagnons différents, fratrie, père, élèves et professeurs, soldat, sherpa, loups… Il rencontre même Jack London et son chien Buck. Il les accompagne quelques jours, semaines ou mois, dans de bons mais aussi tristes moments. Il voit la mort de près, que ce soit de froid ou causée par l’horreur de la guerre. Il vit le silence de Tchernobyl après l’explosion. Enfin, il se retrouve de plus en plus en altitude, signifiant ainsi la fonte des neiges. Tout ceci est dit avec justesse, avec les yeux d’un observateur qui a vécu, tel un aïeul qui nous conterait son enfance. Une lecture idéale pour les vacances d’hiver.
«J’ai eu autant de vies qu’il y a eu d’hivers. Il est vrai que je ne fais pas mon âge. On m’en a souvent fait la remarque.»
- All
- Gallery Item
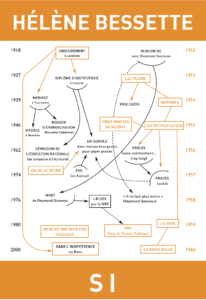
Si
de Hélène Bessette (LN B7)
Editions Le Nouvel Attila
«Je n’ai qu’une richesse.
Décider de ma fin,
Puis,
M’en allant au Ciné.
(Le suicide est pour demain.)»
Si a été édité une première fois chez Gallimard en 1964, puis en 2012 chez Léo Scheer.
Lire Hélène Bessette, c’est toujours une aventure, c’est tournoyant, tumultueux, bouleversant.
D’abord il y a la forme: à la fois roman et poésie (elle a d’ailleurs créé le Gang du Roman Poétique), presque du théâtre parfois. Une histoire en vers, des répétitions, comme des motifs qui reviennent en boucle pour chaque fois aller plus loin, aller ailleurs, mais toujours revenir au point central : l’envie de suicide de Désira. Des mots qui se détachent, en capitales, pour mieux imprimer la rétine du lecteur (« SI », « EPOUVANTE », « SUICIDE », « MAIS »…). D’autres qui se découpent, se transforment, se démultiplient. Des questions aussi, qui semblent des adresses directes au lecteur (« DOIS-JE ME SUICIDER ? », « QUI SUIS-JE ? », « MEURS-JE ? »…). Des personnes (des hommes surtout, des voisins, quelques amies) qui entrent et sortent de scène, comme ils tentent d’entrer sans réellement y parvenir dans la vie de Désira. Un roman conçu en plusieurs parties, comme pour reprendre sa respiration (car il y a de quoi perdre haleine).
Et puis il y a le fond : une femme, Désira, trente ans, divorcée souhaite se suicider. A première vue le sujet est lourd, voire plombant. Mais Hélène Bessette, au lieu de l’enfermer dans un rôle de victime, en fait une femme libre, qui revendique sa solitude et son droit à choisir de vivre ou mourir. Et cela trouble son entourage. Elle n’entre pas dans les cases prédéfinies par la société des années 50 – 60. Une femme, seule, peut-elle se promener dans la rue, aller au cinéma ? Cela questionne ses voisins qui lisent son courrier et scrutent ses allées et venues. Ses amies pensent qu’elle devrait se marier. Les hommes la soupçonnent d’être une fille-facile et tentent tous leur chance (« Tous. Tous. Chacun à sa manière. Ont les yeux fixés. Sur mon bas-ventre. Sur mon sexe. Quelles questions ai-je posées ? Qui suis-je ? Et Dois-je me tuer ? »). Mais Désira reste droite. A quel prix… La folie guette (ou est-ce son entourage qui la croit folle ?).
Et Surtout, il y a cette forme et ce fond qui s’entremêlent admirablement pour former une œuvre unique et percutante, d’une incroyable modernité.
« Je n’ai pas l’étoffe d’une héroïne. Mais cela va de soi l’étoffe d’une suicidée. »
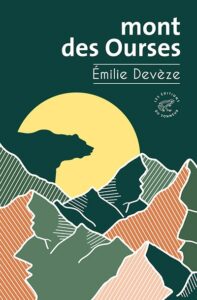
Mont des Ourses
d’Emilie Devèze
Editions du Sonneur
(couverture réalisée par Sandrine Duvillier)
«Comme bien des hommes au sommet d’un massif il croyait voir dans la terre déclive et la vallée miniature se matérialiser sa suprématie».
C’est l’histoire de Jean-Code le gendarme qui veut tout mettre au masculin, très soucieux de respecter la hiérarchie, engoncé dans ses certitudes, et qui est muté dans un village enclavé au milieu des montagnes et qui ne porte pas de nom, on l’appelle Ici. Moins de 200 âmes, «tous cousins». Il embarque avec lui sa fille Hazel (qu’il appelle Croque-au-Sel), «dressée au respect des périmètres», à qui il n’adresse quasiment jamais la parole. Hazel fait rapidement connaissance avec la voisine Ursula qui a plus d’un savoir dans son sac, ce qui peut être utile pour explorer les environs, aller sur les hauteurs (les reliefs d’une montagne accompagnent graphiquement le déroulé du roman). C’est qu’Hazel s’est mise en tête de disculper l’ourse que son père a pris pour la responsable d’un double meurtre. Et un glissement de terrain a effacé les repères («les cartes de la territorialité se trouvaient rebattues par le mouvement de sol»). Contrainte de se fier à son instinct et aux animaux avec lesquels elle se lie, s’allie.
A la lecture de Mont des Ourses, on peut penser à La sauvagière de Corinne Morel-Darleux, avec ces incursions dans la forêt où une plus grande porosité avec les animaux s’opère. L’empouvoirement d’Hazel, son émancipation passe par son enquête de terrain. Une petite troupe prend forme à partir de laquelle s’organise un contre-récit, «Avec leurs convives, ils échangeaient des recettes, des chants, des contes et des idées» ; «L’histoire du monde à mille branches se tissait autour du feu». Plus je lis et plus je me rends compte en ce moment d’une envie (doublée d’un besoin ?) de lire des contes. D’en relire certes mais aussi de faire l’expérience de nouvelles lectures qui s’apparentent à des contes. Appelons cette construction littéraire un conte philosophique ou écoféminsite, là n’est pas l’essentiel. Avec son premier roman Emilie Devèze nous offre cela, le tout servi avec pas mal d’humour. C’est fort bien réussi et on en redemande.
«Hazel s’entendait avec les bêtes. C’était de son âge, paraît-il.»

Peur de mourir mais flemme de vivre
de Salomé LAHOCHE
Editions Exemplaire
«Ces derniers temps, on parle beaucoup de santé mentale sur internet. A la fois, ça permet à des gens de poser des mots sur des troubles passés sous le radar des médecins et en même temps, tout le monde s’improvise un bac+5 en psycho et pratique l’autodiagnostic sauvage, comme si parfois c’était inconcevable d’être un être humain banal avec quelques défaillances ».
C’est avec délice qu’on s’engouffre dans cette nouvelle BD de Salomé Lahoche, qui constitue une suite de « La vie est une corvée ». On y retrouve des strips qui ont été publiés sur son compte Instagram (@salomelahoche) mais aussi dans la revue La déferlante ou la revue jeunesse Biscoto, ou encore en réponse à une commande du Centre Pompidou. Ça pourrait apparaître comme une succession hétéroclite, mais l’ensemble forme un tout cohérent. On retrouve sa petite touche arty, beaucoup de texte et cette furieuse envie de croquer le monde-tel-qu’il-ne-va-pas-mais-vraiment-pas-bien. Comme beaucoup de bédéistes, l’autrice manie avec un sens redoutable l’auto-dérision. Elle s’exprime sans fard (« parler de tout ça est sans doute la chose la plus intime que j’aie jamais racontée en bande-dessinée ») sur son rapport à la consommation, au succès («il a suffi de quelques mois à avoir vaguement de l’argent pour que je devienne une imbécile heureuse déconnectée de la réalité »), au psy. Il est aussi beaucoup question de ses comportements addictifs, à l’alcool et aux clopes (« plutôt crever d’un cancer des poumons debout qu’arrêter de fumer à genoux ») et de ses obsessions (la collection de petites perles en plastique). Tout comme les angoisses et la procrastination qui encadrent le processus créatif et les résolutions qu’elle ne tient pas (elle abandonne le yoga au bout de quatre séances après avoir payé pour un an d’avance).
On n’est pas très surpris que l’autrice ait pu faire référence au travail de la plasticienne belge Aurélie William Levaux dont on a beaucoup aimé la dernière BD, New rural wave (édition Atrabile). Elle la rejoint notamment dans cette capacité critique à faire des ponts entre les expériences intimes et le politique… Très vite on s’aperçoit dans l’abondance de texte qu’elle propose que ce qui peut s’apparenter à du dérisoire, du futile n’en est finalement pas. Au fil des pages, l’autrice devient sismographe de nos névroses et autres éco-anxiétés.
Cette nouvelle BD lui apportera à coup sûr la possibilité d’acquérir de nombreux autres critériums. Corrosif et réjouissant à souhait.
«Ce qui est marrant avec le fait de vieillir, c’est qu’on a beau savoir que ça arrive à tout le monde, quand vient notre tour, on ne peut pas s’empêcher d’être un peu surpris».
- All
- Gallery Item

Je veux regarder longtemps leurs visages
de Thomas Vinau
Editions La fosse aux ours
«Arnaquer les ténèbres, avec la cendre bleue des mots, pour aller jusqu’à eux. Arnaquer un instant les ténèbres, pour arriver jusqu’à eux, un instant et, finalement, simplement, leur dire je pense à vous.»
A la faveur de la commémoration des 80 ans de la libération des camps de concentration nazis, il y a une belle actualité éditoriale. Mais des différentes propositions, je retiendrai ce petit texte de quarante pages qui vient nous saisir. Ecrire sur une photo en noir et blanc, sur ces trente-et-un enfants d’Yzieu rassemblés au printemps 1944. Ecrire, «comme un besoin», «comme unique recours» avant l’indicible : «regarder longtemps leurs visages, et leur écrire avec la cendre bleue de mes mots». Figer le merveilleux de l’instant, l’éblouissante enfance («espiègles, maladroits, pétillants, gigoteurs», «frondeurs, (…) sales, sublimes») sans escamoter l’atrocité de l’après, «l’horreur de leur destinée» : «Eux, au-delà de cette horreur, effective, l’horreur qui les définit à présent entièrement, totalement, éternellement.»
Thomas Vinau s’emploie à évoquer cette photo qui «accroche [ses] yeux», la décrire, en rendre compte avec une économie et une justesse de mots. Sonder «les traces magiques et éphémères de leurs présences sur une image» et «atteindre l’infime chaleur de leur immense beauté saccagée». Les visages enfantins, les poses, les postures, gestuelles et expressions («un sourire qui hésite», «ce doigt dans le nez»…), les interactions, tout est passé au crible de son regard impliqué, «sous le pinceau d’archéologue de mes yeux et de mes mots». «Les voir, les regarder, les sentir». Mais au jeu des différences (les grands, les petits, les garçons, les filles), Thomas Vinau ne se leurre pas : «je sais bien que ce qui les unit, ce qui a fait qu’ils sont là, ensemble, devant mes yeux, est bien plus immense, bien plus puissant que tout ce qui les distingue».
L’auteur invente des prétextes («une vanne, un bruit indécent, une bêtise») à leurs distractions, pour expliquer pourquoi certains retournent leur tête ou baissent le regard au moment où la photo est prise. Comme n’étant déjà plus là : «Et il baisse son visage à cet instant, au mauvais moment, on ne le verra plus jamais».
La photo «qui dévore le coeur» s’affiche dans le livre à 5 reprises, en creux et en plein. L’auteur parvient, à travers elle et avec cette manière si délicate qu’il a de «faire attention à eux», à engager le lecteur à ses côtés et à leurs côtés («tellement ils incarnent, de loin, dans le temps et l’espace, tout ce que l’on sait de l’enfance qui nous touche, tout ce qu’on aime. Cette tendre surface»). Ainsi quand le poète regarde et détaille plusieurs fois la photo, le lecteur la regarde et la détaille plusieurs fois avec lui, en complicité bleue.
Les profs, dès le premier degré, auraient grand intérêt à s’emparer de ce petit livre rouge. Il gagne tellement à être lu par les plus jeunes générations.
D’une très très grande justesse.
«Mais d’abord juste l’image, veiller à cela, la photo, leurs visages, les regarder. Un par un, la beauté.»

Sophia
de Eléonore de Duve
Editions Corti
«Elle avance et tourillonne à chair perdue, agissante»
D’Eléonore de Duve on avait lu son premier roman, Donato. On s’en était fait l’écho ici avec enthousiasme. C’est donc de nouveau, un peu chanceux, qu’en tant que libraire, j’ai pu lire son second roman, Sophia. On y retrouve la même force d’évocations. A rebours (du chapitre 47 au chapitre 1), de la mort à la vie, en quarante-sept tableaux, se dessine l’agencement de la vie de Sophia, sa traversée, son vagabondage, sa métamorphose («Ses pieds nus effleurent à peine la mousse sans vie du sol, tant elle sautèle, dans un mouvement qui éviterait les mines, tant elle veut aller vite, ressentir, sans joie ni haine, sans espoir ni entrave, là, au froid»). D’une ritournelle à l’autre, d’un moment de vie à l’autre, les motifs, comme les flous, paraissent s’intriquer («Des liens se tressent lors même qu’il n’y en a pas. Les causes se trouvent ailleurs et se démultiplient dans l’engrenage»). Sophia évolue à l’écart («elle s’encage, un peu dorée, à côté de la société» ; «elle voulait former corps à part avec la tendresse»), «la solitude en bonne amie», «progresse à tâtillons», rit de bon cœur à l’absurdité des choses.
Face au chaos, à un monde ravagé, qui ne tient plus debout, Sophia «doit fermer les yeux, s’arrêter de décomposer les confusions du monde (…) s’efforce[r] de composer les idées du silence». Elle apprend aussi à «s’exerce[r] à l’espoir» à grand renfort de danse, de fiction, de couleur et de botanique.
Il y a un peu de Bérangère Cournut dans ce surgissement du merveilleux, un peu de Bronka Nowicka dans ses observations poétiques de la nature à hauteur d’enfant, un peu de Emilienne Malfatto (Le colonel ne dort pas) pour l’indétermination de l’espace-temps et pour la description des décombres d’une guerre qui ressemble à toutes les guerres et qui n’en finit pas, un peu de Kae Tempest avec cette remontée du fil le long d’une chronologie inversée qu’on retrouve dans Courir sur les cordes.
A l’image de Sophia, à l’image de l’écriture d’Eléonore de Duve qui avance à coup de virgules, le lecteur «tourne-tourne», fait des liens, des projections, associe des idées, «additionne les regards», relie les choses. Un superbe terrain de jeu que cette lecture. Il rêve même de ré-apprendre à «colorier en dépassant des bords».
Une fois la lecture terminée, on est pris de l’envie de relire le texte dans l’autre sens pour voir. Et ainsi, tout semble pouvoir recommencer.
Superbe !
« Le soir emmantèle la rivière
La lune courbe le temps.
Qui sait où le passereau s’en va. »
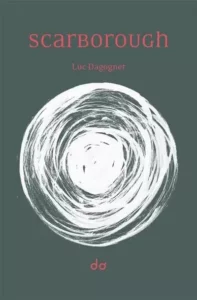
Scarborough
De Luc Dagognet
Editions Do
« Je me suis éveillé le matin avec la sensation d’avoir rêvé un message important, sans parvenir à me le rappeler. J’ai fait le tour de la chambre avant d’en sortir, au cas où le souvenir n’aurait besoin que d’un peu d’agitation pour se manifester à nouveau. »
Scarborough c’est d’abord une nouvelle d’un vieux livre offert par une vieille tante à un jeune adolescent (qui n’est autre que le narrateur du roman, devenu adulte). Dans cette histoire, au charme un brin suranné rappelant quelque bibliothèque verte de type club des cinq ou Alice, un groupe de jeunes gens partt en week-end à la campagne et pendant la nuit tous disparaissent sauf un.
Scarborough c’est aussi cette chanson de Simon & Garfunkel que notre héros entend pour la 1ère fois alors qu’il vient de lire la nouvelle. Ces quelques notes entendues dans le jardin vont lui rester en mémoire, telle une mélodie entêtante qui ne le quitte plus. Adulte, il réentend cette musique, apprend enfin son titre et de qui elle est. Et là tout se dérègle. Un mystérieux élève apparait inopinément pendant ses cours. Tout le monde semble le connaître sauf lui. Cherchant des renseignements sur la chanson, il tombe sur un enregistrement qui ressemble à une incantation « diabolique ». Puis, il fait le lien entre la nouvelle et la chanson et cherche à lire d’autres œuvres de l’auteur. Il trouve alors une autre nouvelle qui se passe… à Scarborough !
Les coïncidences s’enchainent, l’étrange et le surnaturel s’en mêlent, entrainant le narrateur dans une quête aussi floue que son esprit est embrumé (après tout la chanson parle également d’une quête pour séduire une femme : labourer un champ entre terre et mer à l’aide d’une faux en cuir, habillé d’une tunique sans couture). Il ne lui reste plus qu’à se rendre dans cette bourgade anglaise pour se défaire de ce qui pourrait s’apparenter à un maléfice. Dans cette petite ville, il fait la rencontre de Donna, de Jessie et d’Aileen, un brin sorcières, chacune à leur manière.
La chanson est toujours là et Luc Dagognet construit son roman autour de cette ritournelle, comme un refrain qu’on garde en tête et qui revient encore et encore. « Are you going to Scarborough Fair ? Parsley, sage, rosemary, and thyme ».
Laissez-vous surprendre par Scarborough.
« Tout va bien, si ce n’est la présence glaçante d’un jeune garçon inconnu, au dernier rang, qui ne fait même pas l’effort de se cacher. »
- All
- Gallery Item
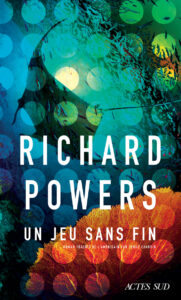
Un jeu sans fin
de Richard Powers
traduit de l’anglais par Serge Chauvin
Editions Actes Sud
Sortie le 5 février 2025
« Il fit glisser ma tour de son refuge de la ligne de fond jusqu’à un avant-poste périlleux au centre de l’échiquier.
« Ah ! Tu vois ? Ton cœur s’emballe. Ce n’est pas de la logique. C’est du drame. »
Le livre début avec une histoire, celle de la création du monde : « Ta’aora créa Ta’aora. Puis il créa un œuf qui l’abritait. » Ta’aora était artiste alors il joua, inventa, imagina les fondations de la Terre à partir des « miettes de coquille », les mers et océans à partir de ses larmes, les îles à partir de ses os, les écailles de poissons et tortues avec ses ongles. Il peupla ce monde d’autres dieux qui peuplèrent à leur tour cet univers. « Il plaça les humains – enfin des compagnons avec qui jouer. »
Tel un prologue, cette cosmogonie nous donne les pièces et le plateau de jeu dans lequel va nous embarquer Richard Powers : des humains (se prenant parfois pour Dieu), qui jouent à créer et imaginer sans cesse de nouveaux possibles, au risque parfois de (se) perdre, et un terrain de jeu (d’où le titre original « Playground »), entre terre et océans.
Si au départ il est question d’échecs, le cours des choses prend un nouveau tournant lorsque Todd et Rafi (deux figures que nous suivons tout au long du roman) découvrent le jeu de go. Il n’est plus question de faire chuter l’autre, il s’agit de construire un territoire le plus grand possible. Les combinaisons sont démultipliées. Alors que Todd y voit des algorithmes et les fondements du code informatique, Rafi, en littéraire, y lit tous les drames de la vie. A la fois si proches et si différents dans leurs modes de pensée, leurs vies se séparent. Todd devient un informaticien milliardaire à la tête d’un empire de l’intelligence artificielle. Rafi part quant à lui vivre sur une petite île du Pacifique: Makatea (île dévastée par l’exploitation intensive des mines de phosphate). Quand on sait que Richard Powers a débuté comme informaticien avant de devenir écrivain, on peut se demander si ces deux personnages ne seraient pas en quelque sorte les deux facettes de l’auteur. La richesse de ce roman est aussi de mêler deux sujets de prédilection de l’écrivain : l’IA et l’écologie. On se rappelle Galatea 2.2 ou L’ombre en fuite sur la réalité virtuelle, L’arbre Monde sur l’écologie et Sidération mêlant déjà les deux. Ici la question de l’écologie se concentre sur les milieux marins menacés par un projet de villes flottantes imaginées grâce à l’IA. La plongée aux côtés de l’océanographe Evelyne Beaulieu nous réserve les plus belles descriptions du livre.
Telles une partie de go, les histoires des différents protagonistes se développent à distance, s’intriquent par moments les unes aux autres. Tel un joueur de go, Richard Powers construit ses histoires, lentement, avec méthode. Tel l’observateur d’une partie de go, le lecteur se fait surprendre, ne peut imaginer tous les coups à venir.
Dans ce roman, qui perd ? Qui gagne ? Richard Powers jouerait-il avec nous ? « Un jeu sans fin » nous dit le titre…
« C’est ainsi que tout commença : notre grand voyage à deux dans l’univers du go. Tout ce qui se produisit plus tard – le cours que prirent nos vies – découla de l’ouverture de ce livre. »

APRES
de Raphaël Meltz
Editions Le Tripode
«Lucas se dit que s’ils avaient su, tous les quatre, lui évidemment mais aussi eux trois, s’ils avaient su, avant, que leurs jours de tranquillité étaient comptés – eh bien quoi, qu’auraient-ils fait de différent ? Leur vie aurait-elle été moins normale, moins banale, moins classique ? »
De l’auteur, nous avions particulièrement aimé son précédent livre publié sous ce même nom aux éditions du Tripode, 24 fois la vérité. De quoi surmonter cette petite réserve au moment de commencer la lecture de son nouveau roman, il faut dire qu’il est énormément question de la thématique du deuil dans cette nouvelle rentrée littéraire. Mais on ne saurait le reprocher à l’auteur et l’on devrait plutôt s’intéresser à pourquoi retrouve-t-on présentement avec autant de régularité cette forme de nécessité à (re)penser la mort à travers l’écriture, à travers le fiction.
Il convient d’indiquer que la manière dont Raphaël Meltz s’empare de ce sujet est tout à fait singulière. En effet, l’auteur s’intéresse à la fabrique temporelle du deuil du point de vue de ceux qui restent (Roxanne, l’épouse, Sofia la fille, Lorenzo le fils) mais aussi de celui est qui parti (Lucas). Un accident de vélo est si vite arrivé. Mais qu’advient-il ensuite ? L’auteur organise son roman à la croisée du temps qui se déplie (minute, heure, semaine, mois, année) et des expériences, notamment sensitives, qui se réorganisent (goûter, toucher, sentir, entendre, voir, savoir). Lucas n’est plus avec eux, «il est là sans être là» mais c’est tout comme. Et c’est dans ce paradoxe que tout se joue. «Il ne peut rien. Simplement rester près d’eux ; du côté où il se trouve». Et cela donne lieu à de magnifiques descriptions de ce qu’il ressent, de ce qu’ils ressentent («le chemin de peine pour ceux qui sont restés»), en écho souvent (ne pas disposer du mode d’emploi pour faire avec cette expérience de la mort), en complémentarité parfois mais aussi en écart (la disparition brutale versus l’expérience de s’éteindre progressivement), de par l’incomparabilité de leur situation («un qui-vive au sens du souvenir de la dualité entre une âme qui vit et l’autre qui n’est plus là»). Les souvenirs et les regrets (et quelques remords) en surimpression. La tristesse qui «ne passe pas mais qui s’espace». Lucas les observe (le sourire triste et le regard éteint de Roxane,…), Lucas les accompagne à distance dans leur épreuve du deuil, comme «une autre façon de dire au revoir, (…) une façon très lente, très continue» toujours avec une infinie délicatesse, de celle qui le fait se retirer dans certaines situations quand il n’est plus à sa place.
Lucas est tout entier pris (anesthésié?) dans un bain sensoriel infini : «Comme si la superposition entre le choc à l’intersection de la rue derrière la maison et la douceur qui s’offrait à lui faisait disparaître tout ce qui fait mal». Ainsi, l’un des tours de force de l’auteur est de décrire comment du point de vue de Lucas tout prend alors plus de relief, comme une conscience aiguë de la densité de la matière, «plus de lignes, plus de détails, plus de couleurs», tout en ayant conscience que cela est amené à s’estomper petit à petit : «faire le deuil, pour lui, c’est juste se préparer à perdre leur présence – par vagues». Tout en continuant à ressentir leurs présences, il passe ainsi une année durant par différentes étapes, perdant peu à peu l’odorat, puis l’ouïe, puis la vue… Cette progressivité se matérialise aussi dans le texte par une série de «et puis» qui vient articuler le récit et trancher avec de très longs passages entrecoupés uniquement par des virgules, aussi comme pour indiquer que la vie continue son cours malgré tout, se ponctue autrement.
Un roman sensible et délicat, qui explore finement le continuum de la présence-absence, sans jamais verser dans le pathos, mais en démultipliant les points de vue, images et ressentis qui sont à la fois ceux du disparu et des vivants (qui se trouve être le titre d’une BD parue aux éditions 2024 dont Raphaël Metz est le co-scénariste).
«Tous ces mondes que Lucas ne faisait qu’effleurer et qui sont si présents maintenant».

Je te l'avais bien dit
de Candela Sierra
traduit de l’espagnol par Rachel Deville
Editions Atrabile
BD
«Nous on ne sera jamais comme ça, on est différents».
Etre ou ne pas être le mouton de Panurge…
Candela Sierra nous propose une série de petites saynètes comme un miroir qui nous serait tendu. Ces personnages semblent un brin caricaturaux, quoique… Ils se cognent tout à tour à des problèmes d’incompréhension. Ils ont besoin tantôt de faire reluire leur ego (comme devant ce magasin de miroirs où les passants-narcissiques se perdent dans leur propre image, ou comme lors d’un enterrement où l’on pique la vedette au défunt), tantôt de ne pas perdre la face quitte à jouer des rôles dans lesquels ils se fourvoient. Quand l’effort de distinction opère pour les unes, d’aucune se distingue par son chewing-gum au curry et son sachet de tofu saveur viande, l’incapacité à choisir menace pour d’autres.
L’autrice nous amène à écouter ces small talk qui s’enchainent, de «lieu commun» en «lieu commun» (avec quelques délicieuses vignettes où les protagonistes sont accablés ou ensevelis sous des blablablablabla) ou ces dates peu concluants. L’air du temps se saisit tout entier dans ces «fréquences opposées» dans lesquelles se nouent des relations impossibles.
Les personnages se trimballent d’un univers à l’autre, de l’intime au professionnel en passant par les relations amicales, toujours en étant empesés dans un rôle ou une relation dont ils ont du mal à se défaire. Songeurs, stupéfaits, abasourdis, gênés, les personnages disent leur incompréhension toujours et encore, à l’instar de cette double page de phylactères en milieu de BD, où ce sont des formes géométriques qui ont remplacé la parole, comme de nouveaux motifs possibles de dispute. Peu d’échappatoires se présentent, quand certains s’exposent à l’autoflagellation, d’autres se conforment à la pensée du plus grand nombre, quitte à foncer tête baissée, pareille à une meute. Quand certains peinent à voir (le flou rendu par la myopie ou les problèmes soigneusement mis sous le tapis) d’autres ne parviennent pas à terminer leur phrase. L’écoute se fait biaisée («j’ai l’impression que chaque fois que je te raconte quelque chose d’important et de positif, tu fais l’impossible pour le rendre négatif et lui enlever de l’importance») ou en diagonale, les ruptures par ellipse. Comme une communication impossible ou empêchée, même avec soi, «Je pense si peu dernièrement (…) que quand je me parle à moi-même, je ne sais plus quoi dire».
Une BD rondement menée qu’on lit avec plaisir et qui invite aussi, avec le rictus sardonique qui va bien, à se moquer de soi.
«Quand tu es en groupe, tu laisses la raison de côté, tu te métamorphoses et vraiment tu peux faire peur».
- All
- Gallery Item
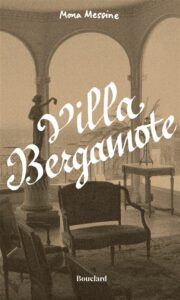
Villa Bergamote
de Mona Messine
Editions Bouclard
«J’avais toujours rêvé d’habiter quelque part une forme d’abri. Et lorsque je fermais les yeux, j’entendis à Bergamote le bruit d’un vent que je ne voulais plus quitter».
On pourrait croire à une mise en récit d’un essai du couple Pinçon-Charlot, ou à une exofiction autour de la vie des Balkany. Il y a un peu de cela dans le nouveau roman, son second, de Mona Messine. On n’est pas loin non plus de L’invitée d’Emma Cline, une percée dans le monde des ultra-riches à travers le regard non pas d’Alex mais de Roxane, issue d’un tout autre milieu et qui s’emploie à donner le change («j’ai décidé d’investir mon temps pour que l’histoire fonctionne») pour se faire adopter par cette famille et ce faisant, grimper dans l’ascenseur social. Et de toute évidence ça marche bien, puisque le mariage avec le fils de Monsieur et Madame (en majuscule s’il vous plait) est scellé et la Villa Bergamote qui trône sur les hauteurs d’un île des Antilles lui est promise. Roxane n’aime rien tant que cette villa de luxe («Bergamote m’a conquise en une seule respiration»), et puis elle a un tel besoin de disposer d’un endroit à elle chevillé au corps. Alors ici, c’est mieux encore, elle peut profiter de ce décor si faste, s’aventurer dans le jardin, profiter de la piscine, se perdre dans les différentes pièces. Mais peut-être ce lieu agit pour elle comme une prison dorée, ainsi les références à la mer, tout à côté ou presque, mais qu’elle ne parvient jamais à approcher tout à fait. Elle va d’étonnement en étonnement : surprise de la vie sociale, version comédie et manigance, qui s’organise à la nuit tombée. Fascinée par cette atmosphère qui fait et défait les réputations, les alliances par ces coulisses où se fabriquent les destins et qui prolongent ce décor faste.
Mais à défaut de connaître tous les recoins de la propriété, qu’est-ce donc ce bureau qui recèle un magnum .357, elle a plus rapidement fait le tour des propriétaires. Le vernis s’écaille, la peinture de Bergamote s’effrite («au fur et à mesure des années, je me mettais à voir la poussière et les fissures de leur échafaudage»). Investis dans la politique, le couple est pris dans des affaires, des sales affaires, blanchiment de fraudes fiscales, malversations, malgré tout l’arsenal déployé pour esquiver, maquiller. Les casseroles finissent par faire tout un tintamarre, mais rien y fait : «C’était comme si chaque accusation pouvait leur faire gagner de l’argent en plus, au moins pour diffamation, et surtout du lustre (…) A cette époque-là, le tollé fut équivalent à si l’on avait traité le présentateur du JT le plus influent de France de gros dégueulasse. On aimait le monde qui continuait. On avait peur de la rupture. C’était la force des habitudes». «Super-déni» et outrance à gogo pour (faire) oublier la corruption, passer à autre chose.
Roxanne finit par réaliser que si elle a fait en sorte d’être «pétrissable» («laisser les mots des autres faire de moi quelque chose») pour s’adapter, s’incruster, elle reste un élément de décoration, plus proche du petit personnel, et au final pas si différemment traitée qu’Alain le carlin, toujours à distance des conciliabules, des lieux où se forment les décisions. Mais elle n’est pas dupe, elle voit bien les supercheries, ici les dépôts qui s’organisent dans le garage, là l’évocation d’un conteneur. Elle ne supporte plus leur trop-plein de barbaque, la mascarade romantique a assez duré.
Dès le premier faux-pas, sa détestation finit par se voir : «je suis la traîtresse, je suis le «mais», la maîtresse, aujourd’hui le contremaître et picador». Dès lors elle prépare sa sortie, «Ce matin, j’avais choisi de boutonner lundi avec mardi sur mon chemisier. J’allais précipiter leur chute sans qu’ils s’en aperçoivent» mais c’est sans compter sur les représailles qui coagulent.
Mona Messine excelle dans le maniement des codes de la satire, de la quasi tragicomédie avec des formules qui fouettent, avec cette galerie de personnages tout à fait crédibles dans leurs agissements, et cette narratrice, détachée sans l’être, qui s’en sort à merveille dans son entreprise de démystification.
«Assez belle pour approcher le luxe de quelques soirées, trop pauvre pour arriver première sur la liste. Toute l’histoire, elle ne tient qu’à ça»

Une danse pour les doigts humains
de David Lespiau
Editions Héros Limite
«à l’intérieur
aiguilles et dés à coudre
mécanique du clavier des mains
reprise par des prothèses, des agrafes
mentale»
David Lespiau projette 112 éclats poétiques où il poétise des variations autour des doigts, des sons, des temps et des images qui s’y rattachent. Ces fragments articulés dessinent une «ligne de signes», «une ligne continue sonore labyrinthique», «une forme auto-ondulatoire en boucle», entre danse et silence, «entre deux mouvements». Les phalanges sont orchestrées, ou «tatouées de lettres». Passage en revue, dans un «temps détramé», de l’anatomie de la main, «mains de chirurgien ou de pianiste», des bouts d’ongle à la paume en passant par l’index. Ça impulse, ça compose, ça transpose, ça pianote, ça remue, ça compte, ça forme «une partition pour mots muets». Ça travaille l’écriture «au rythme tactile». Partition chorégraphiée et digitée. Langage tout en geste, entre les lettres, entre les notes. Les mots comme des doigts, qui flottent, qui martèlent, avec «un léger différé» sur le clavier. La petite musique du télétravail.
La forme de ces variations se déplie et s’agrège au gré d’observations, de descriptions, d’assertions, d’expressions telle «une phrase en train de se faire». Un jeu poétique tout en doigté.
«à tout moment sans les voir
pris dans le bourdonnement
séparer rythmes, tons, durées
les regarder tomber
entre eux»

3 secondes pour plonger
De Jinho Jung
Chez Cotcotcot Editions
Album jeunesse
« Tout le monde dit que je suis un peu mou. »
Qu’il en faut du courage pour plonger de ce plongeoir qui parait si haut ! Et pour commencer, il faut avoir le courage de monter les innombrables marches qui forment, vues d’en bas, un labyrinthe interminable. C’est le temps qu’il faut au jeune garçon que nous suivons tout au long de l’album pour recenser tout ce qu’il n’arrive pas à faire assez bien (« je ne suis bon à rien ») : manger rapidement, résoudre des calculs, jouer au baseball, battre ses adversaires au Taekwondo. Pas dit qu’il est beaucoup confiance en lui… Aura-t-il le courage de sauter ?
Mais au milieu de cette ascension, les choses se renversent. Il ne semble plus subir la situation. Au contraire, il nous explique sa philosophie de vie : « moi, gagner, ça ne m’intéresse pas. Parce qu’alors quelqu’un doit perdre. » Là, la vue est vertigineuse, on croirait tomber dans un puit sans fonds. Ce qu’il aime, c’est être avec ses amis et s’amuser à plonger. Et il y arrive très bien ! Son sourire à la fin est communicatif. Pas la peine d’être le meilleur, d’être fort, d’être rapide. Il suffit de trouver ce qui nous plait vraiment pour s’épanouir comme lui. Pas mal comme idée !
Texte (concis) et illustrations (stylo, tampon et ordinateur) se marient et se complètent parfaitement, donnant de la hauteur et de la profondeur. D’une grande efficacité. On aime aussi tout particulièrement les expressions des visages (jetez un œil aux sourcils… Ils jouent beaucoup dans la transmission des émotions).
C’est le 4ème album coréen de Cotcotcot Editions, et le 2ème que nous présentons après Le crayon de Hye-Eun Kim (qu’on aimait notamment pour la richesse des détails des illustrations). Cela nous laisse à penser qu’il faut suivre et Cotcotcot (pour ceux qui nous suivent ce n’est pas tout à fait un scoop tant on affectionne cette maison d’édition) et la littérature jeunesse coréenne !
Allez… 3, 2, 1… Lisez
« … je suis juste venu pour plonger. »
Votre libraire vous partage chaque semaine ses conseils de lecture et coups de cœur. Face à l’ immensité de choix qui s’offre à vous, constituez votre P.A.L et trouvez votre prochain livre de chevet ou une idée de cadeau. Nous pensons également à toute la famille avec nos recommandations spéciales jeunesse.
- All
- Gallery Item

La longe
de Sarah Jollien-Fardel
Editions Sabine Wespieser
«Nos vies s’imbriquent naturellement, nous mélangeons nos amitiés, nos familles, nos goûts. Notre relation ne s’encalminera jamais, elle avancera, solide et viscérale».
A ce stade, c’est sans conteste mon premier véritable coup de cœur de cette rentrée littéraire hivernale. On le sait, il n’est jamais évident de réussir un second roman, d’autant plus quand le premier (Sa préférée) a été multi-récompensé. C’est chose faite avec La longe où l’on retrouve tous les ingrédients de ce qu’on aime, une dimension romanesque consolidée, des personnages fouillés et multiples dans leur composante, une histoire d’amour qui s’écrit dans toutes les nuances, des lieux où s’ancrent l’histoire merveilleusement bien décrits, un dispositif narratif savamment maîtrisé, «la bande-son» soignée.
On suit Rose, née dans le Valais, devenue ostéopathe, mariée à Camil, un gars du coin, architecte renommé, et mère d’une petite Anna. Rose qui cultive une relation de grande proximité avec ses grands-mères, Eugénie et Lucie, un drôle de duo d’«arrières». Sauf qu’un jour la Rose, «combattive conciliante» va petit à petit s’éteindre, ne parvenant pas ou plus à faire face à un terrible événement qui est venu par effraction dans leur vie : Anna va être fauchée par une camionnette. L’horreur. «Comment dire la désolation des désolations, l’absence comme cratère». A en devenir folle comme sa propre mère qui avait «des bêtes» qui grignotaient sa tête, à ne plus pouvoir se calmer. «Je suis attachée à une longe, sans colère, absente à tout». «Rien, rien n’apaise mon chagrin qui, comme mon corps, enfle jusqu’à me faire mal aux côtes, jusqu’à m’étouffer». Hystérie, mutisme, autodestruction. Redoublement des doses de molécules.
Après un épisode d’hospitalisation, Rose va vivre plusieurs mois durant dans un mayen au cœur de la montagne, à l’abri du bruit du monde mais à l’écoute de la forêt et avec des «pensées tentaculaires» qui l’engloutissent. On va la suivre sur ce chemin escarpé du deuil.
Sarah Jollien-Fardel sonde subtilement l’état de Rose, décrit aussi les prémices de la maladie («avant que je m’enténèbre»), l’inconfort avec lequel Rose était devenu mère, tout ce qui pourrait être constitutif d’une forme de fragilité mais aussi «tout le terreau» de la résilience «entretenu par une vie de lectures et de bonté». En outre, l’autrice décrit avec une grande justesse la position intenable, tenant lieu de l’engravement (en référence au titre d’Eva Kavian paru aux éditions de la Contre-Allée, cette position comme échouée, égarée des aidants) dans laquelle est plongé Camil, celui qui donne du mou ou resserre la longe de son épouse, qui condamne les portes, qui fait prendre le traitement. Avec une situation amoureuse quasi impossible mais qui tient.
Et puis une rédemption souterraine travaille, s’esquisse à partir d’une voix, la voix d’Hélène qui se faufile à travers la porte, des lectures qui se font jour, «l’écho des émotions qui persiste après la lecture» ; «jusqu’à oublier, durant le temps de la lecture, le reste. Tout le reste». Jusqu’à redevenir une fille-oiseau (référence à «Bird Gerhl», I Am A Bird Now d’Anthony and the Johnsons).
Tout à fait for-mi-dable !
«Je m’assieds en ouvrant mes bras, il écarte les siens, nous pleurons d’autres larmes, moins douloureuses, plus amples. Elles nous rapiècent le cœur, elles nous pardonnent l’un à l’autre».

Estime de soi et fin du monde
de Luke Healy, traduit de l’anglais (Irlande) par Géraldine Chognard
Editions Cambourakis
BD
«Vous n’êtes pas fou, vous n’êtes pas un monstre, vous avez juste une petite tendance narcissique».
Luke, le personnage principal de cette BD, a clairement le visage de son auteur, Luke Healy. Mêmes traits, même prénom, même nom. Une autofiction donc ? Ce qui est sûr, c’est que ce roman graphique se présente comme une sorte de journal intime écrit à la troisième personne. Cela tombe bien, c’est justement ce que la psy de Luke lui conseille de faire pour lutter contre le stress et rebooster son estime de soi («Chaque soir, je veux que vous écriviez quelques phrases sur vous. Mais faites-le à la troisième personne : «Luke Healy est…» Soyez objectif.»)
Il est question de deuil, de regrets, de difficulté à vivre tel qu’on est, du jugement d’autrui et de la difficulté de s’en détacher. Luke est stressé, angoissé même, a une piètre image de lui. Il voit une psy qui lui donne des exercices à faire, il s’achète des livres de développement personnel, et écoute en boucle un podcast sur l’estime de soi et les voies du bien-être, persuadé, ou s’auto-persuadant d’échafauder ainsi un «plan d’auto-amélioration optimal». Il s’emploie à faire des travaux pratiques pour aller mieux, de ceux qui se revendiquent des concepts du développement personnel que Liv Stromquist s’évertue à dénoncer un à un dans sa dernière BD, La pythie vous parle.
Luke a un frère jumeau, un jumeau vis-à-vis duquel il s’infériorise en permanence, et c’est justement son frère qui prête sa voix à ce podcast de «Serenit’App». Un double, celui qu’il aurait pu être, voulu être… C’est un peu comme si son frère en personne tentait de le coacher. Plus troublant encore, ils ont la même voix, il pourrait donc avoir l’impression qu’une petite voix intérieure lui donne des conseils.
On rencontre aussi sa mère, avec qui il partage «un drôle de sens de l’humour» («On est les personnes les plus drôles de la terre, je te rappelle.»). Elle tente de lui rappeler qui il est vraiment quand il se perd un peu ou se dévalorise à l’excès.
Et puis il y a toute une galerie de personnages, juste à côté : le fiancé de son frère et son témoin, une rencontre d’un soir, deux nageurs, une archéologue, deux officiers de police, différents collègues de différentes entreprises pour lesquelles il travaille, un couple au bord du divorce, …
On croise aussi deux souris qui ne veulent que son bien et deux oiseaux (et même une baleine synthétique) qui amènent le lecteur à regarder différemment la situation qui est en train de se dérouler.
Luke tente inlassablement de reprendre le contrôle de sa vie, de se «débloquer» mais n’y parvient jamais tout à fait, se faisant déborder par les situations, pendant que le monde continue à changer et se dérégler, à l’image des tempêtes présentes à plusieurs reprises, noyant notamment Los Angeles.
Une BD inventive au niveau de la forme, à l’instar des cases, avec des vignettes encadrées et d’autres non, et avec une variation infinie de ces jeux selon les planches. Inventive aussi lorsque Luke est aux prises à des formes d’introspection.
Une BD qui vient interroger comment s’exerce le conditionnement social et les nouvelles formes de contrôle, à l’instar du coussin connecté qu’il balade avec lui en vacances pour faire croire à son employeur qu’il travaille. Luke apparaît comme un être préoccupé, avec une conscience aiguë des bouleversements de notre époque, bien en peine de trouver la place qui est la sienne pour ne pas être submergé, trop égoïste ou rester sans rien faire dans cette affaire.
«J’ai passé chaque jour de ma vie à m’inquiéter pour l’avenir. A angoisser face aux catastrophes annoncées. A m’efforcer de faire advenir des choses positives. A bosser tout le temps. Tout ça pour quoi ?»

Je me regarderai dans les yeux
de Rim Battal
Editions Bayard, collection littérature Intérieure
«J’eus le sentiment que mon visage s’était arrêté pour toujours dans cette expression de douleur, crispé dans une adolescence infinie où je devrais toujours me cacher pour avoir le moindre geste, le moindre projet, qui s’écarterait même le plus légèrement des convictions des autres».
La collection de Bayard «Littérature intérieure» veut se «concentrer sur ces mouvements intimes [douleurs, joies, éblouissements et inquiétudes] qui donnent forme à nos paysages singuliers et sens à notre existence commune». Nous sommes en plein dans ces mouvements et paysages-là dont témoigne Rim Battal à travers son personnage principal qui n’a pour seul tort d’avoir fumé une cigarette à la fenêtre de sa chambre. On a beau ne pas être sérieux quand on a 17 ans, cette chose-là ne se fait pas. Et à Marrakech, ça se fait encore moins. Cette transgression déclenche le courroux de la mère qui dans la foulée subtilise et commente au Bic rouge le journal intime de sa fille et occasionne sa fugue. Un moment de bascule advient : «peut-être étais-je, sans m’en douter, en train de quitter définitivement l’enfance, de lui faire mes adieux». Cette dernière trouve refuge chez sa tante Aida à Casablanca, fidèle alliée, mais il s’avère que cette dernière relaie l’exigence familiale («Je pensais sa confiance totale, à toute épreuve. Et la voilà qui doute de moi. La voilà qui rejoint le camp des soupçonneux qui farfouillent dans ma blessure, tirent sur l’élastique de ma culotte pour voir ce qui se passe en dessous»). Le retour au domicile ne pourra se faire que si la jeune fournit un certificat de virginité. Elle abdique finalement et fait l’objet de ce que l’autrice désigne comme relevant d’ «un viol institutionnel», «cette violence collective admise comme une célébration de la puberté». «Mon sexe avait été ouvert sans désir et sans consentement, sur ordre et avec la connivence de toutes celles et ceux qui étaient supposés me protéger de ceux qui tenteraient d’ouvrir mon sexe sans amour, de le toucher sans mon consentement».
Rim Battal rend compte de la manière dont le primat de la tradition et les codes d’honneur opèrent et infusent, comment l’injonction «vivons cachés, vivons heureux» s’organise au quotidien, à bonne distance du regard du voisin, comment le père de la personnage principale lui a appris à faire preuve de «diplomatie», «l’art du mensonge et du louvoiement» et comment la survie passe par l’utilisation d’un double discours et d’une codification du langage parlé («Nos moutons, nous les appelions aussi les champignons, c’était notre code pour parler de garçons sans être grillées par nos parents» ; son pseudo sur MSN, «Queen of the damned»). L’autrice resitue les violences intrafamiliales qu’elle a dénoncées pas à pas, d’où elles procèdent et les mécanismes de déni pour qu’elles se perpétuent : «la violence de ma mère est le résultat d’une violence plus grande qu’elle ignore avec application, qu’elle n’est pas prête à regarder en face de peur de s’écrouler, de couler à jamais». Elle réinscrit (et ce faisant d’une certaine manière réhabilite) sa mère comme étant aussi celle qui la protége ; «Soudain, je réalise le grand barrage qu’a été ma mère. Je vois ses bras ouverts, pleins de mythes et de mensonges, de combines et de tensions, pour nous protéger contre toutes les formes de violence».
La seconde partie du récit traite de l’empouvoirement de la personnage principale («j’ai su que, désormais, je construirai mon éthique moi-même, selon mes propres critères dès lors que j’ «aurais les moyens de mon autonomie» ; «j’ai perdu cette virginité du regard, j’ai les outils, j’ai un peu de savoir et de théorie 5… les mots et les concepts sont mes armes et mon armure») qui réussit à organiser, comme un retournement, une exposition adoubée par le roi du Maroc dont l’une des œuvres est un drap maculé d’une tache de sang.
Ce livre n’est pas sans nous faire penser, dans les dérives qu’il dénonce, Aux ventres des femmes, roman de Huriya (éd. Rue de l’Echiquier). Il parvient à faire passer le lecteur par une sorte de grand huit émotionnel, alternant les moments où il s’identifie avec force à la narratrice, passant de moments de révolte, de dénonciation, à des moments plus ironiques, attendrissants ou réconfortants. C’est notamment dans ce continuum d’émotions contradictoires qui accompagnent le récit des premières fois que réside la force de cette écriture.
«J’ai compris qu’un tabou pourrait être ainsi défini : zone d’ombre morale qui bénéficie à une injustice».
- All
- Gallery Item

De nos blessures un royaume
de Gaëlle Josse
Editions Buchet Chastel
«J’avais cherché mes mots, jusqu’à trouver ceux qui iraient peut-être jusqu’à toi. Entre ton monde et le nôtre, c’est ce petit pont fragile que je tente de faire tenir à chaque instant».
Encore un titre dont Gaëlle Josse a le secret, un condensé de son écriture si juste, si ciselée. De nos blessures un royaume (en allant vers ce nouveau livre on garde en tête d’autres titres comme Les heures silencieuses ; Nos vies désaccordées ; Et recoudre le soleil ; A quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ?). On retrouve là parfaitement encapsulé toute la trajectoire de vie que ce roman suggère, un je-ne-sais-quoi qui relie et prolonge aussi les titres précédemment égrenés (ainsi ce passage «les images qui attendent la nuit pour surgir» ou encore «La lumière du plein jour a effacé les ombres nocturnes»).
On suit Agnès, la narratrice, danseuse professionnelle, qui a monté sa propre salle de danse et fait des spectacles en parallèle. Ce qu’on sait très vite, c’est qu’elle a perdu, il y a déjà un an de cela, son amoureux, Guillaume. Cela précipite son départ. Seule avec son petit sac à dos, en bus, et en essayant de ne pas se cogner. Comme pour «repousser la fatalité, dompter la pesanteur».
C’est dans cette itinérance de 1000 kilomètres («avec des détours et des étapes [Mantoue, Crémone, Trieste, Zagreb], des hésitations, des repentirs, des visages, des rencontres ou des possibilités de rencontres»), ce « dépli » (pour dire qu’il ne s’agit pas d’un repli et pour dire le besoin de son corps de se déplier autrement qu’en dansant, «remettre en route la machinerie du corps» ; «Pas question de rester là, encalminée, de demeurer le jouet d’une adversité qui se moque de moi») vers différents lieux que s’établissent les coordonnées de la recherche d’Agnès.
Le seul « compagnon » de traversée d’Agnès est un livre qui était vénéré par Guillaume, Quelques Eden, lettres à ma fille de Julien Lancelle. La narration organise un va-et-vient entre des extraits de ce livre, la vie de ses personnages (Julien, Madeleine, Emma), la vie qui a été la leur avec Guillaume et le compte-rendu du voyage qu’Agnès nous relate. «La mémoire est enfer et refuge, dans ses frontières poreuses et imprévisibles avec le réel» et avec l’imaginaire, aurait-on envie de rajouter en lien avec cette référence permanente au livre inventé de Lancelle.
Si cette mise en abime permet à ce que Guillaume, jardinier hors pair, puisse se superposer à Julien, l’infatigable observateur de la nature, le périple permet, quant à lui, à Agnès de parler de Guillaume sans en avoir l’air, de l’emmêler à cette triade, comme «un écho de nos jours passés», et de se poser la question : «Qui écrit l’histoire commune, en fin de compte ?».
Et c’est au Museum of broken relationships de Zagreb qu’Agnès recherche une consolation, une destination pour déposer ce livre. Mais si le pèlerinage ultime n’aboutit pas, le temps et l’espace du deuil se métamorphosent, la quête de soi se prolonge car «le monde est en mouvement et elle aussi».
L’Esperluette recevra Gaëlle Josse le 16 mai, ça vous laisse donc 4 mois pour lire et relire ce roman très réussi.
«Il faudrait savoir garder à distance les souvenirs, les considérer comme des étoiles, lumineuses, lointaines, mais ça ne marche pas comme ça».
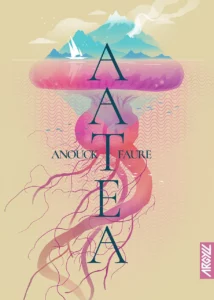
Aatea
d’Anouk Faure
Editions Argyll
«Tant qu’il a les récits d’Atura, tant qu’il a un navire, le silence, l’écrin de la Nuée autour de lui…»
On avait apprécié son univers un brin gothique et torturé qui s’exprimait dans la noirceur de la couverture de La maison biscornue de Gwen Guilyn aux éditions du Panseur. Cette fois-ci elle développe son imaginaire aussi bien par l’écrit que le dessin. Elle crée de toutes pièces un univers entre mers qui se superposent, îles vivantes et roches. La couverture (seule illustration de Xavier Colette, toutes les autres étant de l’autrice) nous laisse percevoir un monde qui pourrait, en surface, être semblable au nôtre. Mais sous l’eau, l’île semble se transformer en méduse et ses racines ne finissent pas de s’enfoncer dans les profondeurs, créant l’envie de les suivre pour découvrir des espaces peut-être encore inexplorés. A la lecture du roman, nous découvrons, par des descriptions jamais trop longues et toujours mêlées aux actions, les méandres de la Nuée (ces bras de mers qui se jettent les uns dans les autres). Et pour étoffer notre cartographie imaginaire, Anouk Faure use de son talent d’illustratrice et distille ça et là des dessins à l’encre de chine qu’elle peuple d’êtres marins, d’insulaires et autres peuples.
Si nous découvrons que les îles sont liées entre elles par ces racines, nous comprenons aussi rapidement que les humains, pour une partie d’entre eux – les insulaires, sont liés à elles par un filament au creux de leur nuque. Et seuls les personnes porteuses de ce filament peuvent fouler le sol et toucher les racines des îles sans être intoxiqués mortellement. Aatea, le personnage principal, n’en fait pas partie. Né trop tôt sur un bateau, sa mère, Kanume – grande exploratrice à la recherche d’une nouvelle île, n’a pu lui donner accès au filament de l’île Enatak assez rapidement. C’est donc en navigateur qu’il trouvera sa place (comme sa grand-tante Atura). Et c’est seul et dans la Nuée qu’il se sent le plus libre. C’est là qu’il entre en connexion avec les éléments qui l’entourent, qu’il « onçoit » (cette faculté si particulière qu’ont les navigateurs de (re)sentir les éléments, entendre les moindres bruits, percevoir toutes les vibrations du monde). Nous le suivons dans une sorte d’Odyssée où rencontres, épreuves, et découvertes se succèdent. Il fuit de tout son être les rapports de domination, cherche à aider les plus démunis, se lie à une petite fille nomade, tel un père d’adoption.
Un roman qui sent les embruns et cultive un univers à part entière qui stimule notre imaginaire.
«Il onçoit. L’une des premières règles de navigation consiste à ne pas sauter dans un nouveau danger en essayant d’en fuir un premier. Il laisse les vibrations tisser pour lui une cartographie mentale de ses environs élargis.»

Cui-Cui
de Juliet Drouar
Editions du Seuil
«Je traverse la vie dans une sorte d’acouphène permanent, une sorte de brouillard entre elle et moi».
Juliet Drouar est connu comme étant l’auteur d’essais remarqués, comme Sortir de l’hétérosexualité ou La Culture de l’inceste, qu’il a codirigé avec Iris Brey. Cui-Cui est son premier roman qui prend place sur un terrain qui a tout à voir avec les recherches (sur les violences sexuelles et dominations d’âge notamment) qu’il mène par ailleurs, et l’on y retrouve trace dans l’écriture de l’exigence de l’universitaire de bien citer ses sources, venons-en donc à cette fiction avec des notes de bas de page.
On suit, dans une France de 2027, Cui-Cui, un ado de 13 ans (il se pense au masculin mais son entourage ou au collège on lui prête un genre féminin), victime d’abus de la part de son père et qui à partir de là, cet endroit dont l’auteur ne parle qu’à partir de descriptions plus ou moins elliptiques (le bruit des pas de son père lorsqu’il se rapproche, le refuge qu’il trouve dans la salle de bain, seule pièce qu’il peut fermer à clef), est bousculé de toutes parts. Tout en douleur, le corps qui s’anesthésie, le coton dans les jambes, les sanglots de stress. «J’ai tous les membres qui claquent comme un squelette mexicain» ; «Il faudrait que je boive en continu pour ressentir quelque chose de l’extérieur et pas être entraîné par le fond».
En même temps que la violence l’enferme de manière insoutenable, à l’instar de ces démangeaisons insoutenables liées à ses crises d’eczéma ou aux automutilations qu’il s’inflige en se cognant la tête, il découvre des militants enthousiastes dans la défense de causes avec lesquelles il apprend à se familiariser, à l’instar des droits des mineurs (contre la domination adulte, et qui politise l’action de fuguer). Son repli, son malaise se ressentent au point qu’une prof, Mme Gisèle, volontariste mais démunie, se trouve investie elle aussi d’une cause qu’elle fait sienne, protéger coûte que coûte Cui-Cui. Ce volet n’est pas sans nous faire penser au livre Les loyautés de Delphine De Vigan dans la décomposition des dilemmes moraux que peut générer le fait de signaler la situation, dans les maladresses relationnelles que ça peut susciter, sur la relative méconnaissance du champ de la protection de l’enfance (comment s’y prendre, comment ne pas surinterpréter une parole recueillie, qui interpeller ?). Même s’il est résolu à partir, Cui-Cui ne sait plus trop bien dans quel espace protecteur s’abriter, celui formé par le quatuor avec Leïla, Aude et Alexandra semble ne pas suffire, faire confiance alors à l’institution scolaire et à sa gardienne Mme Gisèle ou rejoindre le collectif autogéré ?
Juliet Drouar dote magnifiquement son personnage principal d’une rébellion chevillée au corps («le poulpe géant enragé tapi dans les fonds marins»), sujet à la porosité des sentiments, l’ambiguïté des relations dont celle avec Leïla, le tout au diapason avec ce « trouble dans le genre« qu’incarne Cui-Cui.
Ce qui fait la force de ce livre tient aussi à sa langue, qui recourt ici à l’argot, là à des anglicismes, ou encore à des références cinématographiques choisies (La vie d’Adèle), ainsi qu’à une écriture nécessairement inclusive. A cette façon aussi dont le narratif ne s’épuise pas dans le réel des situations décrites, en laissant toute la place aux non-dits, encore une fois, au trouble et partant à des espaces ouverts, où le lecteur peut s’engouffrer, prolonger à sa façon ce qui n’est pas écrit.
Bouleversant mais à ne pas glisser entre les mains de celles et ceux qui se définiraient comme anti-woke, sous peine d’irruption eczémateuse subite et contagieuse.
«J’aimerais avoir une hache dans ma chambre d’enfant. Peut-être qu’à Joué Club il devrait y avoir un rayon haches».
- All
- Gallery Item

Courir sur les cordes – Running upon the wires
de Kae Tempest
traduit par Héloïse Esquié
Editions L’Arche
(Collection Des écrits pour la parole)
«Avec le temps ce sera comme si rien n’était arrivé
Avec la distance nos corps vont oublier
En attendant que l’eau chauffe, tout à coup être ramené.e.s en arrière
Et comprendre ce truc ce truc insondable qu’a dit l’autre»
A chacun de ses recueils, à chacun de ses concerts un émerveillement.
C’est peu dire qu’on accueille avec délectation ce nouveau recueil bilingue de cette figure majeure du spoken word. Le sujet (une histoire d’amour) paraît de prime abord peut-être moins incisif, moins baigné de cet art de revisiter les mythologies grecques. Mais Kae Tempest oblige, on se doit de suspendre tout jugement hâtif. Et en effet, suspendons-le.
Kae Tempest ne nous déclame pas cette histoire d’amour selon les codes usuels, c’est à rebours que l’histoire nous est présentée, comme nous le rappellent les trois parties, «la fin», «le milieu», «le début». Commencer par la fin, histoire d’amour qui finit mal comme dans la chanson («rien ne dure dit la vague tombée»), et zigazaguer dans l’intensité de cette histoire d’amour.
Ça claque de nouveau, ça relie comme on aime l’intime à l’universel.
On passe tour à tour des thèmes de la perte et de la rupture («Je te cherche mais tu as disparu» ; «Presque sûr.e que mon cœur est perdu» ; «seul.e à nouveau»), de l’espoir qui résiste («Y’a un truc bloqué en moi, un truc qui croit toujours que tu m’as pas quitté.e, un truc qui lâchera pas le rebord qu’il cramponne»), du souvenir ému («je vois la forme de ton corps dans la moindre branche d’arbre, un bol de céréales, une cruche d’eau, je te vois dans le bois flotté, la statue taguée, le toit de la gare» ; «attiré.e par un truc indicible dans une chanson»). Mais aussi de la mise à distance («trois mois sans contact») dans une forme de bulle hermétique («j’entends des cris par la fenêtre ouverte – ça me fait un choc de me rappeler que les autres existent»), de l’admiration-vénération («Je psalmodiais ton prénom je te prenais pour une divinité» ; «elle dirige le monde entier le fait tourner» ; «Et toutes les forêts sont elle, et toutes les racines, Et toutes les vallées sa voix, et toutes les comètes» ; « Le monde entier n’est qu’une mauvaise blague, une blague tordue sur ta beauté»), de la complicité («j’apprends à reconnaître chaque note sur la partition de ton silence») au rapprochement fusionnel («Notre feu rugissait avec une formidable autorité, Et il illuminait ce paysage lamentable» ; «Le matin je t’enfile avec mes chaussettes»). De la force d’aimantation de l’Autre («Et ton corps penche vers moi en tous points, comme il fait quand tu es heureuse avec moi» ; «Ses courbes sont mon seul horizon»), au tropisme de la possession («Son sourire c’était le ciel, sauf qu’il était à moi»).
Kae Tempest reprend la grammaire de l’amour dans une forme revisitée des Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes façon XXIème siècle, si ce n’est que si les fragments sont là, de discours il n’en est point. C’est du spoken word tout en ressenti, empreint de lyrisme intime.
Kae Tempest joue avec les courbes d’intensité, célèbre les courbes de la sensualité aussi, «les motifs apparaissent, réapparaissent». Iel compose une géographie de l’Amour qui s’ancre dans le nuancier de son expérience vécue. Cet amour grouille d’ardeur. Puissamment.
«Yes, we do repeat. Motifs
occur again, again
This does not mean
we are not new
You are not her.
This is not then
(Running upon the wires)»

La mer intérieure. En quête d'un paysage effacé
de Lucie Taïeb
Editions Flammarion
(Collection Terra Incognita)
«On sait qu’il faut, aux corps, donner sépulture, mais que faire d’un village rasé ?»
De Lucie Taïeb, nous avions beaucoup apprécié Freshkills, Recycler la terre (ed. La Contre Allée puis chez Pocket) , mais aussi Capitaine Vertu (ed. De l’Ogre) et plus dernièrement sa traduction de Printemps sombre d’Unica Zürn avec sa postface très éclairante.
Cette fois-ci on retrouve Lucie Taïeb avec un récit documentaire qui emprunte de nouveau à plusieurs genres et qui va prendre la forme d’une déambulation dans un récit très personnel, avec une incarnation de figures proches (mère, grand-mère, …) qui viennent comme s’incruster dans le récit.
Lucie Taïeb va s’intéresser à des villages sorabes (Cottbus, Lacoma et Horo principalement) situés dans la région de la Lusace dans l’ex-Allemagne de l’Est, au bord de la Spree, quelques villages qui ont été rasés, effacés pour les besoins de l’exploitation de mines de lignite (pour les besoins notamment de la centrale thermique située à quelques kilomètres) ; lieux finissant par devenir à l’arrêt d’exploitation de la mine de véritables no man’s land, avant d’être transformés en lac. Et une mise en abîme opère : se questionner sur la maison des autres, c’est aussi parler de la maison de son enfance à soi, «abandonnée aux ronces et aux intrus» et qui finira par brûler. Jusqu’au questionnement vertigineux : «Au-delà de quelle frontière commence le déracinement ?»
Sur le terrain ou à distance, Lucie Taïeb fait un véritable travail de recherche, à scruter les archives («l’Archive des villages disparus»), à explorer les récits alternatifs, à sonder les projets de renaturation, l’attachement au lieu (- «la questionne serait donc pas, après la perte, de trouver quelque chose qui ressemble ou rappelle ce que l’on a perdu, mais celle des conditions nécessaires à recréer un attachement, une curiosité, un désir» – dans le cadre d’une pensée très latourienne), la recréation ex-nihilo de villages «clonés», les batailles juridiques qui ont eu cours, à l’écoute des témoignages d’habitants déplacés (les époux Domain), du storytelling des compagnies à la manœuvre, des traces laissées.
Elle en arrive à considérer que «ce qui a été détruit ne peut être restauré ni remplacé. Ce n’est pas céder à une mélancolie excessive, mais seulement tenter d’imaginer une fidélité aux lieux, un attachement, que d’affirmer : l’irrémédiable existe». Pour situer ce caractère irrémédiable, Lucie Taïeb convoque le livre d’Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas où il est demandé à ce que le prince qui a usé deux chevaux puisse les restituer intacts, tels qu’ils étaient avant qu’ils ne soient saccagés. De la même façon, les archives retrouvées sont éprouvées et confrontées à l’aulne des propres souvenirs de l’autrice et notamment de présences inquiétantes, spectrales, des silhouettes mystérieuses. Ainsi chemin faisant, à partir de son terrain initial se tissent des ramifications avec la vie de l’autrice.
En rendant compte des luttes qui ont émaillé ce territoire, l’autrice évoque aussi la lutte qui a été celle, dix-neuf ans durant, de sa mère face à un cancer. Et d’insister sur l’importance d’apprendre de ces luttes.
Lucie Taïeb est invitée à une fête commémorative, mais une fois sur place, elle renonce finalement, «comme s’il pouvait y avoir quelque chose de plus intéressant ou de plus juste dans le fait de ne pas y aller», cela la renvoyant à d’autres situations vécues, amoureuses notamment, où elle s’est comme dérobée à elle-même ou à la situation. Pas vraiment de dérobade à dire vrai, mais une sorte de réserve d’inquiétude chevillée au corps, comme si elle ne pouvait parfaitement correspondre, «coïncider» avec celle qu’on attendait, avec ce qui était attendu («le protocole m’a échappé»). «Mon identité se dissipe dans l’intensité de mon regard vers l’extérieur, de mon écoute, et lorsque je reviens vers moi, il me paraît étrange de devoir répondre de quelqu’un que je suis si peu»
A la lecture de ce livre, on pense beaucoup, de par l’évocation des mines et de leurs conséquences sur les paysages, les gens qui habitent ces territoires troués, à Amiante de Sébastien Dulude (ed. La Peuplade), à Kiruna de Maylis de Kerangal (ed La Contre Allée) mais aussi, s’agissant des logiques à l’oeuvre dans la disparition de certains lieux, à Inventaire des choses perdues de Judith Schalansky (éditions Ypsilon).
Un livre où Lucie Taïeb parvient superbement à «trouver des espaces et des temps où déposer le masque». Une écriture au bord de l’abîme, d’une grande sincérité.
«Lacoma. Morne lac.
Je ne sais pas ce qu’est un lac (mais ce n’est pas cela).
Je ne sais pas ce qu’est un sol (mais ce n’est pas cela).
Je ne sais pas ce que je vois : il faut l’écrire»

Soudain Nijinski
de Perrine Le Querrec
Editions La Contre Allée
(Collection La Sentinelle)
«Après l’expérience du mouvement qu’il a menée jusqu’à son terme, avec son génie de l’excellence et de la créativité le voilà le danseur dans l’expérience de l’immobilité.»
De Vaslav Nijinski on connait le nom. Pour peu qu’on s’intéresse un peu à la danse, on l’associe à la virtuosité de la danse classique, aux ballets russes du début du 20ème siècle. Peut-être aussi au scandale de l’Après-midi d’un Faune ou du Sacre du Printemps de Stravinski. Et puis, en 1919, tout s’arrête. Ou plutôt, sa carrière de danseur s’arrête. Un mythe est né. Généralement on n’en sait pas bien plus.
Mais Perrine Le Querrec ne s’arrête pas à cet aspect de Nijinski, elle s’intéresse au contraire surtout à ce qu’on ne connait pas ou peu de lui. Elle s’appuie alors sur son expérience d’archiviste pour aller, pendant 7 ans, chercher, creuser, fouiller, compiler des informations et ainsi tenter de reconstituer l’après, combler des blancs, saisir l’état de cet homme, dans ses silences, son immobilité et ses états psychiques. «Sept années de recherches, de découvertes, de déceptions, de bouleversements.»
Elle nous partage la fulgurance de la danse de cet homme hors du commun, les louanges qu’il a pu recevoir («Et un soir il conquit Paris. Dès son apparition. Nijinski danseur étoile. Paris défile autour de lui.»), mais aussi les critiques les plus acerbes («de justes sifflets ont accueilli la pantomime trop expressive de ce corps de bête mal construit, hideux de face, encore plus hideux de profil»), face à une incarnation de la danse qui vient déranger, heurter, peut-être toucher trop fortement le spectateur. «Qui entre en danse entre en transe entre dans la procession du diable entre en possession»
Perrine Le Querrec passe aussi derrière le rideau, et nous découvrons alors les fêlures présentes dès l’enfance, les accidents de la vie («l’enfant innocent condamné à la noyade, le père immobile devant la Neva où s’enfonce le petit Vaslav», «Stanislas [son frère] grimpe sur le rebord de la fenêtre», «il y a l’histoire du pupitre à musique», «il y a [aussi] l’histoire du mariage. Romola de Pulszky, la groupie, arrive à ses fins.»), la manipulation des personnes qui l’entourent (le prince Lvov, le chorégraphe Diaghilev – «un corps sur lequel les mots Désir et Possession et Sexe et Assaut et Consommation se plantent»), jusqu’à sa femme qui ne supporte pas son état de folie et va jusqu’à orchestrer son ultime saut.
Et Nijinski s’arrête de danser, alors Perrine Le Querrec s’intéresse à ses écrits (sa notation de la danse et ses cahiers) et nous fait ressentir son état lors de ses 30 années d’errance entre différents asiles d’aliénés, passant dans les mains des éminents spécialistes de l’époque, subissant jusqu’à 228 chocs d’insuline. L’écriture de Perrine Le Querrec donne forme à cet état fait d’immobilité, de folie et de danse intérieure. Il y a les saccades, les répétitions, les silences, les respirations et les apnées, les envolées, la souffrance, le bouillonnement intérieur.
Ce livre c’est une rencontre entre le lecteur et Nijinski, entre Perrine Le Querrec et Nijinski («autant d’interprétations, autant de pas vers lui, mon Nijinski»).
«Nijinski-le-faune, Nijinski-le-spectre, Nijinski-le-pantin, Nijinski est, Nijinski sait, sa tête penchée sous le poids des cornes invisibles, force pure, il ne fait pas «le faune», «le fou», il devient, totalement.»
Elaine
