- All
- Gallery Filter

Mona
d’Aurélie Champagne
Editions Esquif
nouvelle
«Une vie pour une autre vie»
Bienvenue au Youpi Park, parc d’attraction de Gironde où travaillent la narratrice et sa collègue Flora, consolatrice en chef. Un véritable non-lieu comme dirait Marc Augé, lieu de concentration de cris d’enfants qu’il faut animer, rassasier. «En soi, le travail au Youpi n’a rien de compliqué. Gaver les gamins, tenir la caisse et briquer. Briquer, briquer, briquer. Du sol aux sanitaires, des trampolines au Dino-resto». Et à bien y regarder, la narratrice pourrait avoir quelques ressemblances avec Clara, la narratrice de Tout l’or des nuits de Gwendoline Soublin. Elle ne sont pas que dédiées à l’entretien, elles ont aussi en commun d’avoir à faire face à un deuil. Essayer de tenir en se focalisant sur la machine à granités, en tenant une «comptabilité d’orfraie». D’ailleurs ce n’est pas un hasard si le protocole que Chris le gérant n’a de cesse d’afficher partout se cristallise autour de 4 lettres, MONA, pour Ménage Ordre Nettoyage Amabilité. C’est aussi le prénom de l’enfant mort-né que la narratrice a porté. Alors la narratrice, qui développe auprès de sa collègue une théorie selon laquelle «on passe sa vie à mettre des choses à la place d’autres choses ; à combler ce qui manque avec ce que l’on trouve» finit par s’attacher à une fille qui investit Youpi Park, une fille pas comme les autres, mutique, toujours accompagnée d’une assistante familiale. «A la vue de cette petite, quelque chose en moi avait recommencé. S’était hissé hors du bourbier où je sombrais depuis Mona». Mais que va-t-il-bien pouvoir se passer à l’arrière d’une Punto quand cette fillette qui a fait l’objet d’une disparition inquiétante finit par ré-émerger, l’air de rien, dans la piscine à balles ?
Et à ce moment-là on pense fort à un premier roman qu’on avait particulièrement apprécié, Une si moderne solitude de Léna Pontgelard paru aux éditions du Panseur, ou comment Marie et Léon après avoir perdu un enfant, s’autorisent, pour l’essai, à en emprunter un.
Ce petit format qui semble être la forme qu’investit opportunément cette nouvelle maison d’édition, Esquif (on notera au passage l’excellent texte de Fabrice Caro, Rumba mariachi qui a été concomitamment publié, trois autres textes-novelas signés par Mina Zampano, Nicolas Martin et Richard Gaitet suivront dans les prochains mois) semble parfaitement adapté au temps présent où les formats courts, type série, n’en finissent pas de remporter succès après succès. Ces 41 pages sont d’une grande maitrise et, dans une belle progression, tout est délicieusement tendu vers ce moment de bascule.
Un petit «grand texte» à l’écriture tout à fait ravissante et qui vient subtilement nous saisir.
«La vérité est qu’on ne vit que sous peine d’oublier. Qu’en remplaçant les souvenirs par d’autres souvenirs. Pour que le monde devienne habitable»

La pire affaire
de Caroline Louisseize
Editions Noroît
récit-poésie
«J’aurais aimé être de celles qui ne demandent rien
qui savent dire non
sans craindre de disparaître»
Caroline Louisseize, qui est poétesse et qui est également correctrice pour plusieurs éditeurs québécois, explore l’intime des meurtrissures de l’enfance qui remontent à la surface. Elle nous livre un récit-poésie poignant sur ce à quoi elle a été exposée durant son enfance-adolescence, ce harcèlement qui ne dit pas son nom (à dessein le mot n’est pas employé) mais qui menace grandement son estime de soi. «en noyade paranoïaque, j’apprenais l’effacement, je restais dans l’attente de vivre».
Elle dresse ce combat mené en silence et en apnée pour passer inaperçue ou normale, «falloir être soi-même : la pire affaire» : «si j’étais comme les autres, je n’aurai pas besoin de regarder l’asphalte et partout autour». C’est que les moqueries, humiliations et mépris en tout genre lui font perdre «les mots de l’enthousiasme» et ne lui laissent pas beaucoup de répit : «les fracas de toutes parts, ma parole à cœur ouvert sur la place publique, déformée, décharnée, minée», «je suis poussée d’un regard à un autre, trimballée depuis le début, en fuite». Elle apprend ainsi, en ayant recours à des stratégies de survie et à une forme d’acuité psychologique à se muer «dans l’écosystème de la battue». Et, dans cette accumulation de «petits riens» qui agissent comme autant d’empêchements à l’affirmation de soi, comment distinguer l’amie de l’ennemie et comment dire tout simplement «arrêtez».
Comme dans la cabane de Steve Dubois et Charlélie Poulin dans Asphalte de Sébastien Dulude, la narratrice aime bien s’absenter des autres, se mettre à l’écart de la réverbération du jugement de ses congénères. Trouver refuge au «royaume des bouquins» ; «en attendant, dans ma cachette face au grillage, je m’exerce à vivre. Et dans le rire je demande : la lumière, la légèreté dans la beauté fauve de l’enfance». Elle se réfugie aussi dans la «chorégraphie du sérieux», celle de la bonne élève, «l’enfant wow des adultes». Par la suite, Caroline prend la mesure des «infimes fracas» enchanteurs, à commencer par «les possibles sauvetages du rire», l’infiltration de la musique qui agit comme une enveloppe protectrice («je me glisse dans le gant des sonates, j’arpente les degrés. C’est la revanche du vacarme, le bavassage des trilles») et le pouvoir du langage («Tu enquêtes sur le sens jusqu’aux pourtours du langage, et dans le langage c’est toi qui apparais»).
Un récit poétique tout à fait percutant qu’on ne se lassera pas de lire et relire. Une bien belle découverte.
«Dans ma vie idéale, il n’y a pas d’autre validation que la poursuite d’un vieux rêve tenace, la vie rêvée. Ma vie d’adulte rêvée d’enfant»

L'île des mythes - Tome 1 : l'éveil
d’Anaïs Halard & Sole Otero
Editions Casterman
BD jeunesse
« Excuse-moi, mais tu n’es pas exactement l’élite de la magie… ! »
D’abord il y a cette couverture : on reconnait en arrière-plan Blanche Neige et devant deux personnages (nous saurons ensuite qu’il s’agit d’Isia et Sora) qui semblent danser dans un halo magique, sous le regard admiratif d’une petite fille lapin Kawaï, le tout dans les couluers vives de prédilection de Sole Otero (à qui l’on doit les BD Walicho et Naphtaline).
Puis, il y a la première double page : une carte de l’ïle des Mythes : d’emblée nous plongeons dans un univers mêlant magie et histoires d’enfants. Tous les ingrédients sont présents : sorcières, pirates, gnomes, sirènes, supers héros, monstres, mais aussi contes marins, romans, mythes, mangas, etc. Le décor est planté, et il donne bien envie de le visiter.
Commence alors l’histoire d’Isia, une jeune sorcière pas très douée qui tente de se faire accepter par un groupe, pas très sympa il faut l’avouer, mené par Blanche Neige, imbue de sa personne et pas bien sympa non plus. Isia doit prouver qu’elle est capable de jeter un sort de lacets emmêlés sur un petit garçon pour le faire tomber… Un vague souvenir des bandes plutôt malveillantes trainant dans les collèges à l’affût d’une victime pour s’amuser… Sa mère ne semble pas bien croire en elle. Pas facile de s’épanouir ainsi.
Heureusement elle rencontre sa nouvelle voisine, Sora, très douée en magie. Une amitié nait et la confiance en soi apparait peu à peu.
Cette amitié sera très utile pour le tournoi lancé par Dumésa afin de rejoindre l’ile Céleste et gagner la larme de licorne aux supers pouvoirs ! Elle pourrait bien soigner le père d’Isia qui est aveugle.
Dans ce premier tome, nous ne suivons que la première épreuve : sortir d’un labyrinthe dans lequel les attend Alice. On a hâte de découvrir les prochaines !
Si cette BD est si réussie et va tant plaire aux jeunes et moins jeunes c’est grâce à la collaboration de grande qualité d’Anaïs Halard (pour les mots) et Sole Otero (pour les dessins). Tout s’articule et se répond à merveille. Les grands yeux expressifs des personnages, leurs têtes rondes, les décors très colorés nous propulsent dans un univers magique. Les dialogues donnent du caractère et amènent un humour acidulé. Et en prime, de nombreux personnages connus se sont glissés ici et là, à vous de les retrouver !
Une BD à savourer et à partager
« Salut Isia,
Si tu rêves de participer au tournoi, tu devrais le faire. »
- All
- Gallery Filter

La fabrique des timidités
de Christophe Perruchas
Editions du Rouergue
«On vit sur des fumées, des fictions de nous, c’était doux, comme imaginer.»
De 1990 à 1994, cinq étés durant, on va suivre Christophe, alias Chrispousse, le narrateur, sur la plage de la Pège à Saint Jean-de-Monts, à vendre des pralines. A partir de ses 15 ans, on le voit s’entrainer à vaincre sa timidité. Et pas seulement en sculptant son cri chouchouboudouboudou («Ce n’est plus de l’air qui sort de mes poumons, ce ne sont plus des ondes qui vibrent, flèches et cordes vocales, c’est un objet, une couleur, une consistance»). L’auteur ne s’intéresse pas à n’importe quelle timidité, il s’intéresse aux timidités adolescentes, en filant la métaphore avec la timidité des arbres, ces espaces vides entre les branches qui leur permettent de croitre sans se toucher. C’est ce qui semble aussi caractériser la relation que Christophe et Anne entretiennent. C’est dans les projections et échanges épistolaires que leur relation platonique prend forme, comme une cristallisation des idéalisations de l’adolescence. Une «histoire qui n’en est pas vraiment une», mais qui en est une quand même. On retrouve en toile de fond cette thématique de l’amour platonique, d’un amour toujours différé («On dirait le prolongement de moi, on pense pareil, on rit aux mêmes endroits, mais ça n’est pas encore le moment nous deux (…) Avec Anne, on se dit que nous, c’est pour plus tard qu’il ne faut pas gâcher»), qu’on a tant apprécié sous la plume de Marco Lodoli, avec son fabuleux roman Si peu. Mais Christophe, s’il entretient cette relation avec Anne, à distance, c’est d’abord dans son carnet qu’il écrit des pages et des pages, qu’il aime à se raconter toutes les histoires d’amour ou de retrouvailles qu’il pourrait vivre avec Anne. «Mon écriture serrée. Je pose ici notre vie idéale, celle qui adviendra. Personne ne me lit. A part elle, par-dessus mon épaule». C’est à la fois son échappée et sa pudeur et son espace d’intimité à lui dans ce camping où l’on partage tout, avec La Oie, Lapin, Marco, Didi, Phil et Cathy.
L’auteur ausculte ce qui se trame, en souterrain, à ces âges, en matière de désir, d’envie, de solitude, de tristesse, de désillusion, de l’exacerbation des goûts (ainsi le fameux goût de métal dans la bouche qui revient à plusieurs reprises). Mais le nuancier des émotions est plus fin que ça : on le voit aussi investir des relations d’autre nature, à commencer par celle avec son frère et sa sœur, fabriquer des complicités avec Lysiane, consolider son amitié avec Yvan, approfondir l’amour avec Olivia. L’aimantation des corps qui s’expérimente. L’auteur explore aussi les états de confusion, les sentiments d’absence, la brume n’affleure pas que sur la plage, elle est aussi présente dans les têtes, à commencer par celle de Christophe mais aussi lors de cette impossibilité de se rappeler pourquoi le personnage principal se retrouve au petit matin dans une tente qu’il ne connait pas, à l’écart du groupe de pairs.
Christophe Perruchas fait montre de trouvailles dans son écriture, avec l’insert de bout de phrase en italique comme le prolongement d’échanges soliloqués, le recours à une écriture en vers libres. Comme un certain Nicolas Mathieu, il arrive avec une grande justesse à encapsuler les marqueurs d’une époque en ayant recours à des extraits de chanson qui ont marqué une l’époque (Nothings compare to U) et en faisant référence aux marques de voiture (la R5 Baccara). De sorte que ces premiers boulots-vacances, on a l’impression que c’est un peu des nôtres dont il parle.
Christophe Perruchas signe ici un magnifique roman d’initiation, sensible, sur le dépassement des premières timidités.
«Dans mon carnet
je lui continue nos vies
celles qu’on n’a pas eues
et qu’on n’aura sans doute jamais»

Jamais le ciel ni les rivages
de Philippe Gerin
Editions Gaïa
«Jamais le ciel ni les rivages ne pourront nous être confisqués. Il restera toujours quelque part une montagne bleue et une rivière verte.»
Dans un futur très proche (vers 2030 ?), la guerre s’est répandue à l’est, il est question de dresser un mur pour endiguer le flux de femmes et enfants (les Ossies) qui tentent de migrer à l’ouest et le climat est complètement déréglé (après de gros incendies, une vague de froid s’abat sur l’Europe en avril). Une dystopie bien sombre et si plausible à la fois.
Lazarus a perdu un fils, Saul, deux ans auparavant. Il fuit M, sa ville natale, pour un ailleurs qu’on ne connait pas, « il n’y a plus nulle part où aller aujourd’hui… ». Pourtant, lui semble savoir où il va, « Lazarus fait glisser son index depuis la capitale allemande jusqu’au massif montagneux ». Il a avec lui un jeune enfant migrant, Anatolyi, aveugle d’un œil et qui ne parle pas, « un enfant magicien » dont il doit prendre soin. C’est Annette, marionnettiste de Berlin, qui le nomme ainsi.
Au même moment une jeune migrante, Souliko, est retrouvée morte dans une cave d’M. Tonio, le policier en charge de l’affaire, se remémore un événement traumatisant de son enfance.
Des histoires qui se mêlent, entre passé et présent, dans ce moment comme arrêté par la neige qui empèse, qui assourdit, qui fige tout, un temps en suspens.
Pourtant, chacun avait cru qu’un avenir meilleur était possible. Lazarus y avait cru lorsqu’il avait fêté l’anniversaire des un an de la chute du mur. Tout le monde y avait cru « Wir sind das Volk ». Mais à présent c’est un mur « long de deux mille kilomètres de frontières » qu’il est question de construire. Ce sont des milliers d’Ossies qui tentent de survivre.
Chaque personnage a connu des pertes, des deuils. L’absence est là, à chaque page. Comment vivre avec ?
On avait été bouleversés par La mélancolie des baleines, par la justesse des émotions dans une atmosphère déjà de fin du monde. On se souvient de cette tempête qui amène les différents protagonistes à se retrouver dans une maison du bord de mer en Islande. On se souvient aussi de cet enfant malade d’une lucidité et clairvoyance bien plus grandes que celles des adultes qui l’entourent. Philippe Gerin poursuit l’exploration de ces moments graves, il continue de chercher, comme ses protagonistes, des espaces réparateurs dans un monde en péril.
C’est un roman assez silencieux. Les quelques dialogues sont en italique, à peine dits, des pensées tout juste audibles. Les rues, bâtiments et espaces traversés semblent le plus souvent désertés, et la neige, partout, ajoute du silence au silence.
La mélancolie des personnages nous prend forcément et nous laisse avec nos propres pensées silencieuses.
Un grand roman.
«Il y a des innocents et des fautifs partout et bien souvent ce sont les mêmes.»
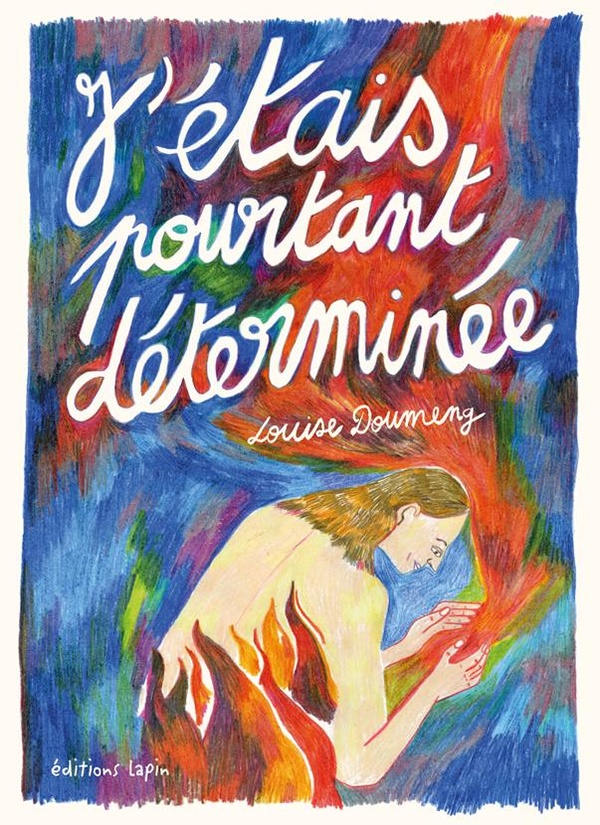
J'étais pourtant déterminée
de Louise Doumeng
Editions Lapin
roman graphique
«Il y a des gens que le tourment tient éveillés. Moi, il me tient en vie».
Louise Doumeng nous livre un journal dessiné, intime et introspectif, sur ce que c’est que de devenir adulte et artiste, les deux en un, les deux dans la même séquence. Ce roman graphique est structuré autour d’une archéologie sensible du territoire de ses 25 ans, de ses secousses, entre «défaites délicieuses, interprétations météorologiques douteuses, délires inavouables et amitiés inébranlables». On suit une galerie de personnages qui l’accompagnent dans son itinéraire de vie artistique (elle est dessinatrice et danseuse tout à la fois), à commencer par son père-en-polaire-orange, sa mère absente mais tellement présente, son papy-Paul, sa Tati Pomme, mais aussi ses potes Léonie, Renan, Etienne, Hélène, Cindy et Belette son chat, ses «petits autres» inspirants.
Les histoires s’enchainent et cette structure narrative faite de fragments est entrecoupée par des pleines pages de ciel, un ciel aux couleurs de la vie (le ciel qui brûle, le ciel tiraillé, qui se lève pour un autre jour, qui lui parle de passions, qui a une étoile de plus) et qui composent un même motif : comment être au monde avec toute sa lucidité, quand on est une femme artiste dans le milieu de la vingtaine, comment traverser les tourmentes ?
Que ce soit dans la rapport à l’autobiographie, mais aussi au format et au dessin, ce roman graphique n’est pas sans nous rappeler le travail réalisé par Julie Delporte (éditée par Pow Pown, on pense notamment à Corps vivante).
L’autrice est tenue par une réflexivité de tous les instants, elle questionne ce qui agit en elle, ses blessures, ses doutes. C’est aussi une BD sur les colères et cette force de détermination, comment ça cohabite, ce qu’on en fait. «Lors d’un stage de danse, le chorégraphe Loïc Touzé dit que la question n’est pas toujours à résoudre. Il parle de s’émanciper de la réponse, de se tenir debout dans la question ». Louise Doumeng est donc partisane de l’adage selon lequel «il n’y a pas de réponse qu’une bonne question ne sache résoudre…».
Vingt-cinq ans voire plus (on accompagne l’autrice jusqu’à ses 28 ans), c’est manifestement plus tellement l’âge des pourquoi, mais celui des comment. «Comment faire une vie d’adulte digne de ce nom ? Comment aimer les gens qu’on aime sans les anéantir ? Comment déposer les armes certains jours ? Comment les reprendre le lendemain ? Comment rendre ce monde moins dégoûtant ?». Et à cette ribambelle de «comment», il semblerait que quand elle ne répond pas à d’autres questions, l’autrice prend appui sur un poème égrainé à la toute fin comme pour y trouver trace de quelques possibilités de réponses. On (re)découvre à cette occasion la poésie d’Etienne Jodelle, et c’est tout à fait ravissant.
Un roman graphique très plaisant.
«25 ans. C’est mon âge cette année.
Dans mon imaginaire
c’était le BEL ÂGE.
Finalement c’est un bordel
SANS NOM»
- All
- Gallery Filter
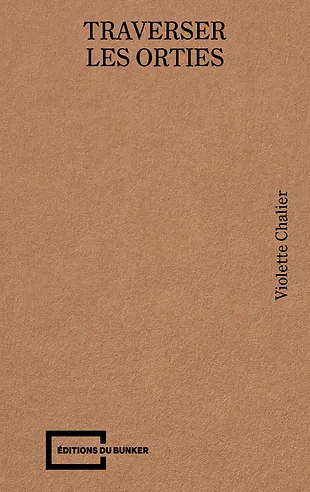
Traverser les orties
de Violette Chalier
Editions du Bunker
poésie
«Dans le flot de mes mots, je t’écris pour ne pas te perdre
C’est mon passeport entre les mondes».
Ecrire (à) son père, comme on veille sur lui. Ce que Violette Chalier sonde, c’est ce père fantomatique, qui échappe («tu n’existes pas dans le tangible, mais je te vois caché dans mes contours»), c’est plus dans la veine de l’entreprise d’Hélène Gaudy dans Archipels. Mais ici d’atelier d’artiste il n’y en a pas. Le père n’est presque déjà plus là, couché, dans l’intimité de son château-«maison de pierres froides et dures» qui elle-même tient à peine debout. «Pour extraire les pierres des histoires qui vivent dans ton poumon crevé». Reclus, c’est en conversant avec sa fille, et par le truchement de son imaginaire et de ses rêves qu’il s’évade. «Mon père dort au milieu de rêves taillés en tronçons, il les a gardés précieusement par peur qu’ils ne se réalisent. Des accumulations de songes, des gousses d’ail séchées, des stylos sans encre et des porte-clefs de marques disparues. Autant d’accroches pour ne pas accepter la péremption des choses».
Ça pourrait aussi ressembler à des retrouvailles-réconciliations sur le tard («j’ai mis à sac ma colère pour fleurir des étendues nouvelles»), comme dans le livre de Gaëlle Josse, La nuit des pères. «Ce sont cinq ans de paroles qui remuent dans la maison et définissent Un te comprendre qui s’approche de l’absolution». C’est que la maladie s’impose, l’issue fatale attend en embuscade, le deuil presque déjà là. Laissant la possibilité d’une relation filiale d’aide, de veille («Je t’aime malade puisque tu me laisses m’occuper de toi» ; «C’est le cancer de mon père qui a pavé durement le sentier à peine écrite entre les orties»). Mettre l’attente à profit pour mieux saisir qui est ce père inaccessible à l’instar de son jardin qui ne se laisse pas traverser, avec des framboisiers protégés par des ronces et orties qui rivalisent d’ardeur : «j’ai accepté d’être dépositaire de cette mémoire et de cette façon bizarre d’être au monde».
C’est que dans les plis de tous ces silences, il en reste à dire, l’urgence devient alors de recoudre les paroles, chercher les traces, «recoller les morceaux et accepter de ne pas savoir». Reconstituer la généalogie des blessures, l’oeuvre du passé. Guetter ce qui reste de lui dans les échos et le prolongement de soi : «On essuie laborieusement les ombres de nos parents sous nos propres pieds». C’est que la mécanique de la répétition peut s’enrayer : «Je ne reproduirai pas les erreurs de mon père et ne chercherai pas d’excuses, De tourmentes pour mon âme, non, Je regarderai dans mes yeux clairs – héritage paternel, Je regarderai les petits rouages – inconscience. Et les ferai sauter. Je ne serai pas prophète de malheur pour mes enfants».
Violette Chalier écrit, en creux, dans des fragments, comment la figure imposée de la masculinité, «ce malentendu» a travaillé son père, et travaille aussi tous ces hommes «qui essaient d’enfiler les costumes de militaires, d’autoritaires, de bons pères». «Je regarde passer les hommes flanchissant, soutenant une masculinité fébrile, qui fait mal, pleins d’ardeur de prouver ce qu’ils ne sont pas». Ainsi, «Y a-t-il du plaisir à être un homme que l’impératif de la domination illumine et illusionne ? ».
L’autrice intercale avec justesse quelques passages où le père s’exprime directement – à chaque fois précédés de la mention «il dit»- comme si ces passages avaient été écrits sous sa dictée, introduisant une forme de contrechamp au point de vue de la narratrice, l’une des deux filles du père, qui lui-même alterne entre le «je» et le «tu». Comme un moyen narratif d’entr’apercevoir l’intériorité du père qui «arpente l’écoulement lent du temps» ou comme une ultime tentative pour ce dernier de s’évader encore, de ne pas se laisser enclore par les seules perceptions de l’autre.
Une traversée de l’intime en poésie, d’une délicate justesse.
«Il y a un lieu étrange
Où le cri pour l’amour
Se cache derrière le repoussoir»

Rust River City
de Joe Daly
traduit de l’anglais par Fanny Soubiran
Editions l’Association
BD
«Ce mec-là, il a une connaissance fine et rare de ce qu’il est, de sa place dans le monde, il sait ce qu’il est dans le monde, et plus important encore, il sait ce qu’il n’est pas.»
Joe Daly empoigne de manière serrée le lecteur de sa nouvelle BD, Rust River City. C’est qu’il n’y a pas d’échappatoire. On suit Dean qui vient de se faire licencier. Il encaisse plutôt mal le fait que son job soit désormais confié à des chinois. Et cette décision ne peut pas plus mal tomber : il est veuf depuis deux ans et a deux enfants à sa charge. Il n’a pas le choix, il se doit d’accepter un emploi sous-payé dans le fast-food local Planet Chicken où il endure les pires humiliations.
Dean est le visage de celui qui lutte en permanence. D’une infortune à l’autre. Chacune de ses embauches ressemble à une embuche supplémentaire. L’âpreté de son existence ne fait pas mystère auprès de ses enfants, l’aîné se proposant même de travailler à son tour pour l’aider.
Dean a fait la guerre du Vietnam, et il semblerait que le syndrome post-traumatique soit toujours agissant. Aussi, il aimerait bien qu’on lui reconnaisse ce passé de GI, mais c’est peine perdu, à chaque fois qui le mentionne, ses interlocuteurs n’en ont que faire. Il n’a droit à aucune considération, excepté celle de Rufus son petit chien. La seule chose qu’un richissime producteur de cinéma est prêt à lui reconnaître n’est pas tout à fait à son goût, Dean a du mal à imaginer devenir acteur de « cinéma pour adultes de qualité », selon l’expression euphémique consacrée. Mais a-t-il le choix de refuser ?
Dean rentre chez lui harassé de ses journées à rallonge, on le retrouve là en position horizontale. Les pages défilent et l’on sent bien que c’est aussi un être empêché, fragilisé qui se carapace derrière cette représentation de brute épaisse, à l’instar de Lenny dans Des souris et des hommes. «Je suis un dur… mais pas tout à fait… parce que j’ai les pieds très délicats et très sensibles… comme des petits petons de bébé… donc faudrait que je me retrouve des souliers pour pieds délicats… ».
Le travail avec les couleurs réalisé par Joe Daly est tellement réjouissant, un jeu avec trois-quatre couleurs se déploie pour rendre lumineuses les planches, embraser Rust River City et ses occupants. Une véritable fulgurance de couleurs qui donne vie aux ombres, à une atmosphère inquiétante et des personnages interlopes qui émaillent le récit. Les personnages paraissent d’une taille disproportionnée, coulés dans le même moule d’inadaptation : il est parfois difficile de faire la différence entre un adulte et un enfant. Les visages tout en rondeur sont uniques, celui de Dean est dominée par cinq proéminences: deux yeux, deux pommettes et un nez, composantes d’un visage expressif condamné à être en permanence interloqué par les situations qui se présentent à lui. Les pommettes saillantes sont comme des excroissances qui rappelleraient combien les protagonistes n’ont de cesse de se cogner. L’ambiance est suffocante et les relents homophobes et conspirationnistes ne manquent pas. Le récit convoque un narratif hyper réaliste tout en donnant l’impression d’assister à la fin d’un monde promis à une implosion prochaine.
Joe Daly n’hésite pas à nous offrir aussi quelques incursions dans le fantastique, que ce soit aux abords de l’institut Nothwoods ou dans cette scène improbable où Bergman, jeune lycéen, ami de Danny, le fils aîné de Dean, s’incruste l’air de rien dans le cours de Mme Benway dans un lycée qui n’est pas le sien. Scène n’étant pas sans nous rappeler un épisode saisissant du livre de Luc Dagonnet, Scarborough.
Bergman pourrait tout à fait incarner une sorte d’avatar adolescent de Dean, tant il semble lui-même et les autres dans leurs interactions avec lui être alignés avec ce que Goffman désignait par le «sense of one’s place». Ainsi Bergman explique : «Les adultes… tu vois… c’est comme si… enfin ils sont juste obligés d’accepter ce que je dis, tu sais… C’est comme si j’avais une sorte de pouvoir sur eux… ou peut-être que juste ils en ont rien à secouer de moi… tu sais… c’est peut-être ça mon pouvoir… quoi qu’il en soit…. en général ils laissent couler, tu vois… J’ai un peu l’impression de me laisser couler dans la vie, en fait… les adultes… juste ils acceptent ce que j’ai à dire… ils sont pas choqués ni même intéressés par moi… donc juste ils vont genre… opter pour la voie de la moindre résistance avec moi, tu vois… et voilà…. c’est comme ça que je m’y prends…. comme ça que je roule ma bosse…». Comme un lointain écho à la figure de «ce mec-là» que semble admirablement personnifier Dean aux dire du producteur de cinéma, «Ce mec-là, il n’est pas là pour prouver quoi que ce soit à personne… sauf à lui-même… il n’est pas là pour tromper qui que ce soit… il ne fait pas semblant… il n’attend rien en retour… et c’est ce qui donne à ce mec-là son aura profonde».
Rust River City est une BD qui fait le plein de rugosités, et vient nous bousculer. Vivement le tome 2 !
«Ces mains, elles servent à bâtir… mais elles peuvent servir à détruire…»

Jours scintillants
de Morgane Bellec
Editions Le diplodocus
« Soleil, je t’aime. »
Morgane Bellec aime « les jours blancs, les jours clairs et les jours chauds », elle aime les jeux de lumière, les gros plans, les arrêts sur image, les instants volés, embrasser du regard un grand paysage ou se concentrer sur de tous petits détails. Nous, on aime cette lecture en suspens, qui nous amène à nous poser, à respirer lentement et surtout à prendre le temps de contempler ce qui nous entoure. Les choses toutes simples et qu’on oublie trop souvent de regarder.
L’économie de mots nous aide à entrer dans cette lenteur. Et surtout, surtout, ses dessins au crayon de couleurs pastels nous font ralentir encore. Ici, on admire les cils d’une jeune fille, les reflets multicolores et l’ombre qui se pose délicatement sur sa joue, comme une caresse. Là, c’est à travers un voile de rideau qu’on entr’aperçoit un jardin fleuri. On sent presque la brise entrer par la fenêtre nous souffler dans le cou. En tournant la page, on se retrouve à la fin d’une journée devant une mer d’huile, le soleil nous chauffant la peau doucement. Puis nous nous retrouvons à hauteur d’insecte, à recevoir « les rayons de soleil tamisés par les feuilles ». Et l’exploration se poursuit, toujours avec autant de sensibilité et délicatesse, laissant apparaître cette jeune fille par transparence à travers des draps qui sèchent et volettent, jeu d’ombres et de silhouettes.
Un poème fait de mots et dessins pour le plaisir des petits et des grands.
« Cette douce chaleur sur ma peau. »
- All
- Gallery Filter
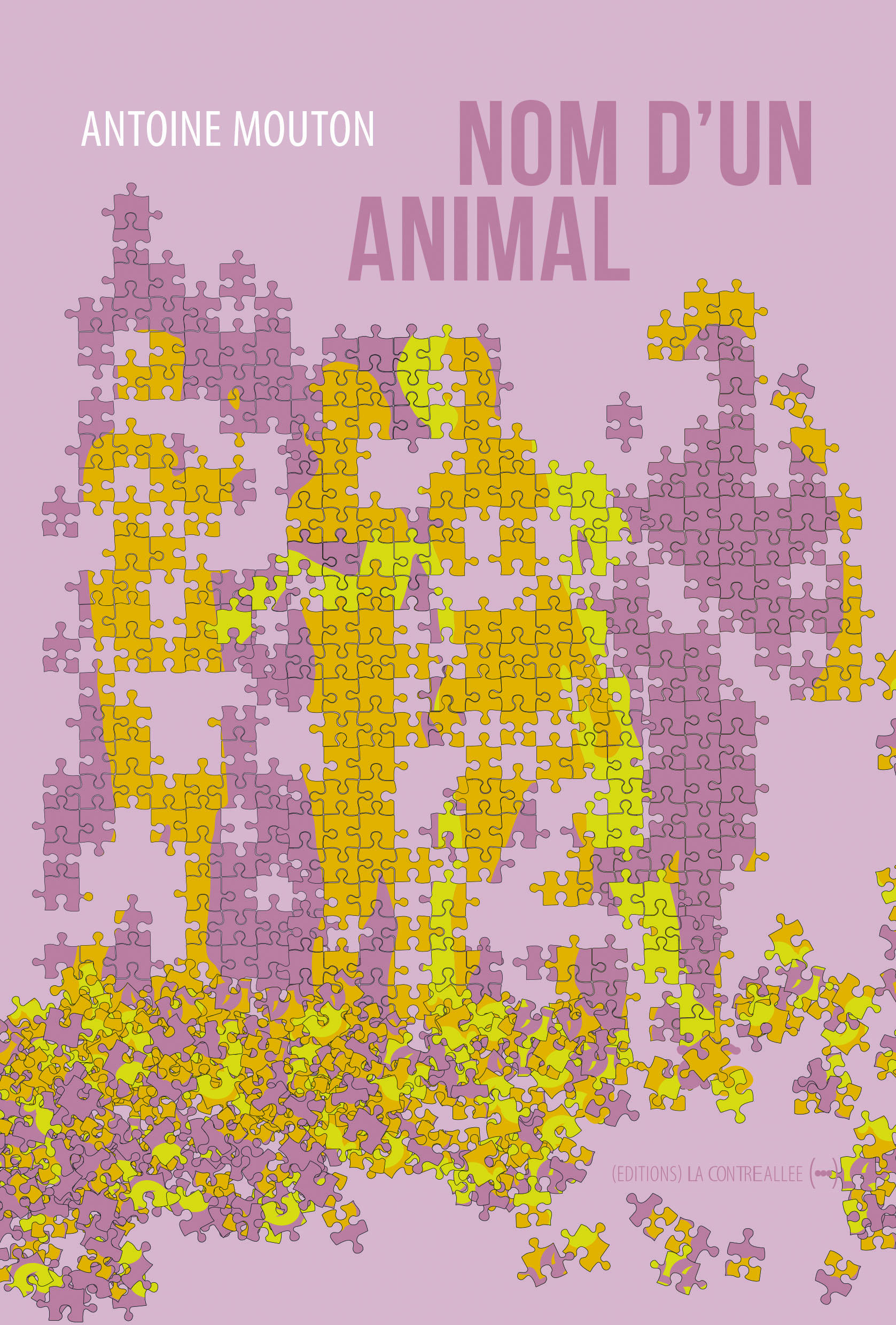
Nom d'un animal
d’Antoine Mouton
Editions La Contre Allée
«Les conversations rebondissaient d’une personne à l’autre. Sur le dos de l’animal que nous formions. Peut-être un âne. L’animal de l’enfance».
Antoine Mouton revient ici avec un cinquième titre publié aux éditions La Contre Allée. Ce texte est composé d’une forme hybride qui emprunte tout à la fois au récit, à la poésie et au témoignage. L’auteur a commencé à écrire ce texte lorsqu’il s’est éloigné d’un emploi salarié de libraire. Il y traite de ce que le travail charrie comme représentations, images, réalités, expressions toutes faites («Et voilà le travail»), mais la proposition excède la seule réflexion autour du travail, on y croise aussi son père, et des considérations établies à partir des présences-absences, des rencontres et d’un dialogue avec soi, par-dessus soi. A ce propos, Bérénice Bichat, dans un des derniers bookclub (émission radiophonique), tenait le propos suivant, «quand on s’adresse à soi-même, on le fait en vers libres», on est donc pas étonné que ce soit la forme prédominante de ce livre.
Le texte résiste à toute entreprise de catégorisation et c’est certainement très en phase avec ce que l’auteur annonce d’emblée «je chéris les espaces où je suis sans fonction». C’est que l’auteur nous parle, comme à partir d’un ancrage impossible (« Si on me demande d’où je viens, je suis embêté car je ne suis pas né ailleurs ni très loin, et pourtant je n’y suis pas resté ») de plusieurs endroits à la fois («il y a des endroits où je suis partout»), de plusieurs lieux («j’ai vu le monde de plusieurs intérieurs, de mille hublots. J’ai toujours tout recommencé repris souffle et socle touché terres »). Il le fait à partir de son monde à lui, en cultivant une distance, « entre le monde et moi, de l’air, de l’eau, du langage» et à partir de plusieurs personnes (procédé rendu possible par l’insert de témoignages qui émaillent le récit). A partir de son enfance aussi (« quand on me demande d’où je viens, je réponds : d’enfance »).
Le travail s’avère être vite insaisissable («le travail m’est tombé des mains, où avais-je la tête?» ; «Comme si le seul véritable travail avait été d’enfouir et perdre trace »), mais qu’importe, Antoine Mouton n’aime rien tant qu’entrer dans les mots, s’engager à travers eux (« langage m’engage, me dis-je »). Un tritureur des mots, «je voudrais dire chaque jour le même mot, et observer l’infime mouvement qui le broie, le déplace, le condamne ou le sacre. Lancer ce mot à travers un récit, pour voir ce qui lui arrive d’inattendu. Comme il se plie, résiste, se modifie. Comme il tombe en désuétude. L’accompagner. Changer avec lui ».
Explorer, « au fond du temps » leurs contours, leurs fissures, leurs accords, leurs écarts, leurs égarements, leurs débordements, leurs désuétudes, leurs «au-delà». C’est ainsi qu’en retournant le travail comme une pierre, il retrouve trace de son père («si j’avais soulevé le mot travail, j’aurais trouvé mon père. Mon père vivait sous le travail. Quand il rentrait à la maison, on ne le voyait pas. On voyait que le travail»).
Antoine Mouton semble plus de celleux qui entretiennent une distance amusée avec cette affaire de travail (« Ce que je préfère dans le travail, c’est d’en chercher un qui m’irait. Pourvu que ça ne m’arrive jamais. En fait je cherche un travail, mais ce n’est pas vrai »). On ne se l’imagine pas se faire des shoots aux phéromones du travail, et pendant son auscultation du mot travail, il s’allonge dedans, «question de patience et d’attention».
Il positionne ici et là des bribes de questionnements, sans cesse à recommencer, ouverts sur la reprise : « Quand tu poses une question à une question, ça s’ouvre ». Tel un funambule, il aime « rester en suspens au-dessus des surfaces », histoire de se jouer des cases. Débusquer les pièges : «grand égarement, la langue. On attend l’inouï. Mais le quiproquo a pris sa place».
Loin d’une leçon de chose qui ferait un détour par le tripalium, Antoine Mouton s’attache à faire dégorger le mot, rendre compte de ce que le travail fait faire, fait dire ou fait taire. A l’instar de ses amis «burn-outés» : «Le mot burn-out a privé mes amis de leur histoire. Ils disaient : j’ai fait un burn-out, et rien de plus. Ils n’entraient pas dans les détails. (…) J’ai l’impression que les gens qui se servent de ce mot sont en réalités employés par lui pour en faire la promotion. Qu’ils se mettent au service d’un phénomène, sans plus pouvoir atteindre ni nommer l’endroit en eux que le désastre est venu toucher.»
Le texte est également émaillé de réflexions sur le temps, «On n’est pas sûr de percevoir le temps dans l’ordre. On suit des lignes karstiques, brisées » ; le temps qui passe, qui court, qui saute, qui creuse, qui comble, il faudrait « se détacher du temps, entrer dans la durée. Flotter par-dessus la vie ». Le temps qu’on ne rattrapera pas : « quand j’ai compris mon père, c’était trop tard. (…) Je ne prendrai jamais mon père dans mes bras ».
Et cette réflexion qui affleure autour de la transmission du nom de famille, de la filiation, ce nom irréductible aux histoires de Panurge, d’Abraham, d’Ulysse. « Pas facile d’être un mouton particulier. Pas facile non plus d’être parmi les humains et pas seulement à part ou à côté ». Antoine Mouton prête attention aux noms qu’il donne, mais aussi au nom qu’il n’a pas choisi, qu’on lui a donné, à la naissance, qui lui a été transmis «Je porte le nom d’un animal, mais c’est d’abord celui de mon père » et qu’il transporte avec lui : «Je porte un nom. Je le trimballe à travers la vie ».
Quelques mots pourraient permettre d’esquisser l’entreprise à laquelle se livre, l’air de rien, Antoine Mouton : à partir du nom qui lui est propre et du mot travail, dessiner en poésie des figures communes, parler des gens, de ce qui ne va pas, nous faire réagir, nous faire sourire. Faire des liens, en toute singularité. Nous percuter comme la météorite avec Ann Hodges. Les idées sautent comme un mouton, et on rebondit avec. Ce texte est particulièrement réussi !
«Par l’écriture
je voudrais me débarrasser de la honte
pour me charger de la douleur.
Rétablir les circulations d’une peine à l’autre
-qu’une tristesse vienne en éclairer mille autres.
Et qu’aucune ne s’impose contre celle des autres.
Qu’aucune blessure ne cherche à se hisser sur la pointe des pieds,
comme un ministre trop petit».

Une histoire d'ours
d’Eowyn Ivey
traduit de l’américain par Jacques Mailhos
Editions Gallmeister
« La cabane derrière elle était désormais chaude et domestiquée, et devant elle c’était la forêt froide et sans fin, la nuit durant laquelle Arthur avait disparu. »
Une histoire d’ours est une histoire d’ours mais surtout d’humains. Il y a Birdie, jeune femme un peu fantasque qui vit en Alaska avec sa fille Emaleen. Sa vie de serveuse ne l’épanouit pas vraiment. Elle ne se sent pas à sa place et rêve de nature, d’évasion, de changement. Emaleen, 6 ans, vit dans les histoires qu’elle invente avec Thimblina, petit être vivant caché dans un dé à coudre qu’elle porte toujours avec elle (« elle ne savait pas exactement à quoi Thimblina ressemblait. Peut-être à une libellule, mais sans les gros yeux effrayants et les pattes épineuses, ou peut-être à une fée avec des ailes de papillon et sur le front, de longues antennes très fines »). Il y a aussi Della, la patronne de la Wolverine Lodge qui emploie Birdie, qui joue un peu la confidente, un peu la grande sœur. Syd, un brin philosophe. Et puis Arthur, cet homme taciturne, mystérieux, qui passe de temps en temps mais vit surtout dans la montagne. Arthur a quelque chose de particulier qui attire Birdie, il n’est pas comme les autres clients qui prennent bière sur bière ; lui boit de la tisane, a une présence spéciale, animale. L’attraction opère entre eux et Birdie décide de partir avec sa fille vivre avec lui au milieu de la forêt. Mais qui est vraiment cet homme qui connaît le nom de toutes les plantes en latin, semble marcher sans jamais se fatiguer, ne vit que dans le présent ? « Chaque chose, chaque temps, tout ça, c’est maintenant » ; « je dis que tous les temps, tous les possibles, sont maintenant. »
Il paraît aussi qu’un ours rode dans cette forêt et qu’il faut s’en méfier.
À la lecture, on pense à La Pommeraie, lu dernièrement, pour le rapport fusionnel entre une mère et sa fille, isolées de tout, en harmonie avec la nature, et pour la fraîcheur de pensée de l’enfant, si proche d’Emaleen.
On pense forcément aussi aux Mangeurs de nuit de Marie Charrel, à cette femme griffée par un ours blanc et celles qui se camouflaient sous des peaux d’ours. Il y a cette même tension entre attirance et crainte de l’animal, ce même rapport à la nature, ce même besoin tout à la fois de lien et de solitude.
Un roman qui vous prend et vous emporte à des milliers de kilomètres, au cœur d’une nature sauvage et magnifique.
« Que se passerait-il s’il n’y avait plus rien de sauvage ni d’effrayant dans les bois ? Ça ne serait peut-être pas si chouette de se tenir à la lisière des arbres. »
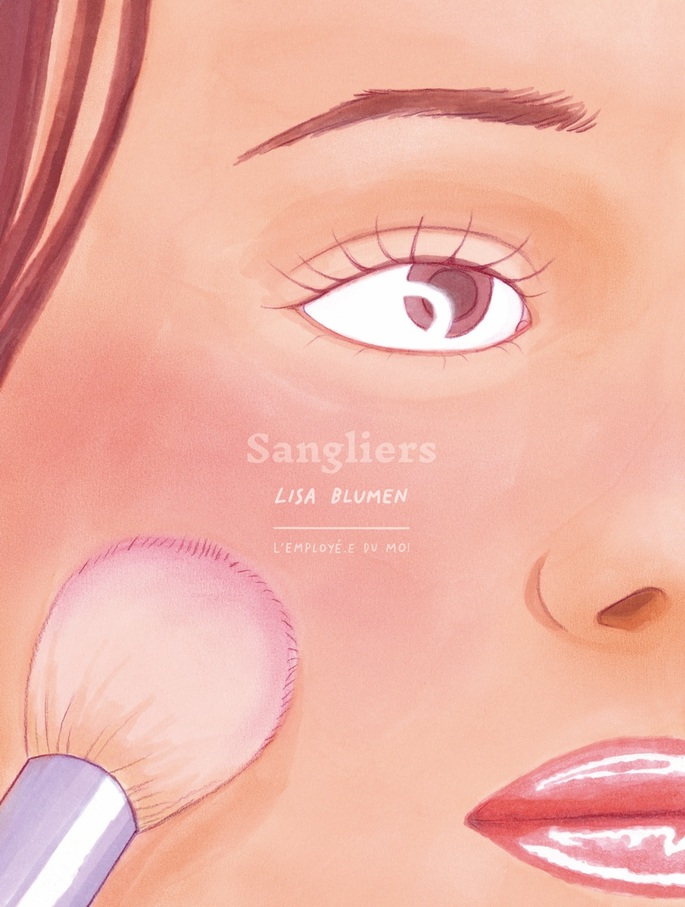
Sangliers
de Lisa Blumen
Editions L’employé.e du moi
«Mais c’est la vraie vie, internet aussi !
T’as beau faire des vidéos de qualité et être intègre,
si t’as que 1000 abonné.e.s, ça payera pas le loyer»
On avait aimé l’univers de science-fiction qui ressortait de sa précédente BD, Astra Nova, avec déjà un travail de couleurs formidable, c’est peu dire qu’on attendait la nouvelle BD de Lisa Blumen. Ici, on est dans tout autre chose, pas très loin des dérives que dépeignait Delphine De Vigan dans Les enfants sont rois. Là aussi, il est question de unboxing, mais pas seulement. L’autrice nous fait toucher du doigt le quotidien d’une influenceuse, Nina, par ailleurs, MUA (make up artist), comprendre, maquilleuse professionnelle. Quotidien codifié par l’image et l’apparence.
Nina est très suivie sur sa chaine ‘ninamakeup’, elle doit en permanence proposer des contenus (filmer sa morning routine), faire des tutos, répondre aux sollicitations de ses sponsors de l’industrie cosmétique, quand ce n’est pas à celles, insistantes, de son agent qui est du genre à lui mettre la pression (« Atterris, bordel ! Si tu veux rester dans le milieu, faut que tu prennes tes responsabilités et que tu bosses même si t’as pas envie ! »).
Elle est aussi suivie par un homme à capuche qui semble zoner devant chez elle. Un stalker et Nina a beau essayer de se persuader qu’il ne lui veut rien de mal («Il est juste… passif. Il ne veut pas interagir avec moi, il ne cherche pas à me parler, ni à me toucher, il veut juste regarder»), la récurrence de sa présence finit par l’insécuriser et devenir malsaine. Mais cette présence qui ne se cache pas, n’est pas sans lui rappeler les autres personnes qui la scrutent et qu’elle ne connait pas : « C’est un peu comme ceux qui regardent mes vidéos, sans jamais commenter ni s’abonner. Ce sont juste des présences invisibles et muettes qui me scrutent. On dirait des fantômes ». Certaines présences ont beau être virtuelles, le jour où Nina se réveille avec plus aucun contenu sur ses comptes, plus aucune follower, c’est la catastrophe.
Nina est aussi confrontée à des dilemmes moraux : on l’incite à faire de la publicité pour un mascara, produit qu’elle ne valide pas du tout («je ne sais pas si t’as lu la composition, mais c’est une usine pétrochimique, le truc !») et pourtant, contractuellement, elle se doit d’en parler favorablement. Nina doit donc se dépatouiller avec tout ça, et c’est aussi ce qui force l’admiration du personnage.
De tout cela nait une profonde solitude, qu’elle rompt tout juste lorsqu’elle voit Uma, l’ingée son, qu’elle a rencontrée sur un tournage et avec laquelle une complicité nait.
Cette BD dépeint avec force un sujet quelque peu délaissé par la fiction, celui de la marchandisation de la beauté féminine combinée à la violence de l’exposition médiatique. Le récit est également émaillé de scènes où on la voit de plus en plus exposée à des micro-agressions et à des formes de sexisme ordinaire.
Lisa Blumen manie avec brio, aux feutres à alcool, le pantone rose, en jouant sur les continuum de cette couleur.
Et le sanglier me direz-vous ? Sa présence dans le titre, mais aussi, l’air de rien, sur un tableau suspendu dans la boutique où elle va faire réparer sa caméra, ou encore en fin de BD vient brouiller les pistes. Le sanglier sème le trouble, vient enlever un peu de rose à l’histoire. A la fois hallucination et chimère, il incarne cette présence menaçante, beaucoup moins évanescente que le spectre de tous ces regards insaisissables (à commencer par le fils d’Uma) qui décortiquent et commentent les posts quotidiens de Nina Makeup. Nina ne serait-elle pas celle qui en vient à être traquée comme l’est le sanglier ?
Une BD qui vise juste et qui gagne à être mise dans beaucoup de mains.
« On te demande juste d’être jolie et divertissante. »
- All
- Gallery Filter
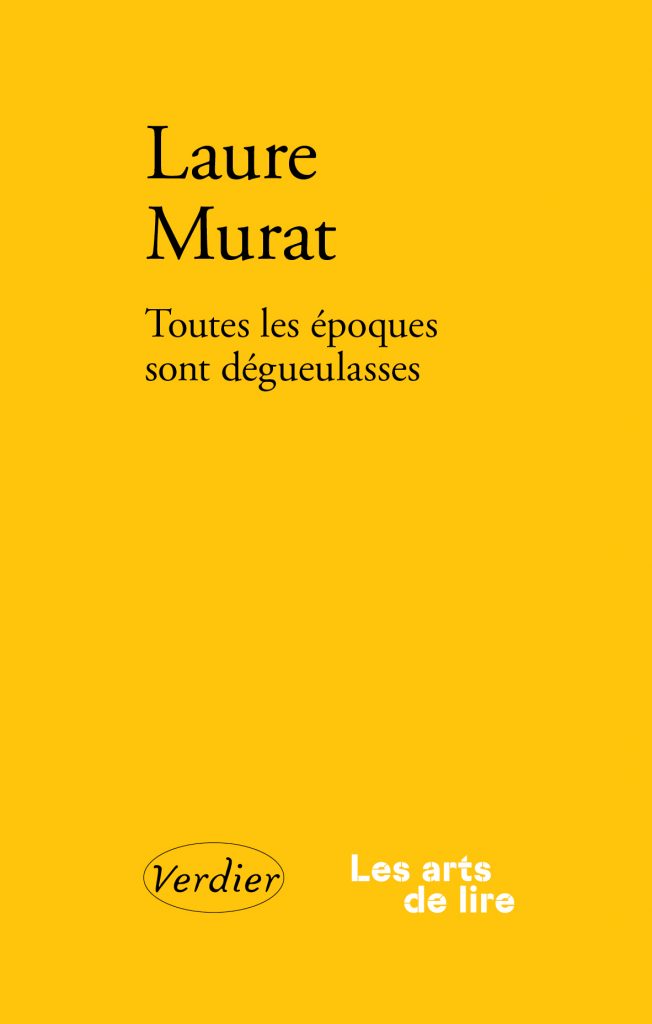
Toutes les époques sont dégueulasses
de Laure Murat
Editions Verdier
«Doit-on réécrire nos livres pour ne pas offenser les sensibilités ? »
Pas facile d’écrire sur ce petit livre alors qu’il bénéficie déjà d’excellentes critiques. Il y avait comme une urgence à m’en saisir et c’est tant mieux que cela ait agi comme tel.
Rappelons que Laure Murat est professeure à l’UCLA, pour dire que de sa place elle entrevoit bien de quoi il en retourne de ce qui fait office de «guerres culturelles» ou du « politiquement correct »
Très vite le ton didactique est donné : l’autrice nous invite à une éclairante et salutaire distinction entre ce qui relève de la réécriture, « pour réinventer à partir d’un texte existant, une forme et une vision nouvelle » – elle aime à citer en la matière Sacrées sorcières de Pénélope Bagieu et le livre à paraître en français de Percivall Everett, James ; et ce qui relève de la récriture, «pour désigner tout ce qui a trait au remaniement d’un texte à une fin de mise aux normes sans intention esthétique ».
«La récriture n’est pas une fausse bonne idée. C’est une vraie mauvaise idée, qui ouvre la voie à tous les abus. Car jusqu’où remonter dans le temps et sur quels textes intervenir ? Pour corriger quoi ? »
On comprend mieux là où les récritures se perdent quand on suit les exemples que convoquent Laure Murat : Agatha Christie, Roal Dahl, James Bond. Ces récritures, ou « nettoyages approximatifs » paraissent plus relever de la cosmétique (d’une « demi-mesure »), en changeant le titre ici, euphémisant un terme là, alors que toute l’économie du texte, l’intrigue dans son entièreté continue à faire le lit de stéréotypes sexistes, racistes ou antisémites, c’est selon. D’autant que certaines indignations restent sélectives : on ne trouve guère de pourfendeurs de Game of thrones alors qu’on n’est pas loin d’assister à un viol et un inceste par épisode.
Finalement, ces entreprises de récriture, d’ « arasement » seraient plus conduites pour se conformer à des canons marketting, faire en sorte que l’œuvre puisse continuer à « correspondre aux attentes des nouvelles générations ». Ce faisant, ces aggiornamentos opportunistes permettraient surtout de préserver la « valeur lucrative » des œuvres concernées. Sans compter qu’il s’agit aussi d’une attaque en règle de la littérature, dans la mesure où «seul l’auteur devrait être en droit de modifier son texte».
L’autrice revient aussi tout à fait à propos sur la controverse qu’il y avait eu sur le recours aux sensitivity readers. Elle indique en quoi Kevin Lambert avait eu, s’agissant de la littérature contemporaine, complètement raison d’en revendiquer le recours.
Laure Murat rappelle tout l’intérêt du travail de contextualisation (via les préfaces, postfaces et autres notes de bas de page) : « la préface est le dispositif idéal pour mettre de l’intellect à la place de l’affect qui brouille les meilleurs esprits, et fournir des outils capables de transformer la souffrance et le ressentiment des gens ciblés en objet de réflexion ».
Laure Murat, par la force des exemples convoqués, la rigueur de son argumentation, réussit parfaitement à remettre un certain nombre de choses à leur place, ou les pendules à l’heure, c’est selon, et sans pour autant «penser contre son camp».
«Que faire avec ces œuvres populaires mais qui ne répondent plus à nos critères et diffusent des stéréotypes dont il est plus que jamais nécessaire de se débarrasser ? »

J'étais dans la foule
de Laura Tirandaz
Editions Héros-Limite
poésie
«Tous les arrondis des visages
Il ne reste que des présences
trouées de lumières
Inscrire le destin de chacun
de chacune
sur ses traits».
Faire de la ville une expérience, une innocence : s’anonymiser dans la foule, traverser les espaces, scruter l’infinité des visages («une femme visage ouvert», «visage de prophète», «visage à court-circuit», «visage serrure»). Au croisement de l’urbanité : les corps passent, l’époque aussi : « sur les quais, dans les rues éclaboussées, lumière urine, Une existence comme une pièce à décorer ».
Laura Tirandaz explore ce paysage minéral, ce « décor mélancolique », écoute (le «bruit des pas trop harmonieux pour ne pas être une menace », « le bruit de ma pluie », les « voix étouffées dans le nid de la gorge »), regarde, regarde encore et rend compte de ses observations urbaines «la ville dessine de nouveaux traits, quelques millimètres de drame intime». Des observations qui se font au niveau du sol, des pieds (« un vêtement à terre », « on s’est mis à ramper » ; « la peur roule jusqu’à son pied ») comme pour mieux appréhender les dénuements des lieux, des êtres («le café froid auquel il se résigne, un fond de nuit, Quelqu’un à qui on a enlevé la peau et les verbes »).
Elle nous offre une traversée poétique, d’un déplacement à l’autre. Jeu de rapprochement : «Nous nous sommes croisés qui avait avalé quoi ? Qui envahissait le rêve de l’autre ? Nous avions la même insomnie, la même honte ».
Et si c’était dans ces interstices d’urbanité que l’autrice reconfigurait son propre paysage, «à espérer que les lignes se séparent pour un plus bel espace».Tout en se méfiant des béances et de leur attirance ambivalente (« le goût des portes qui feraient mal»), et de se rappeler de la nécessité de s’agripper pour ne pas tomber (« si tu pouvais me coudre une main »)
La nuit, toujours à portée de paupière, n’en finit pas de s’étirer, favorable aux «lianes du sommeil» et au travail des souvenirs.
Une poésie qui se fait l’écho de réflexions qui se situent dans les bruissements et l’expérience de la solitude, comme pour mieux questionner l’identité et de quoi se compose le collectif. Une poésie qui participe, avec son jeu de contrastes, à faire de cette expérience subjective, propre à l’autrice, une expérience sensible où le lecteur peut se reconnaître et aimer se perdre à la fois.
«S’organiser pour laisser
aux matins blancs
un dernier message
une douceur d’ortie
le temps d’apparaître»
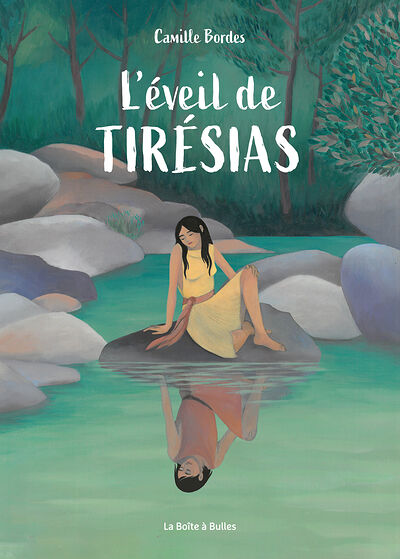
L'éveil de Tirésias
de Camille Bordes
Editions La Boite à Bulles
« Dis donc, depuis quand être une femme serait une punition ? »
Camille Bordes s’était penchée sur l’histoire de Tirésias lors de ses recherches en histoire des arts sur les représentations symboliques des serpents dans l’antiquité. Ecrire et illustrer une BD sur cette histoire mythologique lui permet également de traiter de la question de genres qui l’intéresse particulièrement.
Tirésias, c’est ce célèbre devin aveugle de Thèbes. Mais qui connaît ses métamorphoses ? Camille Bordes choisit de développer cette partie de sa vie, autrement dit du moment où il voit Athéna nue et se voit transformé en femme jusqu’à sa rencontre avec Zeus et Héra où il deviendra aveugle et devin. Entre temps, il (ou plutôt elle) doit s’habituer à son nouveau corps. Pour cela, elle est accompagnée de sa mère Chariclo, avec laquelle elle s’exerce à un jeu de poste botanique, et d’un groupe de jeunes femmes. Elle découvre ensuite cette force de vie interne par le biais des règles, du plaisir sexuel avec Hermès et de la maternité. Mais lorsque certains évoquent deux apparences et identités successives, Tirésias insiste sur le fait qu’il n’en est rien, elle est bien toujours la même. «Et crois-moi, enfermer hommes et femmes dans des rôles étriqués est une erreur. Je pense qu’il existe justement une infinité de façon d’être. Et pas seulement deux ! »
Au bout de sept années elle redevient homme et Zeus et Héra en profitent pour le questionner sur le plaisir masculin et féminin. Sa réponse offusque Héra qui le prive de la vue. La suite étant davantage connue, Camille Bordes préfère s’arrêter là. Ainsi, elle se concentre sur ces quelques années de transformation et d’initiation au monde féminin.
Pour servir cette histoire, elle peint les illustrations à la peinture à l’huile dans un jeu de couleurs pastelles amenant des ambiances parfois oniriques, parfois très réalistes (on en ressentirait presque la chaleur du soleil). Et c’est dans ces alternances que les couleurs opèrent au plus juste. On prend d’ailleurs toute la mesure de ce travail des couleurs lors des pleines pages qui jalonnent le récit.
L’ensemble est doux et délicat. Même les serpents ne sont pas très menaçants, au contraire, l’un d’entre eux (jaune tacheté de rouge) vient régulièrement converser avec Tirésias.
Le récit invite à faire des liens avec d’autres histoires de déesses et de dieux, c’est comme un défilé de divinités qui se présentent à nous, avec pour certains passages de vrais approfondissements proposés (cf. Caenis qui devient Caené). En refermant ce livre, histoire de poursuivre cette incursion dans la mythologie grecque et Tirésias, on a envie de reprendre certaines lectures : celle de Jean-Pierre Vernant, comme L‘univers, les dieux, les hommes, le recueil de Kae Tempest, Etreins toi, ou encore la BD de Séverine Vidal et Marion Cluzel Le seul endroit.
Camille Bordes parvient à travers ce récit initiatique à aborder, de façon renouvelée, la question de la fluidité des genres et des personnes transgenres et sans que cela ne se pose, avec gravité, en terme de problématique. Une première BD particulièrement réussie.
« J’ai été métamorphosé par une déesse. J’ai été femme, mère, amant d’un dieu et, pour couronner le tout, me voici désormais aveugle ! »
- All
- Gallery Item

Quand viendra l'aube
de Dominique Fortier
Editions Grasset
«Ces jours-ci, le plus souvent, je suis heureuse par éclairs. Ils durent parfois quelques minutes et parfois des jours. Le reste du temps, je suis inquiète, soucieuse, impatiente, souvent tout cela à la fois. Je ne suis pas sûre de croire au bonheur comme à un état habitable à long terme.»
Tout d’abord, la couverture du livre interpelle… On y voit un oiseau, des surfaces à l’aquarelle dans différentes teintes de bleu, quelques lignes. A mieux y regarder, on peut voir un deuxième oiseau et peut-être que certains traits sont des gouttes de pluie qui tomberaient de nuages. Et puis c’est un petit format d’une centaine de pages… Un petit livre d’art ? Un livre jeunesse (ou plutôt de ces albums qui peuvent être lus à partir de l’enfance mais conviennent tout aussi bien à des adultes) ? Je dirais qu’il s’agit d’une forme d’art, celle d’agencer les mots et de faire apparaître des mondes, il n’est pas pour la jeunesse mais parle de la jeunesse de l’autrice et de celle de son père, et même s’il n’est pas à proprement parler un livre de poésie, celle-ci est partout, à chaque page.
Dominique Fortier nous parle d’elle, de son père qui vient de mourir, des paysages qu’elle aime parcourir, des auteur.ice.s qui la touchent (Leonard Cohen, Emily Dickinson, Rebecca Solnit, Sartre, Camus, Orwell, Ronsard, Bobin et bien d’autres). Une succession de très courts textes, des pensées posées sur le papier, provenant du « bout de fil de l’écheveau où s’emmêlent cet été rêveries, regrets et souvenirs », « ces souvenirs que j’égrène une goutte à la fois ». Il est question de nostalgie et de manque, et de bleu car « le bleu est la couleur du manque et de l’ailleurs, de ce qui se dérobe. C’est la couleur de la nostalgie. »
Au fil des pages, le bleu et toutes ses variantes viennent se diluer dans le ciel (« d’un bleu très pur, d’une beauté absurde, allant de l’azur jusqu’au céruléen »), l’eau (gouttes, pluie, océan, flaque, fleuve,rivière), la lumière (« clarté bleutée »), jusque dans les textes de Rebecca Solnit que l’autrice convoque dans un large extrait.
Ne vous reste donc plus qu’à ouvrir ce récit tout en retenue. Et surtout prenez votre temps de le lire. Vous pouvez d’autant plus vous le permettre qu’il est relativement court. Alors, prenez le temps de laisser imprimer chaque mot sur votre rétine. Laissez-les se transformer en images, en idées, en temps suspendu. Ils viendront à n’en pas douter résonner avec vos pensées et peut-être même certains de vos souvenirs.
« Je me réveille à l’aube avec cette scène au bord des lèvres, au bord des cils, au bout des doigts, en tous cas il faut me dépêcher de la raconter »

La magie du burn-out
de Lisette Lombé
Editions Le Castor Astral
«Habille ton regard de la lumière des poétesses. (…) Vois comme le ciel t’appartient. Sens comme ton cœur bondit dans ta poitrine et ne demande qu’à être respecté».
10 ans après, s’adresser à des semblables sous forme de lettres, aux burnies («camarades de fatigue») et parler de son expérience du burn-out, tel est le programme de Lisette Lombé. L’adresse est soignée, il faut dire qu’elle a été travailleuse sociale et est reconnue désormais comme poète. Des lettres avec tout plein de post-scriptum pour dire sa trajectoire d’entrée et de sortie du burn-out, par où elle en est passée pour dépasser les «bornes poussières» et se rendre sur l’autre rive, tout en convenant que «la rémission n’est pas synonyme de guérison». Le tout avec une grande honnêteté, avec aussi cette conscience aiguë du «privilège que j’ai de pouvoir transformer mes émotions en objets artistiques» ; «ma capacité à capturer ma colère et à la transformer en textes porteurs d’espoir».
Revenir sur ce «voyage souterrain», sur comment elle a pu longtemps passer à côté des signes avant-coureurs («inaccessible aux sirènes de mon éreintement» (…) «je carbure aux trompe-l’oeil», «j’étais tellement diminuée que j’ai laissé cette remarque de ma responsable s’insinuer en moi comme un poison et attaquer mon estime»), jusqu’à la paralysie et cette prise de conscience tardive : «Vital que je cesse de mensonger, de m’irrespecter, de m’épouvantailler en vain! Je veux redevenir moi! Je ne veux pas crever en derviche mécanique, clouée à une danse de fourmis ! Je veux redevenir moi !». L’autrice renseigne tout en précision ce qu’il en a été de «l’entrebâillement des impossibles», comme une façon de cartographier les fragilisations et moments de fatigue, les différentes dimensions du burn-out («la vase communicante s’épanche à toutes les cachettes de mon existence»), comme pour mieux être «capable de reconnaître les symptômes avant de replonger dans le rouge».
Ce qui compte, selon Lisette Lombé, ce n’est pas tant la déflagration mais ce qu’on en fait. Comme un écho au livre paru aux éditions Eres, Réussir son burn-out (sous la direction de Corinne Le Bars). «La magie du burn-out est de nous pousser dans nos retranchements (…) de nous jeter dans des buissons de ronces dont les épines nous égratignent comme autant de piqûres de rappel de nos aspirations profondes».
Elle incite «les bonnes personnes qui ont tendance à oublier qu’elles sont de belles personnes» à s’essayer à une série d’exercices qui pourraient s’apparenter à du développement personnel sans se ranger parfaitement sous cette étiquette, via des questionnaires, des exercices d’écriture ou de créativité, via de «l’auto-louange»… Et surtout, elle rappelle l’importance qu’a constitué le recours au collectif, à sa «tribu organique» (Lisette Lombé a créé le collectif L-SLAM) dans sa guérison : «qu’elle est douce cette communion de fragilités apprivoisées». Lisette Lombé remet donc au centre l’importance de ce que Hartmut Rosa qualifie d’ «oasis social de résonance» : «C’est cette capacité à faire corps collectif qui sauvera nos propres carcasses, j’en suis convaincue». En outre, elle n’oublie pas, dans un exercice facétieux auquel elle se livre à la fin, et intitulé, «carte d’identité poétique», de rappeler ces multiples naissances, et ce jour où elle est devenue slameuse.
15 missives comme autant de tentatives de comprendre ce que le burn-out signifie pour soi et pour les autres, comme 15 heureuses tentatives pour, comme diraient Viviane Châtel et Marc-Henri Soulet «faire face et s’en sortir». Un livre tout à fait utile.
«On pourrait dire qu’il y a un avant avant burn-out et un après après burn-out».

Plus loin qu'ailleurs
de Chabouté
EditionsVents d’Ouest
BD
«J’ai rêvé de partir, j’ai été contraint de rester… alors je suis parti en restant».
Alexandre Bouillot travaille la nuit, il est gardien dans un parking. Il a depuis de trop nombreuses années une «vie de hibou», «je ne fais que passer à côté de tout». Les grands espaces, les sensations fortes, il les vit par procuration, en lisant Indian Creek de Pete From ou Construire un feu de Jack London. Il est décidé à partir faire un trek en Alaska. Mais rien ne se passe comme prévu, le voyagiste avec qui il devait partir a fait faillite, le vol est annulé. Il se demande alors ce qu’il pourrait bien faire.
Son corps parle pour lui, une belle entorse va l’immobiliser 6 semaines. C’est alors qu’il décide de voyager au pied de son chez lui. Pour ce faire, il loue une chambre, en face d’où il habite. Et il s’emploie à remplir un carnet de voyage. Et à partir de ce lieu, il prospecte, observe inlassablement. C’est que le dépaysement peut aussi opérer tout près de là où l’on habite.
Ses béquilles l’obligent à faire attention où il marche. Le contraignent à prendre son temps. Ou comment faire de nécessité vertu. Il recueille ce qu’il trouve, les objets délaissés, les restes d’un passage, les emballages abandonnés, les listes de courses perdues, «des petits bouts de vie». Il rassemble des éléments hétéroclites dans son carnet de voyage. De cette collection-transformation nait une réflexion qui le saisit au vif, l’exhorte à «reconsidérer le négligeable». On fait le rapprochement ici avec le livre de François Dagognet Des détritus, des déchets, de l’abject. Une philosophie écologique (éd. Corti) ou encore au très beau livre de Gaëlle Obiegly, Sans valeur (éd. Bayard).
Se dessine alors le nouveau programme de notre protagoniste : «réapprendre à regarder. Vois à nouveau tout ce que le routinier et le familier ont largement filtré, mis de côté, élagué».
C’est à partir de ces micro-observations que les premières couleurs de la BD affleurent, les fruits, les étals, les panneaux signalétiques, le ciel, les vêtements. A partir de ce moment-là qu’en plus de leur donner vie dans son carnet, le contemplateur apporte à coup de craies de menues transformations à la ville, à l’instar du street art, conférant ici ou là une forme de poétique aux messages urbains.
C’est qu’il s’en passe des choses au pied de chez soi, aux «quatre coins de sa rue». Et des choses qui passent inaperçues pour beaucoup pour peu qu’on soit happé par son téléphone, par son quotidien. Alexandre s’assoit sur un banc qu’il partage avec un SDF, lequel en tant qu’ancien botaniste en sait un rayon sur les plantes sauvages des villes, mais aussi, sur la vie de notre contemplatif. Alexandre comprend ainsi qu’avant de devenir observateur il a été observé.
Des dessins en noir et blanc comme aime s’y consacrer Chabouté, avec ici une forme de mélancolie, de sensibilité tout entière saisie dans la fragilité de l’instant présent. Ravissant.
«Se nourrir délicatement de chaque situation, de chaque événement, guetter chaque détail, cueillir des yeux chaque instant. Apprivoiser le temps, le freiner, l’arrêter, valser avec le futile et l’insignifiant».
- All
- Gallery Item
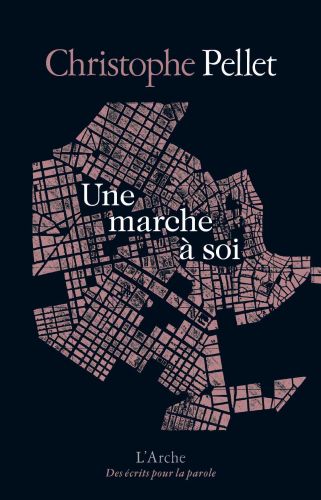
Une marche à soi
de Christophe Pellet
Editions L’Arche
«De nulle part et de partout,
à la recherche d’un nouveau lieu,
d’une nouvelle vie».
Christophe Pellet a fait la Fémis et est réalisateur. Cela se voit nettement à travers sa manière d’écrire où se détache des voix et des images situées, avec une mise en porosité sans cesse renouvelée entre réalité et virtuel.
Le récit trace, en vers libres, une reprise en main de soi à travers la marche. «Une marche, simplement. Antalgique, marginale et improductive». Avec la ville comme traversée, comme décor, comme contact («la ville, mon corps, enlacés dans le même mouvement»), comme lieu où se perdre. Une ville multiple et générique faite d’un peu d’Athènes, d’un peu de Rome, Paris et Berlin.
C’est qu’il en faut des détachements pour s’extirper de ses assignations, se déprendre de ses enfermements. Exit le boulot, exit l’être-aimé-emmuré, exit «le monde écran». Puis se reprendre, se recentrer, retrouver son rythme, se ré-appartenir, ré-apprendre à voir («Le regard n’est pas arrêté, tes yeux t’appartiennent à nouveau, ils ne sont plus captifs, ta marche les guide. Elle suggère tes impressions»), ré-écouter sa voix, se reconnecter à soi, à son propre flux, à son enfance, se reconstituer un paysage. Ne plus s’oublier. Se remettre en état de marche : «ma tête se désemplit, ma marche me désencombre. Mes pas sont ceux, premiers, du nouveau-né».
Christophe Pellet propose une variation autour de l’être aimé, du courlis cendré, de la ville et de l’estuaire un jeu de combinaisons qui nous fait penser irrésistiblement à Eva, Piotr et Tom que Perrine Le Querrec, fait évoluer au sein d’univers parallèles (in Les pistes, éd. Art et Fiction).
Et puisque «notre chambre à nous, du côté de la Silicon Valley, on nous l’a dérobée : la chambre à soi, elle n’existe pas», c’est à travers le mouvement de la marche («une marche à soi, c’est encore possible ») que des prises de conscience agissent : «Et je prends conscience, voilà ce qu’a été ma vie : prisonnière d’un sous-sol obscur traversé d’un mouvement constant et imposé (…) Ne jamais faire un pas de côté. Longtemps j’ai fait du surplace dans le néant». Ces incursions, remises en perspective, ne sont pas sans nous faire penser au roman Palais de verre de Mariette Navarro (éd. Quidam). L’auteur entretient à dessein le trouble, se moque d’une vision trop unidimensionnelle : qui de la narratrice ou du courlis cendré sauve qui ? Qui de la narratrice ou de l’être aimé a possédé l’Autre ?
Et à la fin du texte, l’être-aimé-quitté s’incruste dans la fiction, comme une façon de nous rappeler combien la transformation reste fragile, combien l’empouvoirement peut rapidement s’atrophier. Un antidote à une croyance par trop magique en la force de l’écriture («l’écriture ne peut rien») sous couvert de revirement.
Un texte qui fait habilement jouer ensemble les différents points de fuite de la narratrice. A lire et pas forcément en marchant.
«Ô cruelle douceur des temps, sur la ville et l’estuaire il descend. Sur l’être aimé, sur le courlis cendré, il descend».
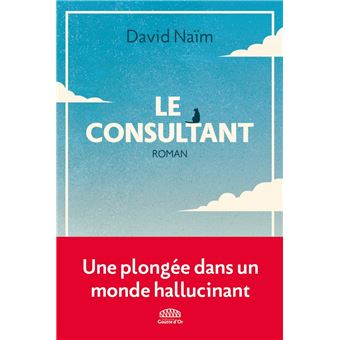
Le consultant
de David Naïm
Editions Goutte d’Or
A paraître le 14 mai 2025
«Simon souffrait incontestablement d’un cancer de discernement stade 4»
Simon Maïmonide est consultant et ça se sait. Il adore prêter attention à sa présentation de soi lorsqu’il rencontre des collègues de sa femme prof. Il adore impressionner, même si souvent il n’impressionne que lui-même. Pour beaucoup de ses collègues, il passe même pour cruel. Qu’importe, il s’emploie à progresser dans la hiérarchie d’un cabinet de conseil international. Sa course n’est pas même ralentie par le burn-out qu’il fait peu de temps après son intégration dans sa firme, ni par les quelques couleuvres qu’il se doit d’ingérer (à l’instar du management par l’empathie). S’il doit se départir de quelques low-performers c’est que ça fait partie du jeu après tout. C’est qu’il aspire à grand, toujours plus grand, il rêve d’une villa XXL au Cap Bénat. Promu « associé », il n’utilise plus que les files Sky Priority, est devenu membre Gold chez Air France, et après être devenu le directeur de ConsoTech, fruit de la fusion de deux directions concurrentes, et avoir retouché son profil LinkedIn, il fait partie du club très resserré des Highly Compensated Partners et touche enfin le graal lorsqu’il est invité au Leadership Summit à Abou Dhabi.
Simon est agaçant de par son arrogance mais sa stature de « perdant magnifique » en fait aussi un être attachant. C’est qu’il multiplie les maladresses auprès de son entourage et une entreprise interne florissante de déni semble prospérer. C’est qu’il ne comprend pas qu’il ne se souvienne pas, mais alors pas du tout, d’un certain nombre de situations préoccupantes. Le cancer de sa mère, les conditions de sa rupture avec Judith.
Simon connait par cœur les acronymes, spécifications et autres ponctuations de la novlangue du consulting. («Une ponctuation, un et à la place d’un ou, c’est grâce à ces détails qu’on convainc. Les chiffres, les raisonnements ne servent qu’à établir les fondations pour y croire, pas la croyance elle-même. Pour ça, il fallait ce que Simon appelait «le coup de polish Roland Barthes », en hommage au sémiologue»). Il joue avec les tips et méthodes toutes faites, les 3-6-9, les 3C, il structure sa pensée en bullet point, rédige des slides (moins il y en a mieux c’est), élabore même son propre concept, celui de management exponentiel. Il adore résoudre des problématiques organisationnelles à haute densité de complexité. Il pense «out of the box», sait suspendre son esprit de loyauté quand il faut, serpente entre ses supérieurs, Jean-Claude, Marieke et la big boss Athena.
Ce roman pourrait relever de la non-fiction tant certaines séquences, pourtant d’un cynisme sans nom, paraissent vraisemblables, du fait aussi que son auteur est lui-même consultant (mais qu’attend il pour être écrivain à temps plein?) et donc particulièrement renseigné sur les logiques à l’oeuvre dans ce secteur. Ce livre m’a fait penser à celui de Vincent Pettitet Les Nettoyeurs (ed JC Lattès paru il y a déjà 19 ans), on y retrouve la même exploration satirique des arcanes du consulting, et avec une montée en généralité autour de l’absurdité d’une approche purement quantophrénique et de ces machines à évaluer que sont les bureaux de consulting. Une même insolence se dégage quant aux habiletés à l’oeuvre pour domestiquer les clients pourtant donneurs d’ordre. Mais aussi une restitution assez bluffante de l’esthétisation de la puissance à l’oeuvre dans ces milieux (avec la force des images, de la bonne formule pour rafler la mise, à l’instar de sa référence à Rauschenberg qui permet à Simon de remporter un important marché).
Ce qui fait que ce roman n’est pas un énième roman à charge contre cette forme de « bullshit job », pour reprendre l’expression de David Graeber, c’est qu’il y a énormément de dérision. L’auteur ne se contente pas de dénoncer, il s’attèle aussi à une forme d’analyse à feu doux, et parfois désopilante, du principal protagoniste, sachant que l’autocritique c’est certainement l’endroit où Simon a le plus de mal à faire preuve de clairvoyance. Quant au discernement, il doit consulter Wikipédia pour s’assurer ce que cela signifie vraiment. C’est surtout sa femme ou son collègue Antoine qui le pousse à voir les choses différemment. C’est aussi à la mort de son chat Sultan, alors qu’il voudrait, comme une offre de réparation par rapport à toute une série de rendez-vous manqués, que le kaddish soit dit, qu’il prend la mesure de son éloignement de la « vraie vie« .
«Le monde est cul par-dessus-tête. Quand tu penses qu’il y a des salopards qui gagnent des millions pour faire des jobs toxiques quand les emplois utiles crèvent la dalle».
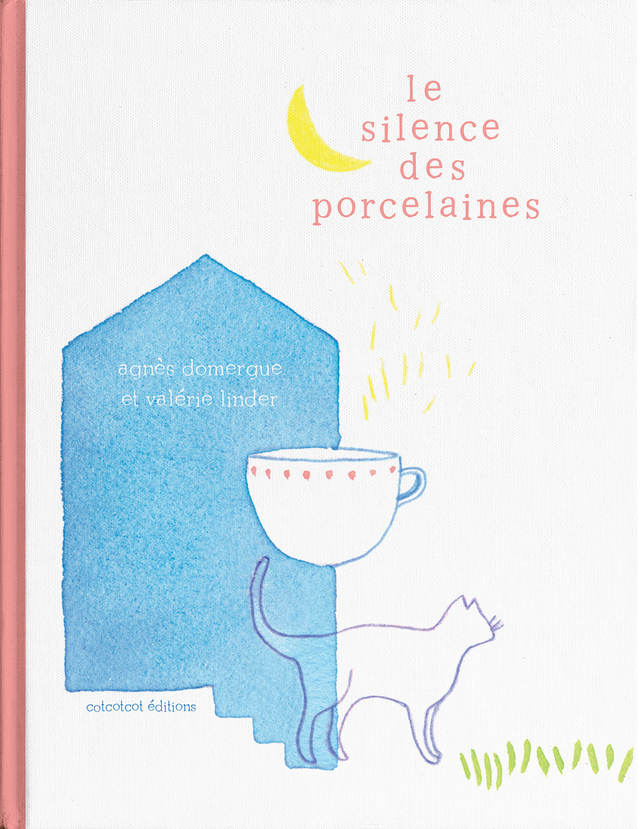
Le silence des porcelaines
d’Agnès Domergue et Valérie Linder
Editions Cotcotcot
Album jeunesse
« Deux notes de musique
au vent des quatre saisons »
Après Idylle paru en 2021 chez le même éditeur, le duo Agnès Domergue (au texte) et Valérie Linder (au dessin) se reforme pour notre plus grand bonheur. De nouveau, comme dans chaque ouvrage publié chez Cotcotcot éditions, la poésie est au rendez-vous.
Si les chats peuplent souvent nos albums-jeunesse, ici pas question d’aventure trépidante où l’animal serait humanisé. Non point de tout cela. Ici, le chat est un chat, se comporte comme un chat. Il ronronne, joue, se blottit en boule, sort parfois ses griffes, laisse ses « moustaches au vent », se déplace avec agilité, sans jamais rien casser, tout juste en faisant tinter les porcelaines japonaises. Il est libre comme le sont les chats, c’est d’ailleurs lui qui décide d’entrer dans la vie de la narratrice (« jusque sous mon toit je l’ai suivi ») et d’en sortir un jour sans prévenir (« un jour gris il est parti sans moi et sans un bruit »).
Ce chat qui s’est immiscé un soir d’été dans sa vie, traverse l’album telles des empreintes de souvenirs, auxquels l’aquarelle vient donner vie par touches qui s’imprègnent dans la mémoire comme dans le papier, par superpositions et se diluent aussi parfois, s’estompant au fil du temps.
Ces aquarelles d’une douceur infinie nous évoquent le travail de Lili Wood, mais depuis qu’on a reçu les leporello et cartes postales signés Valérie Linder on sait que l’ensemble signe une identité en propre qu’on aime tout particulièrement.
Une lecture où le temps s’écoule lentement tout comme la une tendre nostalgie
« Et comme une rangaine
le bruit des porcelaines »
- All
- Gallery Item
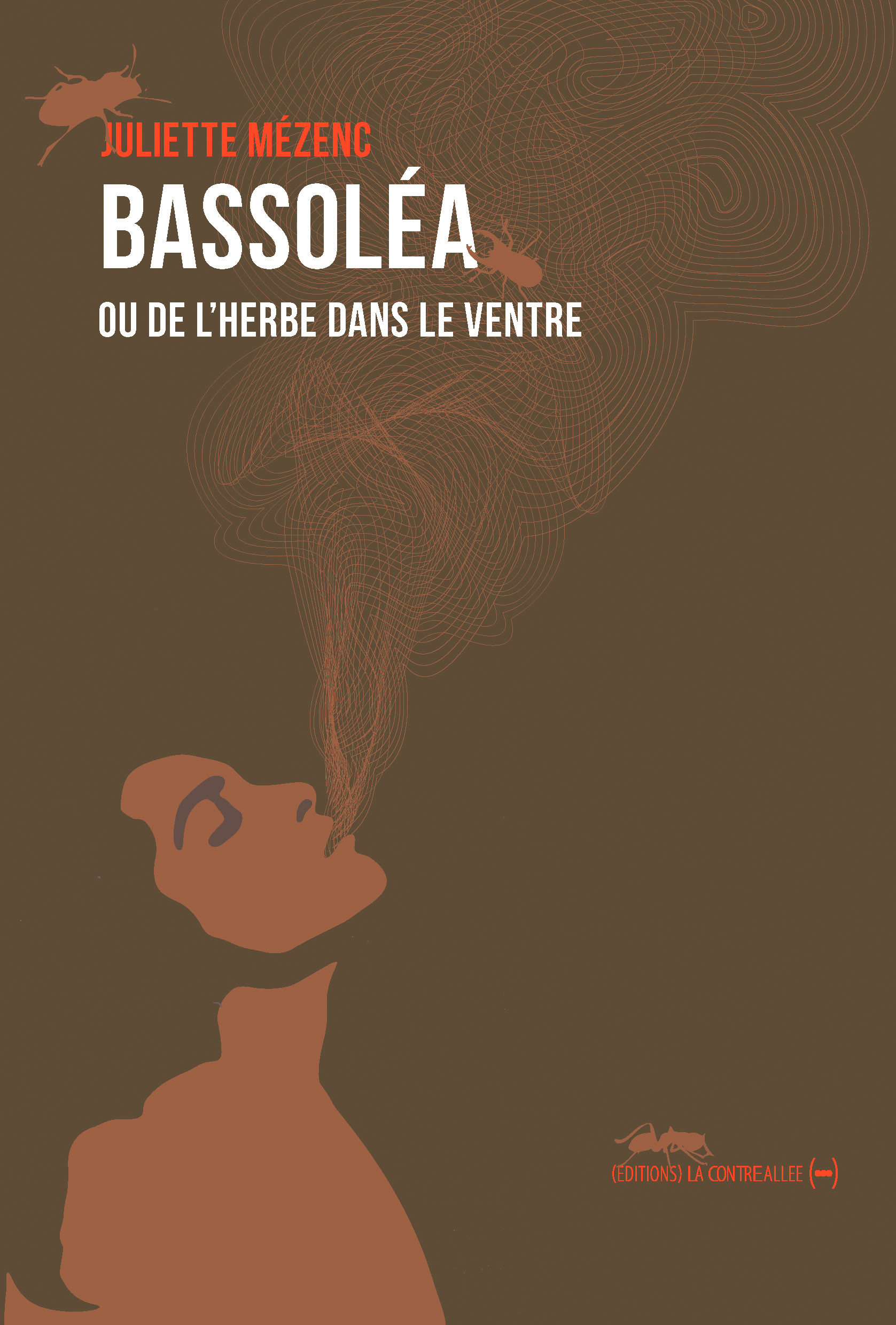
Bassoléa ou l'herbe dans le ventre
de Juliette Mézenc
Editions La Contre Allée
«rien de plus urgent à faire que prendre le temps, prendre le temps de creuser, insister, se faire mineur de fond, c’est ma ferme intention, comme ça que je traverserai les horizons de la terre»
Bassoléa est oppressée par le monde, elle a été exposée à des situations répétés d’enfermement (dans un riad à Marrakech en compagnie d’une cantatrice, avec les enseignements qui lui ont été donnés, au sein d’une ferme restaurée, en hôpital psychiatrique). Elle n’en peut plus de ces mises au vert subies. Aussi elle provoque sa propre expérience de retrait du monde extérieur, en investissant ce qui se passe sous terre. Elle décide littéralement de s’enterrer en concevant une véranda sous-terre, sorte d’extension de sa cave et lieu privilégié de contemplation de tout ce qui se joue au niveau des champignons, bestioles, nécrophores, bactéries, protozoaires, racines et autres radicelles. «Une main sur la tête, une main sur le ventre», elle observe et hallucine de tout ce qui grouille sous elle, de comment les feuilles mortes se transforment en humus. Elle s’escrime «à traduire dans le monde des humains l’art de vivre des microbes» nous plongeant dans «une immersion complète dans les sciences de la vie et de la terre».
Bassoléa nous livre une critique sans appel de notre société consumériste avec le travail comme point de centralité «on continue tous à travailler comme des dingues, à travailler toujours plus pour enlaidir toujours plus et bousiller toujours plus, et tout ça pour faire tourner l’économie». Et s’insurge contre cette difficile sortie du tout-travail, «c’est la peur qui leur ment, la peur de sortir de l’ornière qui a pris le forme de leur corps, à force, et c’est pourquoi ils n’ont plus le temps de se nourrir correctement, le temps d’aimer n’en parlons pas, même les morts ils n’ont plus le temps de les accompagner, il faut que ça aille vite, au pas de charge, ils n’ont pas que ça à faire, ils sont bien trop occupés à tuer la vie aux quatre coins de la planète».
Bassoléa prolonge son questionnement autour du corps qu’elle va laisser à sa mort, souhaitant ne laisser aucune trace de son passage sur terre. Ne souhaitant absolument pas finir dans un caveau, elle s’imagine «se fabriquer une chair tendre avec et par la danse» de sorte à se rapprocher d’un corps bio, recyclable et qui n’empoise pas ces petits habitants qui peuplent le monde souterrain («mettons que je meure le corps plein à craquer de psilos et donc de psychotropes, qu’est-ce que ça fera aux microbes?).
L’écriture est constituée d’une suite ininterrompue d’idées qui s’enchainent, comme un flot continu matérialisé par un très faible recours au point. Les virgules quant à elles rythment le texte tout en amenant des micro respirations. Le texte se prêt particulièrement bien à la lecture à voix haute. Le texte étant court, c’est d’ailleurs vivement recommandé de l’approcher ainsi.
Une ôde au vivant, aux petites bêtes, à la petite vie qui compose le dessous du monde.
«respirer c’est l’affaire de toute une vie, respirer c’est l’affaire, la grande affaire de la vie, ce n’est pas rien, c’est phénoménal, c’est la merveille des merveilles, et personne pour s’extasier, ou même s’étonner».

Tout l'or des nuits
de Gwendoline Soublin
Editions Actes Sud
«Puisqu’en brûlant tout revient.
Puisqu’il a brûlé.
Puisqu’il peut brûler encore».
L’illustration de couverture signée Benoit Paillé, et ce titre tout droit sorti d’un poème de Guillaume Apollinaire (Nuit rhénane) forment déjà une bien belle promesse. Peut-être dans ce temps de surproduction littéraire qu’on continue à vivre (ou subir c’est selon), ce sont là deux éléments réunis qui permettent à un premier roman de se frayer un chemin. Le reste est à l’avenant.
On suit Clara qui exerce en tant qu’aide-ménagère au sein de l’entreprise Sourire Services, aux côtés de Monia, Véronique et Stéphanie. Elle enchaîne le ménage chez des particuliers, parfois 7 maisons par jour, jusqu’à 45 heures hebdomadaires. Clara est celle qui volontiers supplée ou compense les absences ou démissions de ses collègues.
Très vite on comprend que Clara a dû faire face à un drame, elle a perdu son mari, Ivan. Le chagrin est immense. Elle doit composer avec cette absence, «s’occuper à des riens pour orchestrer le temps et mieux le voir filer».
Se perdre dans la répétition des gestes professionnels, «à la limite de l’extinction» : «c’est ce qui la tient : faire sans discuter, sans préférence, sans avis, faire, ni plus ni moins, faire ce qu’on lui a demandé, pas faire comme elle pense, ni faire ce qu’elle pourrait, ne surtout pas imaginer, avancer»).
Se perdre à compter les battements de son cœur, à réaliser des inventaires mentaux du nombre de cadres, de livres, d’ampoules, de chaises, de meubles, de bibelots des maisons qu’elle nettoie, à réciter l’éternel poème de ses huit ans, à scroller frénétiquement les annonces des sites qui recensent les animaux perdus, car oui, elle a récupéré un chien, Le Chien. Elle ne s’embête pas à l’affubler d’un autre nom, car ce n’est pas son chien, ce gros chien noir qui l’attend devant la maison. Ce chien qui n’en fait qu’à sa tête qui l’épuise de sollicitations, qui la réclame sans cesse et avec lequelle elle arpente les abords du bois à côté de chez elle.
Se perdre dans des rêves qu’elle ne vivra pas, comme les «si petits rêves d’Angleterre», Brighton qui est comme à portée de main mais qui se dérobe continuellement. «Ces rêves que Clara craint, dans lesquels les mots qu’elle n’a pas exprimés le jour prennent la forme de fantômes abusifs la nuit».
Se perdre ainsi la nuit, cette nuit qui l’effraie, la présence d’Ivan qu’elle ressent «dans le flou de ce demi-sommeil».
Se perdre dans des promenades interminables à assouvir les besoins du chien, «elle retrouve dans cette marche de fin de journée la même dynamique rythmique que dans le ménage, le lent mais certain effacement de la pensée dans l’exécution systématique des mêmes gestes : avancer, avancer, avancer».
Et c’est à cet endroit, à l’orée du bois lorsque des ombres affleurent et des animaux se consument sous l’orchestration de l’homme du bois, que se localise toute la puissance de l’écriture de Gwendoline Soublin, empreinte d’une forme de réalisme magique qu’elle convoque. Clara profite de ses excursions nocturnes pour faire parler des animaux en train de passer de vie à trépas, «Clara a vu les feux de la veille mettre bas les ombres des nuits suivantes». Cette brèche fantastique qui vient embrasser ce qui se joue dans l’inter-règne (cette intrication entre monde végétal, minéral et animal) prend forme lors de ces nuits étirées et se fait révélatrice du prolongement des présences-absences propres au deuil. «Tout se décale, se décalque : du jour ou de la nuit, de la forêt ou de la ville, des humains ou de tous ceux qu’on appelle animaux, voit-on seulement encore les limites ?» Ces passages où Clara se met en quête des voix ne sont pas sans nous rappeler le roman de Jeanne Beltane Les poumons plein d’eau (éditions des Equateurs).
C’est un roman que l’on traverse d’un souffle, happé par cette jeune Clara qui s’emploie à trouver les manières d’inventer sa propre consolation.
«C’est toujours la nuit.
La nuit, sans tête ni pieds, la nuit ce puits sans fond.
Clara use la nuit à force d’y marcher
Les semaines passent. Les mois. Les siècles».
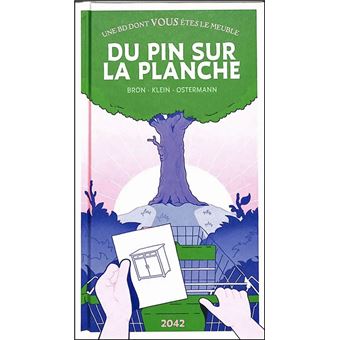
Du pin sur la planche
de Bron, Lein, Ostermann
Editions 2042
BD
« Pour remplacer ce meuble, plusieurs solutions s’offrent à vous. »
Un meuble se casse et vous voici retourné.e en enfance dans un bon livre dont vous êtes l’héros.ïne (bon, pas toujours facile d’écrire en écriture inclusive, heureusement le livre est en typographie BBB Poppins TN, avec des glyphes permettant facilement l’inclusion). Choisir le type de meuble à mettre à la place de l’ancien, le moyen de se le procurer (« Ikae », « Ammeüs, rue de celui qu’on croyait connaitre mais en fait non », « la menuiserie locale » ou encore se lancer dans la fabrication soi-même ?), le bois, sa forme… On est tous passés par là et on ne réalise pas toujours les conséquences que cela pourrait avoir (sur son logement, sa santé mentale, sa santé tout court, la planète). Et bien, Bron, Lein et Ostermann y ont pensé pour vous et vous propose de tester de multiples alternatives et de voir ce que cela pourrait donner. Des propositions à des dilemmes qui nous parlent tous un peu, d’autres dignes de livres de science-fiction ou de visions déjantées… Il fait bon rêver un peu non ?… A moins que cela ne tourne au cauchemar et à la mort… D’où l’enjeu de bien choisir ses trajectoires à chaque page !
Avec en prime des illustrations acidulées et pleines d’humour.
C’est ludique et sarcastique à souhait, et en prime on apprend des choses par exemples sur les COV, ces composés organiques volatiles contenus dans les colles des agglomérés par exemple et qui peuvent provoquer des cancers…
Un petit livre drôle et écolo, ça fait du bien
« Catastrophe ! Votre chat a détruit votre meuble préféré. Que faire ? »
- All
- Gallery Item
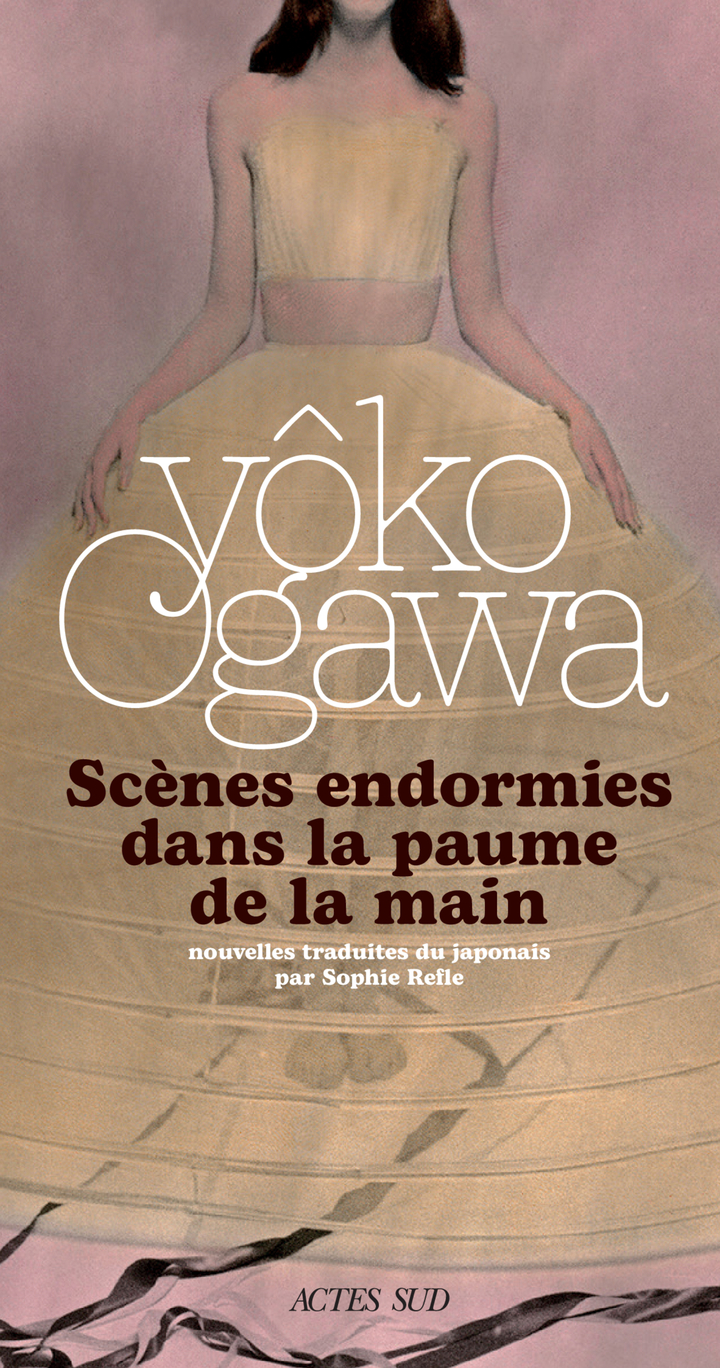
Scènes endormies dans la paume de la main
de Yoko Ogawa
traduit du japonais par Sophie Refle
Actes Sud
«La petite fille sait que les quelques centimètres qui séparent le haut de la boîte du sol créent un espace particulier, et que cette petite boite à outils qui pourrait être aisément piétinée prend ainsi une hauteur qui la met hors de portée des humains».
Ce livre est constitué de huit nouvelles, huit textes courts qui condensent des petites expériences, qui prennent toute leur importance ressaisies dans un petit espace, une unité de lieu souvent confinée, à l’écart du monde. C’est comme si Yoko Ogawa s’escrimait à réduire le cadastre du réel, à le diffracter, à ce qui se joue dans une petite boite à outils , dans un étui à chausson devenant boite aux lettres, à l’intérieur d’un bridge, aux inscriptions fragiles camouflées au niveau de la vaisselle, dans un théâtre factice, dans la librairie de la voiture à cheval, dans une machine à coudre, une licorne miniature, de minuscules chenilles arpenteuses. On va d’un personnage à l’autre, tous engoncés dans des rôles qui les dépasse ou qui nous dépasse (ainsi la personne qui vit dans le théâtre et qui se sacrifie pour que personne ne commette d’erreurs sur scène, ainsi la dame de compagnie qui fait figure de comédienne décorative), d’un espace de solitude à un autre, dans une subtile tension où tout menace de se disloquer, de trébucher tellement la fragilité menace (beaucoup de personnages se tiennent dans un corps frêle), mais où tout finit par tenir dans des répétitions et dans les surprises de la routine (à l’instar de la personne qui va assister aux 79 représentations d’une même comédie musicale). Il y a des parallèles qui s’opèrent, à l’usine de couture répond l’usine de transformation des métaux, des éléments de décor se dédoublent d’une nouvelle à l’autre, l’évocation d’une grotte, d’un camphrier, d’une boite à bento.
Yoko Ogawa aime jouer avec les échos, les réciprocités, les mises en abime pour troubler le vide de certains existences, on prend ainsi plaisir à lire la nouvelle Etreindre la licorne qui est émaillée de référence à la pièce La ménagerie de verre de Tennessee Williams.
Il y a des choses qu’on préserve pour soi, à l’abri, comme précieuse strate de son existence, à l’instar des différents programmes de spectacle réceptacles d’autographes. Il y a les croyances qu’on se crée (la figure des geckos enlacés-infinis comme symbole de fertilité) et les amulettes qu’on s’accapare pour exorciser les violences sous-jacentes de notre société.
Yoko Ogawa par la mise en scène de ses personnages, par l’acuité de leurs observations, par ses décors soignées, par ce décorticage du temps qui file, maille après maille, nous aide à mieux percevoir la beauté du monde quand cette dernière s’incruste dans de petites choses, dans des petites attentions (celles de la tante Laura qui badigeonne le cou de la narratrice de feuilles d’abricotiers afin qu’elle retrouve sa voix ; l’émotion procuré par un autographe reçu). Yoko Ogawa n’en finit pas de tisser son motif dans un en-dedans d’imaginaire tout entier situé dans «un petit bloc de calme».
Quand le temps consacré à la lecture ne cesse de se rétracter, le format que constitue les nouvelles est décidément une bonne réponse pour répondre aux nouveaux enjeux posés par l’économie de l’attention, tout comme cette façon si subtile de pactiser avec le monde onirique pour s’éloigner de la violence et du vacarme du monde tel qu’ils s’actualisent jour après jour. Et si un doute subsiste, il vous suffit de prêter attention aux toutes premières phrases de chacune des huit nouvelles pour être définitivement conquis. Yoko Ogwa est talentueuse, on le savait, mais on prend plaisir à le redire.
«La cheffe de service réfléchissait à la grotte du bridge où se cachaient les créatures. Un endroit très proche, mais qui lui apparaissait aussi comme une île isolée à l’écart du monde».
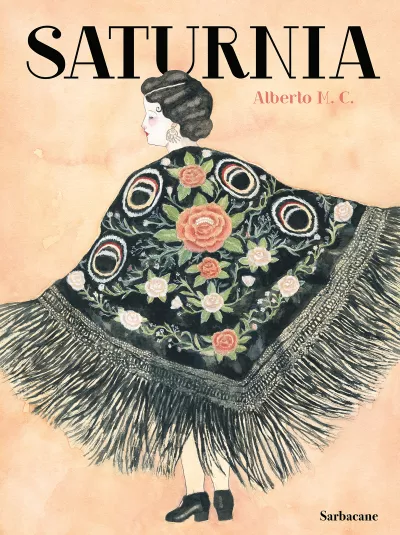
Saturnia
d’Alberto Martin Curto
Editions Sarbacane
BD
«Je leur parle de loups… alors que je suis dans la gueule de l’un d’entre eux…»
L’atmosphère si particulière qui transparait de cette BD passe par le recours à des vignettes aux contours flous, des couleurs souvent froides et comme délavées, des fonds à l’aquarelle qui se dilue comme dans les souvenirs pourtant toujours persistants.
Au départ, on ne sait pas bien qui est la narratrice. Qui nous dit : «Je sais… Je sais bien… Le passé est toujours là. Le passé…» ?
C’est une histoire de femmes au début du XXème siècle en Espagne. Il y a Inès, qui élève seule ses deux filles Roseta et Agueda, dans le secret car il n’est pas accepté de vivre seule avec des enfants. Les deux filles s’inventent des histoires et rêvent de sortir de chez elles. Elles sont condamnées à regarder discrètement le monde à partir du balcon.
Il y a la vieille voisine acariâtre, Apolonia. Il y a aussi Aurora, le chat-monstre, la «fille de Frankenstein». Et puis il y a Clavel le jour, Clavel de Luna la nuit. Quelques fantômes, une poupée symbolisant l’enfant jésus, des papillons de nuit, des mites, un chat porteur de messages. Et ce châle, qui se transmet de mère en fille dans la famille, transformant Inès en papillon de nuit, «un saturna géant» ! «Je suis une mite qui déploie ses ailes et sort du placard pour se battre dans le froid de la nuit».
Inès a une force de résistance chevillée au corps. Comme une nécessité de survie face à un extérieur où menace et précarité s’additionnent. Face au poids de la religion qui se rappelle sans cesse, et où sorcellerie et superstition ne sont jamais très loin. Inès et Clavel, s’entraident, se prolongent, les noctambules incarnent une véritable sororité.
Alberto nous emmène entre souvenir, rêve et cauchemar et avec en arrière-fond les soubresauts de l’Histoire. Peut-être est-ce le lieu, peut-être est-ce l’époque, mais on ne peut pas s’empêcher de penser à l’univers de Carlos Ruiz Zafón. On imagine fort bien Alberto M. C. mettre en images ses histoires à l’atmosphère brumeuse et qui n’est pas sans nous rappeler celle de cet album où la sensibilité affleure à chaque vignette.
Tout cela à travers les yeux des deux fillettes. Une histoire à la fois onirique et effrayante, en clair-obscur.
«Saturnia : grand paon de nuit, le papillon le plus grand qu’on trouve dans la nature».

Sortir du ventre du loup
de Charlotte Melly
Editions La ville brûle
Album jeunesse
«Peut-être… Peut-être qu’elle…»
Le Petit Chaperon Rouge est mangé par le loup mais tout va bien puisque le chasseur ou le bûcheron vient ouvrir le ventre de l’animal et sortir la petite fille de là ! … Mais qui peut bien penser que tout va bien alors qu’elle a été mangée avant d’être sauvée ? Peut-on vraiment dire qu’elle est saine et sauve ?
Parce qu’il y a trop d’enfants qui subissent des violences ou vivent des situations traumatisantes. Parce que c’est utile d’en parler avec tous mais que ça ne va pas de soi d’évoquer de tels sujets avec des enfants, il y a la littérature jeunesse et il y a Sortir du ventre du loup.
Charlotte Melly imagine dans cet album la suite du Petit Chaperon Rouge et tous les états par lesquels la fillette pourrait passer. Et forcément, on ne peut pas dire que tout est bien qui finit bien. Sa vie continue. Et c’est à ce moment que l’histoire commence, dans cette imagination des possibles (pas très gais il faut bien l’avouer) : elle cherche à se cacher, se protéger. Parfois muette, parfois très en colère. La peur est là. L’isolement, la tristesse.
Mais c’est qu’elle a des ressources, alors elle apprend à voler ou à creuser des passages secrets. Ça ne suffit pas, son corps lui dit qu’il va mal : elle se gratte, s’arrache les cheveux.
Elle tente de se transformer, se déguise (on découvre la cousine de Peau d’âne : Peau de loup). Elle déménage, rêve de partir dans l’espace, s’échappe du réel et de son passé. Elle cherche de quoi se réconforter, auprès de qui trouver refuge.
Mais ça ne va pas de soi de sortir de ce trauma : «Elle traverse des hauts et des bas».
Des phrases courtes ou ponctuées de virgules, pour décrire son état ou tenter d’en sortir, comme pour les scander, les lancer… et reprendre son souffle.
Le texte nous frappe, les illustrations aussi. Parfois uniquement au crayon ou fusain, parfois avec des aplats texturés, de couleurs vives ou contrastées pour souffler le chaud et le froid.
La fillette n’est qu’une silhouette blanche, comme effacée, extraite du monde. Mais lorsqu’enfin elle se met à écrire, elle reprend forme et vie.
C’est un album qui s’accompagne, forcément, et qu’on ne lira pas trop jeune. Mais il faut le lire car il est utile et beau à la fois.
«Est-ce que tu t’es déjà demandé ce qu’il se passe après, dans la vie du Petit Chaperon Rouge, une fois qu’elle est sortie du ventre du loup ? »
- All
- Gallery Item

La Pommeraie
de Peter Heller
traduit de l’anglais par Céline Leroy
Editions Actes Sud
« La Pommeraie
Ce soir le parfum des fleurs de pommier
et le murmure du ruisseau
se faufilent par la fenêtre ouverte
comme autrefois nous parvenait le son des dix cordes.
Notre fille dort malgré le vacarme au fond de mon cœur. »
Frith, apprenant qu’elle est enceinte, se décide à relire son passé et celui de sa mère, Hayley, en ouvrant le coffret qu’elle lui a légué. Cette boite contient des poèmes chinois écrits par « la princesse Li Xue qui vivait dans l’Ouest du Sichuan au début du VIIIe siècle », que sa mère a traduits en anglais.
On comprend qu’un drame est survenu mais on ne sait lequel. On comprend aussi rapidement que la relation entre Frith et Hayley était forte et singulière, et que leur vie dans une pommeraie du Vermont l’était tout autant. A six ans, la fillette ne va pas à l’école mais dévore les livres, fabrique du sirop d’érable, récolte des pommes et est la princesse d’un royaume imaginaire. Elle a la compagnie d’Ours, leur chien, et parfois de Ben, un enfant un peu à part. Elle et sa mère ont aussi la compagnie de Rosie, artiste tisserande, et parfois de quelques rangers qui viennent offrir de la viande braconnée.
C’est une vie un peu hors du temps et du monde, où l’observation de la nature a une place importante, les odeurs, les couleurs, et le souffle du vent. Où l’attente et la perte traversent chaque moment, même joyeux. La nostalgie est sous-jacente, presque palpable sans qu’on sache forcément à quoi elle est reliée. « L’absence produit elle aussi un bruit qui peut être aussi bruyant que ce qui l’a précédée. Parfois elle est même plus bruyante. »
La force de ce roman, c’est ce tissage entre courts instants présents où Frith découvre les poèmes et leurs traductions (parfois plusieurs du même texte), retours dans l’enfance et ces poèmes chinois qui semblent tout autant écrits au VIIIe siècle en Chine que dans le Vermont, alors que Frith est toute jeune. Comme si l’acte de traduction avait relié ces deux époques, ces deux lieux, pour donner une matière encore plus intense à la mémoire de cette vie passée dans la pommeraie, chaque poème venant éclairer d’une lumière spécifique ces fragments de vie.
Un roman qui nous invite aussi à prendre le temps de l’introspection.
« La joie nécessite-t-elle la sécurité ? Je n’en suis pas sûre. Non pas que ma vie avec Hayley ait été dépourvue de joie – nous vivions des moments joyeux, presque tous les jours. »

Bleu d'août
de Deborah Levy
Editions du sous-sol
traduit de l’anglais par Céline Leroy
«Mes doigts avaient refusé de se plier à Rachmaninov et j’avais commencé à jouer autre chose».
Deborah Levy nous invite à suivre les pérégrinations d’ Elsa M. Anderson, pianiste virtuose de 34 ans aux cheveux bleus.
L’autrice qui s’est penchée à plus d’une reprise sur l’exercice de la biographie, à commencer par la sienne (Prix Fémina étranger 2020), ne cède en rien à l’illusion d’une trajectoire biographique, elle s’autorise une évocation hélicée de la vie de son héroïne pianiste, au gré des cours de piano qu’elle donne en Grèce auprès du jeune Marcus, ou à Paris auprès d’Aimée, au gré des conversations qu’elle a avec Marie ou Rajesh ses amis. A travers aussi un kaléidoscope d’images flottantes, à l’instar des lamas aperçus dans la voiture jaune, des fourmis qui investissent une baignoire, les chevaux d’Ipswitch, les oursins de Perros, un piano Steinway aux touches d’ivoire.
C’est qu’Elsa se lance à la recherche de son double à défaut de se trouver elle-même. Qui est donc cette personne qui a acheté la paire de petits chevaux mécaniques qu’elle désirait tant et à qui elle a subtilisé son chapeau ? Quelle relation continue-t-elle d’entretenir avec Arthur Goldstein son professeur de piano qui l’a adoptée quand elle avait 6 ans? Qu’est-ce qui résiste de la sorte au point qu’Elsa refuse de prendre connaissance des documents qui pourraient lui en dire plus sur ses origines et ses parents biologiques ?
En plein récital à Vienne, devant une salle pleine à craquer venue l’écouter, elle prend ses libertés avec le Concerto n°2 de Rachmaninov avant de quitter la scène de manière anticipée («C’est vrai que nous avons perdu le deuxième concerto pour piano de Rachmaninov, (…) mais pendant deux minutes et douze secondes, nous avons écouté Elsa M. Anderson jouer quelque chose qui nous a coupé le souffle»). Mais de quoi cet élégant auto-sabordage, cette sortie de scène, cette sortie de la tristesse de Rachmaninov, au faîte de sa carrière, est-il le nom ?
Entre crise artistique et crise identitaire, elle est résolue à tourner le dos à ce «vieux monde», ces «vieilles rengaines»… Celle qui reste orpheline («le silence assourdissant de ma mère») se projette en son double et recompose ses fragments de sa vie comme pour jouer une nouvelle partition, comme une nouvelle «musique intérieure» écrite au présent.
Avec une écriture empreinte de nostalgie, qui associe en permanence fibre artistique et désir d’émancipation, Deborah Levy n’en finit pas de nous bluffer.
«J’avais des bleus à l’âme de la même couleur que mes cheveux».

Les Gugusse en vacances
d’Emilie Gleason
Editions Atrabile
«Vous souhaitez aujourd’hui vous engager juridiquement afin de payer moins d’impôts et socialement pour vous conformer au diktat marital et faire plaisir aux parents».
Ils sont 5 dans cette famille : Boris, Doris, Balou, Éléana et Ted et chacun y va de son excentricité. Leur programme : se rendre au mariage de leur cousine Alegzandrine dans le Yolcame, pays où les tacos de betterave à la vapeur et les gaufres salées au panais font figure de plat national. Rien ne se passe vraiment comme prévu, toute une série d’empêchements viennent retarder leur départ. Et quand ça semble finir par se normaliser, d’autres imprévus guettent, à l’instar du sac poubelle qui a été confondu avec le sac de pique-nique. Et pas si tôt arrivés, les ennuis reprennent de plus bel (remontée d’eaux usées, colonie de fourmis rouges, quand leurs hôtes sont aux prises pour l’un à une brulure au premier de ré, pour l’autre à une péritonite). Les obsessions des uns répondent aux maladresses des autres, le pire et l’absurde sont toujours à portée de main. A l’insu de leur plein gré, tout semble s’organiser autour de la loi de l’emmerdement maximum.
Les couleurs éclatantes accompagnées d’une tornade graphique renforcent le rythme soutenu de cette BD hi-la-ran-te.
Envie d’une BD qui vous fasse rire ? Allez-y foncez !
«Le trafic est perturbé sur l’ensemble de la ligne, en raison d’un incident de panne de signalisation et d’un malaise voyageur et d’un accident de personne et d’une erreur d’affichage et de…»
- All
- Gallery Item
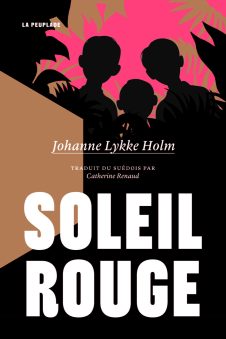
Soleil rouge
de Johanne Lykke Holm
traduit du suédois par Catherine Renaud
Editions La Peuplade
« A l’intérieur de ses paupières, les visages des enfants de son rêve apparaissent à un rythme régulier, comme si les images lui étaient envoyées depuis un endroit lointain dans l’univers, la dimension des enfants non nés qui palpite, un ordre sacré. »
Lire Soleil rouge c’est entrer dans un univers où le temps est comme distendu et les lieux à la fois proches du réels et comme sortis d’un pays imaginaire. C’est une expérience cinématographique où chaque détail du décor, la luminosité, les couleurs, tout est millimétré. C’est comme entrer dans une serre, dans une parfumerie un peu particulière, dans une cuisine ; les odeurs sont à l’honneur. C’est naviguer entre rêve et presque-cauchemar. C’est prendre le temps de ressentir plus que de comprendre. Lire Soleil rouge, c’est tout cela à la fois et c’est ce qui en fait un roman incroyable.
C’est l’histoire d’India, jeune femme universitaire sans enfant (il n’est pas question pour elle de devenir mère, non, vraiment, trop «peur que quelque chose de désagréable ne se transmette en héritage ») et de Kallas son amoureux, sans enfant également (non, vraiment être père ce n’est pas pour lui, il s’était « promis de ne jamais être un père »). Nous sommes dans une ville qui porte le nom du fleuve qui la traverse (mais quelle est cette ville ?). Il y fait chaud et moite, l’été enveloppe tout, ralentit et exacerbe tout. India et Kallas sont beaux (« tu es belle comme la nuit », « tu es beau comme l’aube »), ils vivent une relation amoureuse magnifique. Pourtant quelque chose de latent nous laisse à penser que tout n’est pas si lisse, si simple (ou est-ce l’habitude de lire des romans où les relations ne peuvent pas être simplement belles ?). Kallas a une amie d’enfance, Desma, à l’aura mystérieuse ; India une amie de la fac, Nadja, qui l’aide à garder les pieds sur terre, à ne pas se perdre dans les méandres des œuvres d’Henry James, son sujet d’étude. Un jour, ils partent tous deux dans la riche demeure au bord de mer de Desma. Et puis débarquent trois enfants, seuls, qui n’ont nul par où dormir. Il n’est pas possible de les laisser partir dormir sur la plage, mais il n’est pas possible non plus de les garder. Un incendie se propage soudain. Les autorités locales sont entièrement dédiées à ce fléau et il n’est plus question pour elles de gérer la situation administrative de ces enfants. India et Kallas emmènent donc Alexander, Domenico et Grimaldi en ville.
Commence alors un temps d’apprivoisement, de découverte de sensations et d’émotions jusque-là inconnues aussi bien pour les enfants que pour India et Kallas. C’est quoi être parent ? Ca veut dire quoi former une famille ? Est-il possible de vivre longtemps dans cette bulle hors du temps ?
Johanne Lykke Holm, par l’intermédiaire d’une traduction fine et ciselée, nous happe dans son univers fait de tensions, de sensibilité à fleur de peau et d’onirisme.
Un des plus beaux romans lus ces derniers temps.
« La lumière est chaude, saturée, comme dans un lieu enchanté où un essaim de lucioles serait prisonnier d’une boule de verre. »

La vie fragile
de Louise Pommeret
Illustré par Virginie Billaudeau
Editions du Chemin de fer
«Cette nuit nous allons te la raconter, l’histoire. L’histoire de la maison, des présences qui l’ont traversée, incrustées dans la pierre, enracinées dans le sol, elles sont traces, sédiments».
Nous avions quitté la semaine dernière la Haute-Loire avec le livre Après le virage, c’est chez moi de Marie Kock, on la retrouve avec celui de Louise Pommeret. Cette fois-ci on se retrouve du côté d’une maison sur «un bout de montagne» vers le Mont Pidgier. Cette maison est vouée à démolition. Une route doit passer, nécessité impérieuse oblige, tout doit être détruit, «sans pitié, ni procès». «Demain les fragiles périront dans le chaos des basaltes». Il y a donc urgence à faire l’ « éco-biographie » de ces lieux.
On n’est pas là comme dans la BD de Marion Fayolle, la Maison nue où ce sont des âmes en peine qui se sont rassemblées dans un lieu pour y cohabiter et survivre, chacun avec leurs névroses, on a plus affaire à un chant du cygne polyphonique, fait de ce que animaux, végétaux et minéraux ont retenu du temps passé ensemble, avant que les «hommes de la route» et leur bulldozer se présentent à eux. Les voix humaines ont comme déserté. Tour à tour, telle une assemblée, ce sont l’hêtre puis la mousse, la croix, le pommier, la vigne vierge, la rigole, la ronce, la chouette qui font part de ce territoire vécu. En s’adressant à la dernière occupante des lieux, ils reconstituent le temps long qui les a constitués (Ainsi la mousse qui proclame, «j’ai mis un siècle à devenir ce que je suis aujourd’hui, le coussin des rêves d’enfants. Une poignée de secondes pour un siècles de rêves…»), la mémoire continuée (les témoins non humains de ce «petit cosmos» local prolongent à tour de rôle cette histoire racontée) de ce morceau de terre qui s’est enraciné, de ses occupants, à commencer par la lignée des Marsand et les cycles d’amour et de souffrance qui s’ensuivent (les années du Monstre, les années de la Catastrophe). «L’histoire ne retient-elle que le bonheur, ou le malheur. La tiédeur n’y a pas sa place».
En lisant, La vie fragile on pense bien évidemment à l’A69 censée relier Toulouse à Castres, mais plutôt qu’un développement militant sur l’ineptie de pareil projet, c’est plus la chronique des chaines d’interdépendance, et de l’infra-perceptible dont il est question. «Pourras-tu leur dire (…) que chacun de vos êtres est relié à un autre, et que cet autre habite un règne voisin du nôtre ? Que sans cet invisible qui vous unit à nous, vous n’êtes plus grand-chose, peut-être réduits à rien ?».
La dernière partie du livre laisse la place à «l’échouée», la dernière à avoir vécu en ces lieux, qui s’est métamorphosée au contact des êtres vivants qui peuplent ces lieux et qui peuvent prêter à la rêverie (les fées dans les hêtres, l’oiseau philosophe et l’homme-hibou). Ceux-là mêmes qui ouvrent à l’expérience troublante de «l’interrègne».
Celle qui devient à son tour la narratrice témoigne de l’hospitalité de tout ce petit «peuple du Pidgier». «Pour la première fois je suis restée quelque part ; j’ai cessé d’être atome, poussière, particule, j’ai désiré enfin m’incarner dans la pierre, dans la feuille, dans la sève. (…) La maison était terre ferme face au milieu d’un océan de doutes et de peurs». Au contact de ces autres présences fragiles qui dénoncent («Nous qui ne pouvons ni fuir, ni fermer nos paupières, nous sommes condamnés à voir»), elle fait tout à la fois «peau neuve» et «communauté sensible». Un regard nouveau est porté et une prise de conscience opère : «Plus besoin d’araignée si plus de mouches, plus d’insectes, plus de vermisseaux, dans le meilleur des mondes le nuisible, on a sa peau ! On nous en débarrasse. Ici nous sommes le rien qui existe. Ils vont construire une route là où il n’y a rien». Un bel hommage à ces lieux défaits qui sont passés pour immuables mais qui ne le sont plus, à ces êtres-palimpsestes qui retiennent quelques précieuses traces de notre passage.
«Plus lieu d’être, plus d’être-lieu. Une ferme inhabitée de l’an 1910 ? Plus lieu d’être, plus d’être-lieu».

Vents de mémoire
d’Yves Nadon (texte) et Nathalie Novi (illustration)
Editions D’eux
album jeunesse
«cinquante-deux drapeaux, alignés sur trois cordes. De quoi faire voler sa vie dans le jardin !»
Là-bas et ici. Dharamsala au nord de l’Inde, souvenirs de vacances, souvenirs d’enfance. «Montagnes, vallées et moines». Et puis, emblématiques de ces paysages, les «lungta», ces drapeaux de prière tibétains. «Le vent les faisait vibrer et, selon les tibétains, les prières, portées par le vent, chantaient et imprégnaient l’air partout où celui-ci les trimbalait». Et l’enfant au cœur de cet album décide «d’emmener cette idée» chez sa grand-mère qui a perdu la mémoire. Il relie cette image faite de drapeaux multicolores qui flottent dans le vent à sa grand-mère qui oublie. Cette pensée est matérialisée dans l’album par un fil rouge qui les relie tous deux. On voit l’enfant à quatre pattes s’atteler à préparer des rectangles colorés où il inscrit les «moments de vie» de sa grand-mère. Les images défilent, les souvenirs s’impriment. Un encerclement par des drapeaux, un peu de vent, et la magie opère, «grand-maman est devenue toute souriante, d’un coup, comme synchronisée avec le vent, et un flot de souvenirs l’a inondée». Et la dynamique prend, d’autres souvenirs d’autres personnes se mettent à voler portés par le vent.
L’histoire est magnifiquement servie par les illustrations de Nathalie Novi, parfois le texte est en retrait et là intervient le défilement de véritables peintures, en pleine page, faites des souvenirs de la grand-mère. Une sarabande d’objets, instants, personnes, lieux composant la trame, mais aussi une poétique des souvenirs. Ou comment faire des enfants des grands-parents, et des grands-parents des enfants.
Un album qui fait vibrer notre corde sensible.
«Indépendamment d’où soufflerait la brise, encerclée par ces drapeaux, grand-maman recevrait par le vent ses souvenirs»
- All
- Gallery Item

Après le virage, c'est chez moi
de Marie Kock
Editions La Découverte
«Je désire une maison à moi pour pouvoir me donner l’asile si j’en ai besoin».
Ce livre pourrait être assurément un prolongement de l’essai de Mona Chollet, Chez-soi, une odyssée de l’espace domestique. Marie Kock y développe une réflexion sur ce que peut bien signifier la notion de «chez soi», n’hésitant pas à rendre compte de sa propre expérience.
Pour Marie Kock, ça se passe en Haute-Loire, dans le hameau du V., dans le pays du Meygal. Elle partage sa géographie intime de l’endroit, son biotope d’émerveillement (la forêt derrière la maison, le chemin qui mène au ruisseau, le coin aux champignons, celui aux airelles…). Pour ce qui est du paysage en tant que tel, même si elle n’a de cesse de le rechercher partout où elle va, elle convient qu’elle n’arrive pas à le décrire suffisamment, «les éléments que je pourrais tenter d’accumuler restent des clichés qui ne pourront jamais égaler le tout qui me saisit quand je le regarde», d’où l’enjeu qu’elle dessine, comme une antidote à la bougeotte, «ce que je veux, c’est arriver à lire le monde qui est déjà sous mes yeux».
Bien consciente d’être une «privilégiée de la mobilité», elle renseigne le parcours qui a été le sien, de logement en logement, de ville en ville, persuadée que «le lieu où l’on habite n’est pas toujours celui où l’on se sent chez soi». La preuve à l’appui, elle rend compte de ce qu’elle a ressenti lorsqu’elle a rejoint tour à tour, sans trop se cogner (allusion reprise à l’autrice citant elle-même Perec in Espèces d’espaces) Lille puis Paris, puis Marseille -autant de lieux d’arrivée qui ne cessent d’interroger son lieu de départ- et avec cette illusion tenace d’avoir la possibilité de recommencer à chaque fois une nouvelle vie. Et l’autrice d’interroger : peut-on dépasser son ancrage initial constitué du lieu de son enfance ? «Je me demande ce qu’il me prend de courir partout pour trouver un endroit où planter mes racines».
Marie Kock développe plusieurs perspectives critiques, vis-à-vis des classements des villes où il fait bon vivre, vis-à-vis d’une approche identitaire du territoire («Quand se battre pour son bout de terre devient une question d’identité construite contre les autres»), vis-à-vis de son rapport à la propriété («c’est la peur de l’effondrement, intérieur autant qu’extérieur, qui me fait basculer du côté de la propriété»), vis-à-vis du mépris manifesté à l’endroit de ceux qui ne seraient jamais partis de leur ville d’origine, vis-à-vis de ses propres projections, «Mon rêve de vie simple est un rêve de rentière. Ma petite maison dans la prairie est une version de luxe de l’Ehpad. Et je ne vois pas qui va bien pouvoir payer la note».
Marie Kock prolonge sa réflexion sur quoi repose la poursuite du lieu rêvé. En plus des lieux imaginaires (à l’instar d’Arrakis la planète imaginaire de l’univers du Cycle de Dune), cela pourrait s’apparenter pour elle à un retour en arrière, vers les lieux de son enfance, vers «ce paysage qu’[on reconnaît] comme le sien». «Au moment du choix définitif, c’est ce lieu, aussi littéral que symbolique, que l’on espère retrouver. L’image qu’on se façonne tous et toutes de notre dernière demeure est peut-être finalement ce qui se rapproche le plus de celle qu’on se fait de la maison. De là où l’on voudrait être si l’on avait pas à s’accrocher à nos identités sociales, à flatter nos égos abîmés, à accepter l’insupportable ou le médiocre parce qu’après tout c’est la vie. Ce moment est celui où l’on peut faire la dernière boucle. Où l’on peut décider de l’endroit où faire le noeud».
A mi-chemin entre l’essai et le témoignage, ce livre est écrit avec une grande honnêteté, et indépendamment d’éventuelles origines ligériennes, l’on doit être nombreux/se à se reconnaître dans cet itinéraire de questionnements, somme toute, pas si personnels que ça.
«Depuis que je suis en âge de payer un loyer, je me demande où va commencer ma vraie vie, quelle sera ma vraie maison, l’endroit dont je n’aurai pas envie de repartir».

Les apprenties
de Zoé Jusseret
Editions Frémok (FRMK)
BD sans texte
Quel bel objet que cette BD au format singulier qui nous fait découvrir deux jeunes filles qui s’aventurent dans un paysage marqué par trois immenses pylônes électriques, immensités qui surplombent un horizon dévasté. Un corps de femme git au milieu exposé aux charognards. Dès cette scène inaugurale on sent s’établir entre les deux personnages une relation empreinte de soutien réciproque. Elles vont prendre soin des restes de cette personne. D’autres atteintes et effrois les menacent. Heureusement qu’il y a quelques moments de pause, comme ce bain dans cette étendue d’eau émaillée de fleurs et plumeaux rouges. Heureusement aussi qu’il y a ce filet protecteur rouge dans lequel elles s’emmaillotent. Heureusement qu’il y a aussi les aînées auprès de qui on peut trouver refuge. Le récit offre dans une forme de torpeur ambiante de délicieux moments de contemplation.
Un volcan fait irruption et c’est tout un monde insoupçonné qui se révèle, des créatures outils font leur apparition. Les deux amies exfiltrent un être-fourchette. Mais l’asile est dur à donner dans ce monde fait de désolation. Les abris sont vites détruits et les forêts calcinées. Heureusement qu’on peut compter sur le recours à la présence des disparus. Les esprits rodent et des métamorphoses, des versions augmentées d’elles-mêmes sont toujours possibles. Grandir pour prendre le dessus, pour engager la bataille. L’envie d’en découdre gronde, le besoin de se rebeller est là.
C’est un conte saisissant où le merveilleux opère ici et là par petites touches, où la sororité s’établit en actes. Petit à petit, l’espoir qui s’incarne par le plus petit des collectifs et se conjugue au féminin pluriel, est bien là, à portée d’étreinte. Aussi dérangeant que délicat.

Comment attraper une licorne ?
De Davide Cali, traduit de l’italien par Carole Pasquier
Illustrations de Sara Arosio
Editions Versant Sud
Album jeunesse
«En fait, ce n’est pas facile d’être une licorne.»
Tout le monde sait ce qu’est une licorne… Ou du moins pense savoir ce que c’est. Mais les connait-on si bien que cela ? Sait-on où les trouver et surtout ce qu’elles aiment ? Davide Cali se pose toutes ces questions et amène le jeune lecteur à se les poser avec beaucoup d’humour. En tous cas, il a son avis sur la raison pour laquelle c’est si difficile de les trouver : elles « préfèrent rester incognito » ! Pourquoi ? A vous de le découvrir en lisant l’album !
Cet auteur aime collaborer avec des illustrateur-ices différent-es, ce qui colore, donne une touche particulière à chacun de ses albums. Cette fois, il a travaillé avec une jeune illustratrice avec qui il avait déjà réalisé un documentaire jeunesse sur la question du temps (malheureusement pas encore traduit en français). Sara Arosio a été gardienne de musée à Milan, peut-être cela l’a-t-elle inspirée pour la chasse aux licornes au début de l’histoire ? En tous cas, on aime retrouver des tableaux connus (mais comme les licornes, les connait-on si bien que cela ?) détournés pour faire apparaitre des licornes. On aime aussi les couleurs pop qu’elle utilise, donnant une saveur de bonbon acidulé à chaque page. Enfin, la multitude de détails donnera envie, c’est sûr, au jeune lecteur de lire et relire cet album, pour chaque fois découvrir de nouveaux éléments et imaginer de multiples aventures pour les deux enfants que nous suivons et bien sûr rêver les vies possibles des licornes.
Les albums de Davide Cali sont souvent drôles, toujours sensibles et à coup sûr font réfléchir petits et grands. Une fois encore, pour notre plus grand plaisir, c’est chose faite !
«Pour tout dire, le premier problème, c’est : en débusquer une.»
- All
- Gallery Item
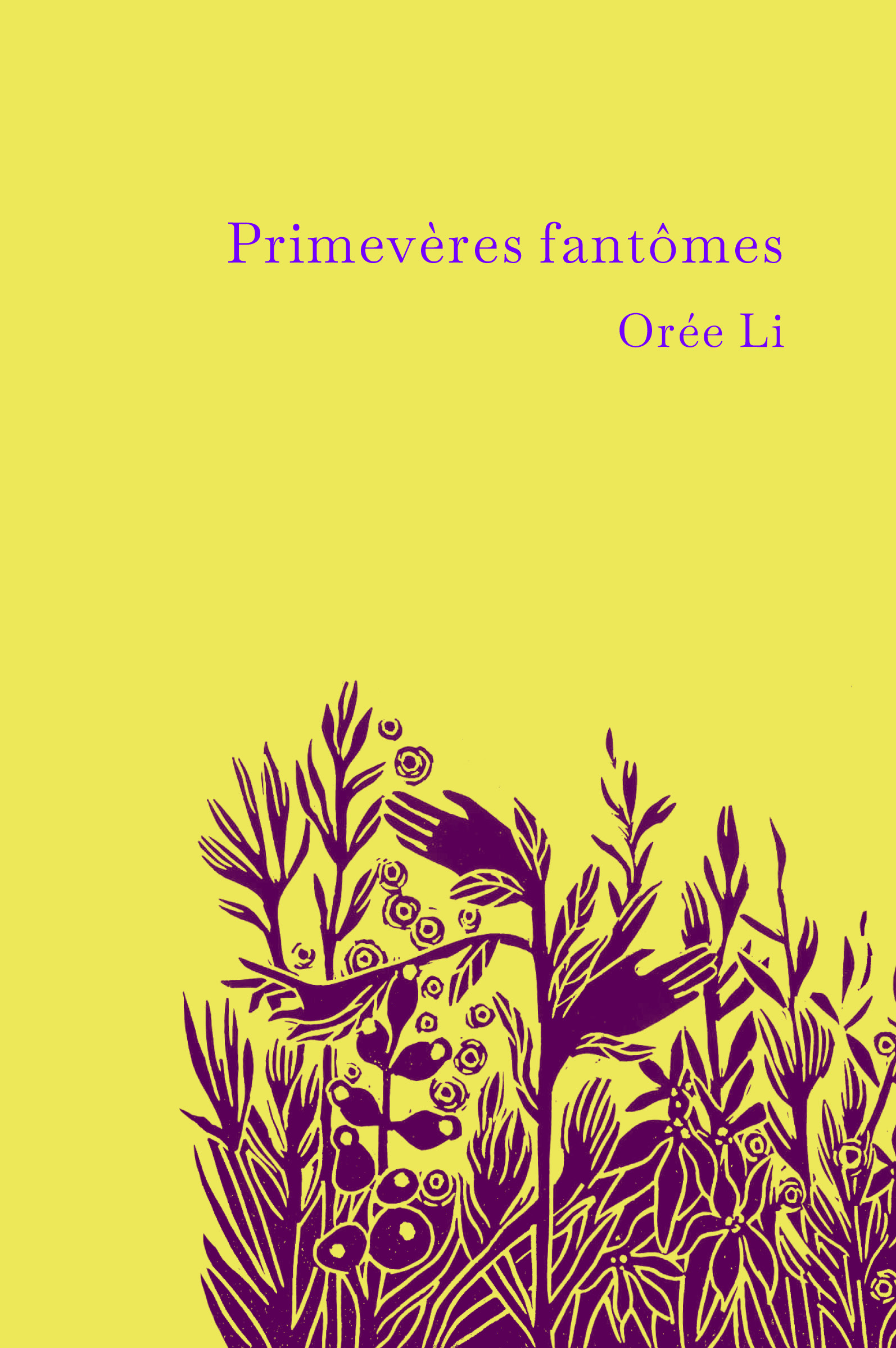
Primevères fantômes
d’Orée Li
Editions des Lisières
«par le chemin du rêve
au-delà d’épiderme
se rendre
à l’évidence de la cellule»
Faire mutation en cinq actes, se faire végétal.e, voilà l’itinéraire de poésie proposé par Orée Li. Alliance avec les fleurs, des plus connues aux inconnues («touffes de fleurs flottantes, touffes de fleurs sans nom») un bouquet de métaphores et de couleurs, avec du jaune comme fil conducteur, «plus jaune que jaune seulement», du jaune moutarde, du jaune jonquille et des brassées de mauve-violet («J’écris d’un Groenland violet dans le ventre»). Au contact charnière d’auteur.ice.s inspirant.e.s, Barbara, Rachel Carlson, Ananda Devi, Anne Dufourmantelle, Emmanuele Coccia.
La métamorphose opère : «Quitte à perdre quelques pans de mon humanité, j’adopte la forme des racines androgynes, de la terre dans le ventre et du sang dans la bouche pour que tout cela pousse. Plantes et poèmes s’accouplent comme le font les sorcières». Les principes actifs de cette mutation et de la poésie qui en procède («il fallait des poèmes qui puissent donner le courage de la métamorphose») se répercutent aussi en «boucle de vie» : «Mon corps danse comme une folle pour raconter la symbiose inespérée».
Orée Li déploie une puissance d’écriture qui vient «entre les friables de la pensée, mes failles qui se cherchent», en réponse à la disparition de sa mère et qui s’exprime aussi à partir de ce lieu défait («nous habitons là dans les ruines») et incompréhensible («je ne connais pas encore le nouveau sens du mot effondrement»), et vis-à-vis duquel il s’agit de faire face : faire émerger «des échafaudages et des cabanes de brindilles», «une nouvelle grammaire», «réfléchir à la suite du rêve», faire apparaître un autre récit qui «s’enclenche avec la force fragile du chèvrefeuille dans les ruines». «Ni propreté, ni politesse, ni perfection, j’écris depuis les décombres et les ravins parce que j’aimerais donner à boire à l’enfant que j’ai été, aux enfants que nous étions, les regarder agir et penser, de la sève plein les tempes» ; «Je trace quelque chose dans l’urgence du désir de vivre encore avec les herbacées». Et «cette tornade d’altérité» fait école : «il y a dans presque tous les territoires non réglementés par l’imagination humaine des personnes qui ont découvert des brèches et qui suivent actuellement le processus».
La poésie sensorielle d’Orée Li est aussi innovante («je voulais inventer une nouvelle histoire»), telle un laboratoire d’écriture, avec le recours à une police de caractère post-binaire (BBB Baskervvol) qui sait «enjambe[r] la frontière barbelée des genres».
Ce recueil nous fait penser, en puisant dans la langue et les sensations de l’enfance à cet immense recueil qu’est Nourrir la pierre de Bronka Nowicka (éd. Corti). Il nous évoque aussi, dans un tout autre contexte, dans ses rapports à la mort («La poésie c’est fait pour faire des arcs-en-ciel avec les armatures de la mort»), à la dégradation, à la métamorphose, à Végétal d’Antoine Percheron (éd. Les Belles Lettres).
Accompagné.e des fleurs, Orée Li fait l’expérience d’apprentissages («Les fleurs m’ont appris à dire mon corps qui n’avait jusqu’ici pas trouvé de famille adéquate (…) leurs mouvements se rapprochent de mon langage et de la façon dont fonctionne mon esprit»), à partir desquels elle développe une poésie toute verticillée plus que versifiée et nous communique un «sens de l’émerveillement» tout à fait salutaire. Il est tout à fait réjouissant de constater, à travers ce chemin de poésie, qu’effectivement, «dans certaines têtes les choses s’imaginent autrement».
Nous aurons la chance d’accueillir Orée Li le 4 avril à la MJC.
Et désormais, à la question c’est quoi de « l’écopoésie« ? Je crois savoir désormais quoi répondre.
«Pourquoi quand je prononce les mots prunus, citron, grenadier ou même pâquerette quelque chose de mon corps se transforme en miracle ?»
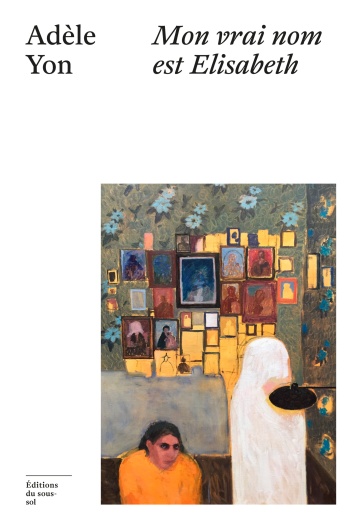
Mon vrai nom est Elisabeth
d’Adèle Yon
Editions du sous-sol
«Comprendre transforme la souffrance en colère, et la colère ne résout rien. Mais la colère a un pouvoir : elle éventre les paravents. Et les fait tomber, elle les brise, elle déchire le tissu avec le bois dont ils sont faits».
Plusieurs semaines déjà que ce formidable texte a été publié et je n’avais pas eu le temps de m’en saisir. Comme une légère frustration de voir fleurir ici et là des papiers dithyrambiques à son propos et de devoir repousser l’accès à cette non-fiction. Les vacances m’ont permis d’en étaler sa lecture, d’en admirer sa facture.
Adèle Yon travaille tout à la fois l’archive et les récits familiaux pour essayer de reconstituer ce qu’il en a été de la vie son arrière-grand mère Elisabeth, celle qui a été photographiée à multiples reprises (notamment par l’oncle de l’autrice) et qui présente un visage mutilé «deux trous, un de chaque côté du crâne», photo qui tranche avec «le visage rond et arrogant des photos de jeunesse». Ces photos participent de l’image que les membres de la famille, notamment ses descendants se sont fait d’elle, de cette créature surnommée Betsy. Celle qui, diagnostiquée schizophrène, a fait l’objet de 17 années d’internement psychiatrique, et d’une lobotomie. «Une histoire à tenir cachée».
Adèle Yon poursuit le cap qu’elle s’est fixé, où les jalons de sa thèse et de l’enquête familiale se confondent : elle remonte la lignée maternelle, découpe (comme elle le fera pendant une année de césure avec des carcasses, ou comme elle le fait avec des oignons en compagnie de son grand-père) les témoignages, retisse les boucles de paroles, exhume les registres des centres d’archives, retranscrit les entretiens, relance les protagonistes malgré les dénégations, les oublis, le poids du silence, les demi-mots, les trous de mémoire. Et jusqu’à s’interroger sur de quoi sont faites les archives («Les archives, comme les histoires que l’on se raconte pour grandir, sont des paravents. Elles dispensent une réalité codée, fractionnée par les plis de l’objet, en grande majorité recouverte, et dont nous ne voyons que le haut, le bas et les interstices»). Qui croire face à cette profusion de récits et à l’absence de dossier médical ?
L’autrice exhume les correspondances, les carnets de recette de son arrière-grand-mère (et sa recette des «cervelles farcies») redécompose les moments de la vie de cette dernière, les circonstances dans lesquelles sa trajectoire de vie s’est enserrée, les interactions qu’elle a eues avec son entourage, à commencer par son mari et ses parents. Adèle Yon est mue par ce souci de «faire jaillir une représentation sinon exacte du moins adéquate de ce qu’a pu vivre Betsy».
Dans un échange épistolaire qu’elle adresse à son mari qui est mobilisé par la guerre, Elisabeth, celle-là même qui revendique sa liberté, veut être actrice de ses décisions dans une époque où cela n’était guère admis, s’exprime ainsi «Pour me rendre heureuse je vous demande aussi de considérer mon tempérament. Le tempérament, c’est un tout que l’on ne peut modifier sans se tuer physiquement et moralement. Pour cela je suis obligée de vous demander de me considérer comme je suis : comme une personne qui a besoin de beaucoup d’air physiquement et moralement ; je ne peux pas vivre en vase clos». Comme une quasi prophétie auto-réalisatrice : cette attention qu’elle requiert de la part de son mari, elle n’y aura pas droit, et Elisabeth fera les frais de cette somme de décisions, comportements autoritaires, abandons et trahisons (grossesses répétées, internement, insulinothérapie, lobotomie, retour chez ses parents).
L’autrice montre très bien en quoi la lobotomie qui a été pratiquée à l’insu d’Elisabeth n’avait pas pour objet d’agir sur les causes de son mal-être mais intervenait «pour prendre à la racine des comportements qui portent préjudice au cadre familial et social». Contenir et non guérir.
C’est tout à fait saisissant que de voir se déplier l’histoire familiale, ses traumas, ses icônes, ses colères, ses souffrances et leurs transmissions à l’oeuvre mais aussi en arrière-fond l’histoire de la psychiatrie et son évolution à partir de la sectorisation (réforme qui constituera du reste le principal motif de la sortie d’hospitalisation de Betsy), mais également la monstrueuse histoire de la lobotomie transorbitaire et de ses artisans-bouchers (à commencer par Walter Freeman, ses pics à glace, sa lobotomobile et son homologue français Marcel David). Une documentation tout à fait édifiante qui vient comme un complément à l’ouvrage qu’on avait présenté pour les fêtes de fin d’année, On mass hysteria de Laia Abril qu’on recommande toujours aussi chaudement. Hystérie et schizophrénie, même combat ? A tout le moins, on n’en peut escamoter la fabrique d’une même violence sociale et institutionnelle sur le corps des femmes. Adèle Yon développe également tout un propos sur la représentation de la folie, et comment elle est essentiellement vécue par sa famille comme relevant d’une transmission génétique, relevant des corps, et non occasionnée ou majorée par des causes environnementales.
Ce que j’ai aussi apprécié à la lecture de ce livre hybride, c’est le soin accordé par l’autrice-chercheuse à vouloir resituer avec précision la configuration de l’instant, le contexte d’énonciation des verbatims des personnes de sa famille ou des professionnels rencontrés. On saisit mieux à ces endroits pourquoi la parole résiste (avec tout un tas de bouclier de protection du style «le passé c’est le passé») ou encore est rendue possible. On saisit aussi ce que ces éléments font vivre à l’autrice personnellement («J’ai le cerveau qui éclate depuis la matrice»). Ainsi, l’autrice explore avec une grande honnêteté, dans une forme d’auto-socio-analyse (d’insight?) son propre rapport à la colère ou à sa propre peur, entretenue depuis l’enfance, d’être folle ou juger comme telle.
Les dernières pages remettent en récit, en place l’histoire d’Elisabeth, et en pièce sa mystification, en pièce aussi la fresque familiale marquée par une hagiographie de l’arrière-grand-père et de son père («et si l’histoire venait [encore] d’au-dessus ?»). Et dans ce qui dépasse ou explique cette histoire, il y a une part conséquente qui est imputable au contrôle patriarcal tel qu’il a été pratiqué à l’endroit d’Elisabeth.
Adèle Yon parvient indubitablement à rendre justice à Elisabeth, et au rang des premières réhabilitations, même si cette dernière n’est que symbolique, elle lui restitue/redonne son vrai prénom, et le titre institue ainsi le commencement de ce processus de réhabilitation.
Livre d’une étonnante puissance. Très chaudement recommandé.
«La colère est ce que nous avons en partage, nous, les descendants de Betsy, ce qu’elle avait, elle, avant, ce qu’on lui a pris et qui vomit en nous».

L'arbrophone
de Donatienne Ranc
Illustrations de Barim
Editions Du Pourquoi Pas
Roman jeunesse
«Tu n’y peux rien toi, Lou… Mais vous autres les Hommes, vous vous croyez seuls sur Terre avec votre pétrole, votre plastique, vos pesticides, vos pitreries. Pourtant vous n’êtes qu’une infime partie du monde.»
On avait déjà beaucoup aimé La Kahute de Donatienne Ranc aussi aux Editions Du Pourquoi Pas. Il était déjà question d’abri et d’écologie. Cette fois, nous ne sommes plus sur une île mais dans un arbre et le vieil homme a laissé la place à une jeune fille d’une dizaine d’années, Lou. Les méfaits de la pollution sont toujours présents, le réchauffement climatique menace les arbres. «La forêt s’étiole et s’inquiète. L’eau sous terre se fait rare pour abreuver nos racines, le soleil se fait brûlant sur nos fruits, l’air colle sa poisse sur nos feuilles.»
Un roman qui pourrait nous rappeler ceux de notre jeunesse : une fillette bien débrouillarde, avec des rêves d’enfant et une autonomie déjà d’adulte, des parents tout juste en toile de fond, des cabanes dans des arbres. Sauf qu’il ne s’agit pas d’une simple petite histoire «gentillette», ce texte est aussi un véritable appel à une prise de conscience écologique et c’est la jeune génération qui pourrait bien sauver les forêts (les adultes ici ne comprennent pas grand chose, et surtout sont bien trop occupés et oublient vite l’essentiel).
Par une nuit d’été, Lou dormait dans sa cabane, construite dans les branches du châtaigner du jardin avec l’aide d’Amandine, 16 ans, fille du garagiste et sacrément bricoleuse. Soudain, elle semble entendre des pulsations provenant du tronc. Vive et curieuse, elle comprend vite que l’arbre a son propre langage et si elle en trouve le code, elle pourra le comprendre et communiquer avec lui. S’ensuit la construction d’un appareil incroyable : l’arbrophone ! Mais qu’a-t-il à dire à Lou, à nous, cet arbre centenaire ?
Barim a illustré cette histoire en donnant à Lou des faux airs de Fifi Brindacier (on retrouve ses jolies tresses rousses), et c’est vrai qu’on pourrait leur trouver une jolie filiation. L’écureuil acolyte nous observe de ses yeux tout ronds. Le châtaigner est massif, presque géant. Et l’arbrophone semble prêt à nous livrer ses messages.
Une fin ouverte, qui se termine comme se terminerait une histoire qui passerait de bouche à oreille. A force on ne sait plus bien d’où elle vient, on ne sait plus bien si elle est vraie ou pas, quelques éléments ont peut-être changé. Mais l’essentiel reste bel et bien en mémoire et elle continue ainsi de vivre et de garder en alerte enfants et peut-être plus grands.
Les arbres parlent, qu’on se le disent, et ils ont encore beaucoup de choses à nous apprendre, les enfants aussi !
«Je suis immobile, la tête contre le tronc. Soudain, je sens des coups étranges dans le bois. Comme un rythme sourd, une percussion lointaine.»
- All
- Gallery Item
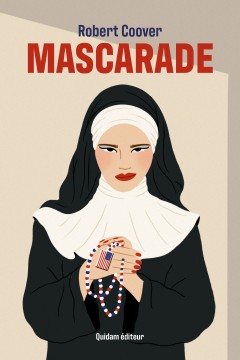
Mascarade
de Robert Coover
traduit de l’anglais par Stéphane Vanderhaeghe
Editions Quidam
«Les murs semblant s’écarter sur leur chemin, comme si l’appartement s’étirait pour faire de la place à tout ce beau monde».
Prenez un penthouse situé tout en haut d’un building. S’y joue une fête sans queue ni tête. On y croise des personnages, comme il est si bien dit dans la préface «créés à l’image de l’Amérique», «tous plus verbeux les uns que les autres», qui «ne peuvent prétendre à autre chose que de rester les mauvais acteurs qu’ils sont dans cette farce métaphysique et grinçante dont l’enjeu les dépasse allègrement». Le ton est donné. Tous les protagonistes semblent être des caricatures d’eux-mêmes, à commencer par un trio de musiciens improbables venus ambiancer les lieux. La grande réussite de ce texte tient pour partie dans le maniement amusé par l’auteur d’un «glissanto narratif» : les narrateurs se suivent et se passent le relais parfois même au sein d’une même phrase, autorisant ainsi de multiplier les points de vue, de rendre possible qu’une chose en amène une autre. Une somme de je, une somme de jeux.
Des gens qui n’auraient pas eu à se croiser se retrouvent dans cet espace-temps qui se prolonge le temps d’une soirée. Si le lecteur est un peu perdu dans tout ça c’est que la promesse de cet imbroglio narratif est tenue. Comme les invités qui ne savent pas très bien comment ils se sont retrouvés là, on cherche à savoir qui pourrait bien être les hôtes, et l’on se rend compte que les propriétaires des lieux peuvent en cacher d’autres et certains protagonistes ont leur remplaçants (barman, serveuse…). L’illusion fonctionne à plein, à l’instar de l’absence de serrure sur les portes ou de l’ascenseur hors service, à l’instar des pièces qui se forment et se déforment tout comme l’intrigue. Les participants sont contraints de jouer la comédie («cette soirée doit être un putain de cauchemar pour un rationaliste»), de suivre le mouvement, d’une pièce à l’autre, d’un fragment de conversation à l’autre. Jusqu’au toit-terrasse d’où sont jetés certains importuns sans que cela ne produise quelque émoi. Ça grouille de monde, l’effervescence carnavalesque est à son comble : une galerie de personnages chamarrés et égotistes se dessine, de l’agente immobilier, à l’écrivaine, en passant par la nonne, une femme qui n’en finit pas d’accoucher ou encore un prof qui réfléchit sur l’intelligence en essaim. Somme toute, des êtres de solitude qui tentent de survivre à leur façon («Mais pourquoi est-ce que l’on tient à ce point à l’idée même de survie ?»), tous, déraisonnables, vaniteux et ironiques à souhait, affairés «aux activités d’usage dans les soirées : ils boivent, ils flirtent, il s’échangent les tuyaux rémunérateurs, se gavent d’amuse-gueule, puis rient la bouche pleine, s’enlacent et se cognent le nez, se pincent les fesses chacun leur tour».
Toute la vacuité des existences adossée au formidable chaos d’un pays se trouve avalée en tourbillon dans cette mascarade bien sentie qui se fixerait pour horizon d’attente une danse macabre.
Un lecture certes parfois difficile qui se mérite donc mais une fois adopté le style si singulier de l’auteur, on en ressort bluffé.
«L’abrutissement pourrait bien être la seule option qu’il nous reste, si on veut survivre sur cette planète patraque».
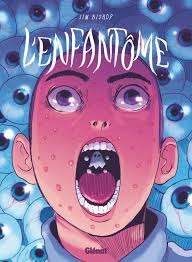
L'Enfantôme
de Jim Bishop
Editions Glénat
BD
«Le monde nous apprend à marcher sur la tête et essaye de nous faire croire que c’est bien».
Après les BD Lettres perdues, puis Mon ami Pierrot, L’enfantôme constitue le troisième volet de la «trilogie de l’enfant», mais il peut tout à fait se lire indépendamment des deux premiers.
On est au Collège et la bienveillance n’est pas au programme. L’un s’appelle le «boutonneux», la seconde «la bizarre». Ils se démènent face au regard des autres et contre une institution qui ne leur veut pas du bien et des parents qui leur mettent une pression inconsidérée. Ou comment les figures de l’autorité s’érigent en force.
Cette année est décrétée comme étant une année décisive, et le conseiller d’orientation, Monsieur Marano-qui-a-la-tête-qui-menace-d’exploser a décidé que si ces deux cancres échouaient, ce seraient à leurs parents de les tuer. Tel est le programme de motivation.
Autour du manga Pimple Attack, nait une relation d’amitié. Ils se serrent les coudes pour survivre à cette pression qui rend complètement «dingues» leurs parents, «Tout ça, parce qu’ils veulent être bien vus du système», car au conformisme punitif du collège répond celui des parents.
Plus loin (dans la deuxième partie), changement d’ambiance : on les retrouve en être-fantôme, «les grands esprits se rencontrent», toujours en recherche de sens, toujours hantés par ce jugement, tout en disqualification, qui leur a été porté et qui continue à produire ses effets («Mais cet œil qui nous juge… c’est ça qui nous a tués»). L’histoire paraît recommencer, de nouvelles humiliations sont en préparation, Monsieur Marano est devenu directeur du Collège, il les punit avec des lignes d’écritures «je suis nul». La conseillère emploi y va aussi de son verdict «vous avez écrit que vous aimeriez être gérant d’un magasin de jeux vidéo. Vous n’avez même pas le bac. A la limite, je peux vous trouvez un poste pour rayonnage». Les jugements en cascade, l’insupportable à son paroxysme.
Jim Bishop déploie toute une palette pour rendre compte de cet insupportable, les aplats de couleur sont démentiels, et l’auteur sait jouer avec les codes du manga et de l’horrifique – on est parfois pas très loin de l’univers d’un Junji Ito.
«Perso, je rentre pas dans votre jeu de bourrage de crâne qui nous amène tous au même endroit. On le sait qu’on va tous crever. Alors laissez-moi y aller à mon rythme».
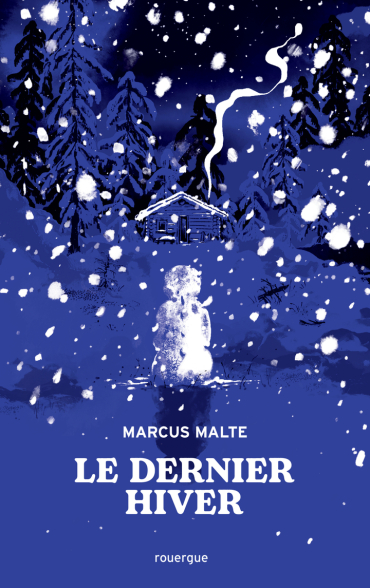
Le dernier hiver
de Marcus Malte
Editions du Rouergue
«Nous parlâmes de rêve. Nous parlâmes d’amour. Nous parlâmes de ce qui brille. De l’éclat des astres, de nos astres, quels qu’ils soient. Nous parlâmes de ce qui vaut la peine.»
Pas évident de s’adresser aux ados. Quand ils sont « lecteurs« , généralement ce sont de très bons lecteurs qui aiment lire des « pavés« . Quand ils « n’aiment pas lire« , leur proposer un court roman comme ceux de la collection Doado des éditions du Rouergue pourrait être une bonne alternative, sachant que la qualité littéraire est à chaque fois au rendez-vous. Pour autant, ça ne va pas de soi… Et c’est bien dommage car ce court roman est une pépite qui mérite d’être lu quand on a déjà quelques références historiques et littéraires. Il ne faut donc pas être trop jeune, ou alors en faire une lecture accompagnée d’un adulte.
Mais de quoi parle Le dernier hiver ? Il s’agit d’un portrait du monde sur trois siècles, un monde qui va mal et se réchauffe inexorablement. Pour nous raconter cette histoire, Marcus Malte (qu’on connait aussi bien pour ses romans jeunesse qu’adulte) choisit un narrateur un brin décalé (et en même temps directement touché par le changement climatique) : un bonhomme de neige. On pense tout de suite au poème de Prévert et ce bonhomme de neige adopté et réchauffé par la cheminée. Ici, l’être de flocon naît et meurt plusieurs fois, à des époques et lieux différents de la planète. Il a chaque fois des parents et compagnons différents, fratrie, père, élèves et professeurs, soldat, sherpa, loups… Il rencontre même Jack London et son chien Buck. Il les accompagne quelques jours, semaines ou mois, dans de bons mais aussi tristes moments. Il voit la mort de près, que ce soit de froid ou causée par l’horreur de la guerre. Il vit le silence de Tchernobyl après l’explosion. Enfin, il se retrouve de plus en plus en altitude, signifiant ainsi la fonte des neiges. Tout ceci est dit avec justesse, avec les yeux d’un observateur qui a vécu, tel un aïeul qui nous conterait son enfance. Une lecture idéale pour les vacances d’hiver.
«J’ai eu autant de vies qu’il y a eu d’hivers. Il est vrai que je ne fais pas mon âge. On m’en a souvent fait la remarque.»
- All
- Gallery Item
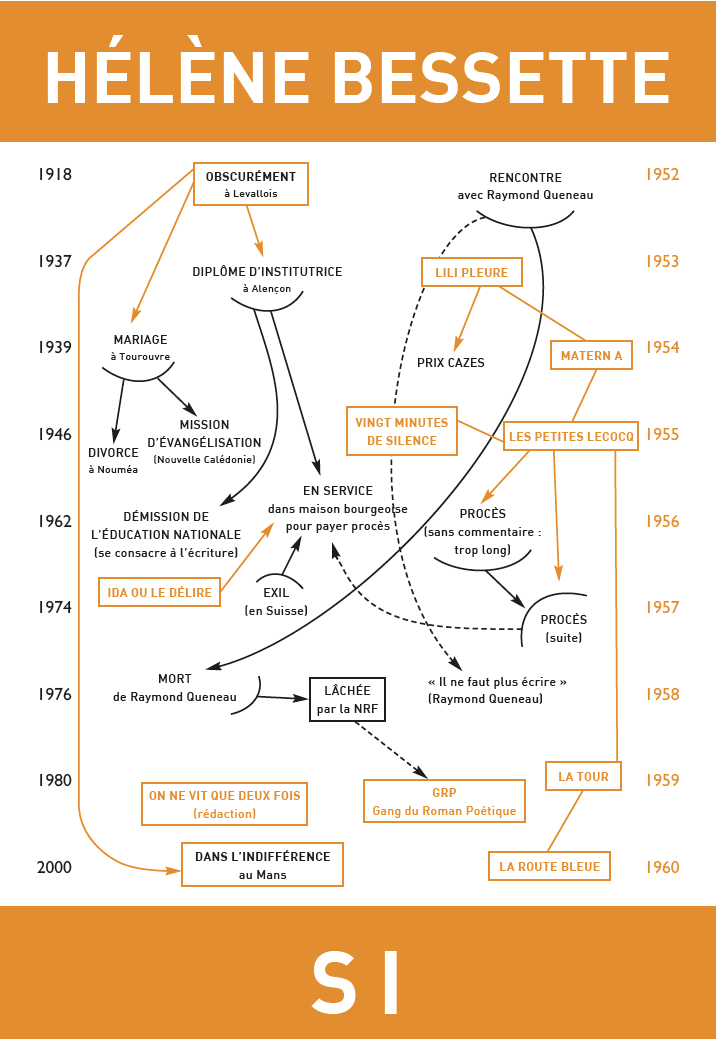
Si
de Hélène Bessette (LN B7)
Editions Le Nouvel Attila
«Je n’ai qu’une richesse.
Décider de ma fin,
Puis,
M’en allant au Ciné.
(Le suicide est pour demain.)»
Si a été édité une première fois chez Gallimard en 1964, puis en 2012 chez Léo Scheer.
Lire Hélène Bessette, c’est toujours une aventure, c’est tournoyant, tumultueux, bouleversant.
D’abord il y a la forme: à la fois roman et poésie (elle a d’ailleurs créé le Gang du Roman Poétique), presque du théâtre parfois. Une histoire en vers, des répétitions, comme des motifs qui reviennent en boucle pour chaque fois aller plus loin, aller ailleurs, mais toujours revenir au point central : l’envie de suicide de Désira. Des mots qui se détachent, en capitales, pour mieux imprimer la rétine du lecteur (« SI », « EPOUVANTE », « SUICIDE », « MAIS »…). D’autres qui se découpent, se transforment, se démultiplient. Des questions aussi, qui semblent des adresses directes au lecteur (« DOIS-JE ME SUICIDER ? », « QUI SUIS-JE ? », « MEURS-JE ? »…). Des personnes (des hommes surtout, des voisins, quelques amies) qui entrent et sortent de scène, comme ils tentent d’entrer sans réellement y parvenir dans la vie de Désira. Un roman conçu en plusieurs parties, comme pour reprendre sa respiration (car il y a de quoi perdre haleine).
Et puis il y a le fond : une femme, Désira, trente ans, divorcée souhaite se suicider. A première vue le sujet est lourd, voire plombant. Mais Hélène Bessette, au lieu de l’enfermer dans un rôle de victime, en fait une femme libre, qui revendique sa solitude et son droit à choisir de vivre ou mourir. Et cela trouble son entourage. Elle n’entre pas dans les cases prédéfinies par la société des années 50 – 60. Une femme, seule, peut-elle se promener dans la rue, aller au cinéma ? Cela questionne ses voisins qui lisent son courrier et scrutent ses allées et venues. Ses amies pensent qu’elle devrait se marier. Les hommes la soupçonnent d’être une fille-facile et tentent tous leur chance (« Tous. Tous. Chacun à sa manière. Ont les yeux fixés. Sur mon bas-ventre. Sur mon sexe. Quelles questions ai-je posées ? Qui suis-je ? Et Dois-je me tuer ? »). Mais Désira reste droite. A quel prix… La folie guette (ou est-ce son entourage qui la croit folle ?).
Et Surtout, il y a cette forme et ce fond qui s’entremêlent admirablement pour former une œuvre unique et percutante, d’une incroyable modernité.
« Je n’ai pas l’étoffe d’une héroïne. Mais cela va de soi l’étoffe d’une suicidée. »
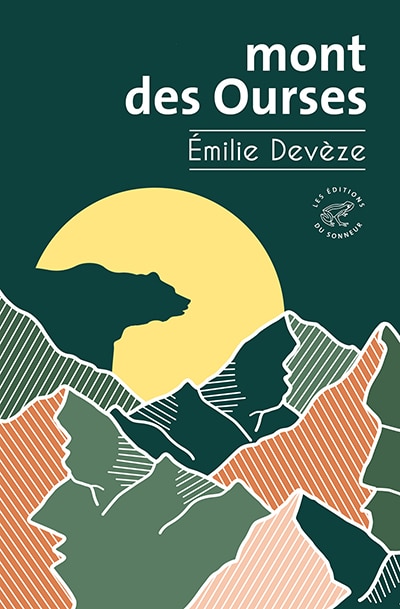
Mont des Ourses
d’Emilie Devèze
Editions du Sonneur
(couverture réalisée par Sandrine Duvillier)
«Comme bien des hommes au sommet d’un massif il croyait voir dans la terre déclive et la vallée miniature se matérialiser sa suprématie».
C’est l’histoire de Jean-Code le gendarme qui veut tout mettre au masculin, très soucieux de respecter la hiérarchie, engoncé dans ses certitudes, et qui est muté dans un village enclavé au milieu des montagnes et qui ne porte pas de nom, on l’appelle Ici. Moins de 200 âmes, «tous cousins». Il embarque avec lui sa fille Hazel (qu’il appelle Croque-au-Sel), «dressée au respect des périmètres», à qui il n’adresse quasiment jamais la parole. Hazel fait rapidement connaissance avec la voisine Ursula qui a plus d’un savoir dans son sac, ce qui peut être utile pour explorer les environs, aller sur les hauteurs (les reliefs d’une montagne accompagnent graphiquement le déroulé du roman). C’est qu’Hazel s’est mise en tête de disculper l’ourse que son père a pris pour la responsable d’un double meurtre. Et un glissement de terrain a effacé les repères («les cartes de la territorialité se trouvaient rebattues par le mouvement de sol»). Contrainte de se fier à son instinct et aux animaux avec lesquels elle se lie, s’allie.
A la lecture de Mont des Ourses, on peut penser à La sauvagière de Corinne Morel-Darleux, avec ces incursions dans la forêt où une plus grande porosité avec les animaux s’opère. L’empouvoirement d’Hazel, son émancipation passe par son enquête de terrain. Une petite troupe prend forme à partir de laquelle s’organise un contre-récit, «Avec leurs convives, ils échangeaient des recettes, des chants, des contes et des idées» ; «L’histoire du monde à mille branches se tissait autour du feu». Plus je lis et plus je me rends compte en ce moment d’une envie (doublée d’un besoin ?) de lire des contes. D’en relire certes mais aussi de faire l’expérience de nouvelles lectures qui s’apparentent à des contes. Appelons cette construction littéraire un conte philosophique ou écoféminsite, là n’est pas l’essentiel. Avec son premier roman Emilie Devèze nous offre cela, le tout servi avec pas mal d’humour. C’est fort bien réussi et on en redemande.
«Hazel s’entendait avec les bêtes. C’était de son âge, paraît-il.»

Peur de mourir mais flemme de vivre
de Salomé LAHOCHE
Editions Exemplaire
«Ces derniers temps, on parle beaucoup de santé mentale sur internet. A la fois, ça permet à des gens de poser des mots sur des troubles passés sous le radar des médecins et en même temps, tout le monde s’improvise un bac+5 en psycho et pratique l’autodiagnostic sauvage, comme si parfois c’était inconcevable d’être un être humain banal avec quelques défaillances ».
C’est avec délice qu’on s’engouffre dans cette nouvelle BD de Salomé Lahoche, qui constitue une suite de « La vie est une corvée ». On y retrouve des strips qui ont été publiés sur son compte Instagram (@salomelahoche) mais aussi dans la revue La déferlante ou la revue jeunesse Biscoto, ou encore en réponse à une commande du Centre Pompidou. Ça pourrait apparaître comme une succession hétéroclite, mais l’ensemble forme un tout cohérent. On retrouve sa petite touche arty, beaucoup de texte et cette furieuse envie de croquer le monde-tel-qu’il-ne-va-pas-mais-vraiment-pas-bien. Comme beaucoup de bédéistes, l’autrice manie avec un sens redoutable l’auto-dérision. Elle s’exprime sans fard (« parler de tout ça est sans doute la chose la plus intime que j’aie jamais racontée en bande-dessinée ») sur son rapport à la consommation, au succès («il a suffi de quelques mois à avoir vaguement de l’argent pour que je devienne une imbécile heureuse déconnectée de la réalité »), au psy. Il est aussi beaucoup question de ses comportements addictifs, à l’alcool et aux clopes (« plutôt crever d’un cancer des poumons debout qu’arrêter de fumer à genoux ») et de ses obsessions (la collection de petites perles en plastique). Tout comme les angoisses et la procrastination qui encadrent le processus créatif et les résolutions qu’elle ne tient pas (elle abandonne le yoga au bout de quatre séances après avoir payé pour un an d’avance).
On n’est pas très surpris que l’autrice ait pu faire référence au travail de la plasticienne belge Aurélie William Levaux dont on a beaucoup aimé la dernière BD, New rural wave (édition Atrabile). Elle la rejoint notamment dans cette capacité critique à faire des ponts entre les expériences intimes et le politique… Très vite on s’aperçoit dans l’abondance de texte qu’elle propose que ce qui peut s’apparenter à du dérisoire, du futile n’en est finalement pas. Au fil des pages, l’autrice devient sismographe de nos névroses et autres éco-anxiétés.
Cette nouvelle BD lui apportera à coup sûr la possibilité d’acquérir de nombreux autres critériums. Corrosif et réjouissant à souhait.
«Ce qui est marrant avec le fait de vieillir, c’est qu’on a beau savoir que ça arrive à tout le monde, quand vient notre tour, on ne peut pas s’empêcher d’être un peu surpris».
- All
- Gallery Item

Je veux regarder longtemps leurs visages
de Thomas Vinau
Editions La fosse aux ours
«Arnaquer les ténèbres, avec la cendre bleue des mots, pour aller jusqu’à eux. Arnaquer un instant les ténèbres, pour arriver jusqu’à eux, un instant et, finalement, simplement, leur dire je pense à vous.»
A la faveur de la commémoration des 80 ans de la libération des camps de concentration nazis, il y a une belle actualité éditoriale. Mais des différentes propositions, je retiendrai ce petit texte de quarante pages qui vient nous saisir. Ecrire sur une photo en noir et blanc, sur ces trente-et-un enfants d’Yzieu rassemblés au printemps 1944. Ecrire, «comme un besoin», «comme unique recours» avant l’indicible : «regarder longtemps leurs visages, et leur écrire avec la cendre bleue de mes mots». Figer le merveilleux de l’instant, l’éblouissante enfance («espiègles, maladroits, pétillants, gigoteurs», «frondeurs, (…) sales, sublimes») sans escamoter l’atrocité de l’après, «l’horreur de leur destinée» : «Eux, au-delà de cette horreur, effective, l’horreur qui les définit à présent entièrement, totalement, éternellement.»
Thomas Vinau s’emploie à évoquer cette photo qui «accroche [ses] yeux», la décrire, en rendre compte avec une économie et une justesse de mots. Sonder «les traces magiques et éphémères de leurs présences sur une image» et «atteindre l’infime chaleur de leur immense beauté saccagée». Les visages enfantins, les poses, les postures, gestuelles et expressions («un sourire qui hésite», «ce doigt dans le nez»…), les interactions, tout est passé au crible de son regard impliqué, «sous le pinceau d’archéologue de mes yeux et de mes mots». «Les voir, les regarder, les sentir». Mais au jeu des différences (les grands, les petits, les garçons, les filles), Thomas Vinau ne se leurre pas : «je sais bien que ce qui les unit, ce qui a fait qu’ils sont là, ensemble, devant mes yeux, est bien plus immense, bien plus puissant que tout ce qui les distingue».
L’auteur invente des prétextes («une vanne, un bruit indécent, une bêtise») à leurs distractions, pour expliquer pourquoi certains retournent leur tête ou baissent le regard au moment où la photo est prise. Comme n’étant déjà plus là : «Et il baisse son visage à cet instant, au mauvais moment, on ne le verra plus jamais».
La photo «qui dévore le coeur» s’affiche dans le livre à 5 reprises, en creux et en plein. L’auteur parvient, à travers elle et avec cette manière si délicate qu’il a de «faire attention à eux», à engager le lecteur à ses côtés et à leurs côtés («tellement ils incarnent, de loin, dans le temps et l’espace, tout ce que l’on sait de l’enfance qui nous touche, tout ce qu’on aime. Cette tendre surface»). Ainsi quand le poète regarde et détaille plusieurs fois la photo, le lecteur la regarde et la détaille plusieurs fois avec lui, en complicité bleue.
Les profs, dès le premier degré, auraient grand intérêt à s’emparer de ce petit livre rouge. Il gagne tellement à être lu par les plus jeunes générations.
D’une très très grande justesse.
«Mais d’abord juste l’image, veiller à cela, la photo, leurs visages, les regarder. Un par un, la beauté.»

Sophia
de Eléonore de Duve
Editions Corti
«Elle avance et tourillonne à chair perdue, agissante»
D’Eléonore de Duve on avait lu son premier roman, Donato. On s’en était fait l’écho ici avec enthousiasme. C’est donc de nouveau, un peu chanceux, qu’en tant que libraire, j’ai pu lire son second roman, Sophia. On y retrouve la même force d’évocations. A rebours (du chapitre 47 au chapitre 1), de la mort à la vie, en quarante-sept tableaux, se dessine l’agencement de la vie de Sophia, sa traversée, son vagabondage, sa métamorphose («Ses pieds nus effleurent à peine la mousse sans vie du sol, tant elle sautèle, dans un mouvement qui éviterait les mines, tant elle veut aller vite, ressentir, sans joie ni haine, sans espoir ni entrave, là, au froid»). D’une ritournelle à l’autre, d’un moment de vie à l’autre, les motifs, comme les flous, paraissent s’intriquer («Des liens se tressent lors même qu’il n’y en a pas. Les causes se trouvent ailleurs et se démultiplient dans l’engrenage»). Sophia évolue à l’écart («elle s’encage, un peu dorée, à côté de la société» ; «elle voulait former corps à part avec la tendresse»), «la solitude en bonne amie», «progresse à tâtillons», rit de bon cœur à l’absurdité des choses.
Face au chaos, à un monde ravagé, qui ne tient plus debout, Sophia «doit fermer les yeux, s’arrêter de décomposer les confusions du monde (…) s’efforce[r] de composer les idées du silence». Elle apprend aussi à «s’exerce[r] à l’espoir» à grand renfort de danse, de fiction, de couleur et de botanique.
Il y a un peu de Bérangère Cournut dans ce surgissement du merveilleux, un peu de Bronka Nowicka dans ses observations poétiques de la nature à hauteur d’enfant, un peu de Emilienne Malfatto (Le colonel ne dort pas) pour l’indétermination de l’espace-temps et pour la description des décombres d’une guerre qui ressemble à toutes les guerres et qui n’en finit pas, un peu de Kae Tempest avec cette remontée du fil le long d’une chronologie inversée qu’on retrouve dans Courir sur les cordes.
A l’image de Sophia, à l’image de l’écriture d’Eléonore de Duve qui avance à coup de virgules, le lecteur «tourne-tourne», fait des liens, des projections, associe des idées, «additionne les regards», relie les choses. Un superbe terrain de jeu que cette lecture. Il rêve même de ré-apprendre à «colorier en dépassant des bords».
Une fois la lecture terminée, on est pris de l’envie de relire le texte dans l’autre sens pour voir. Et ainsi, tout semble pouvoir recommencer.
Superbe !
« Le soir emmantèle la rivière
La lune courbe le temps.
Qui sait où le passereau s’en va. »
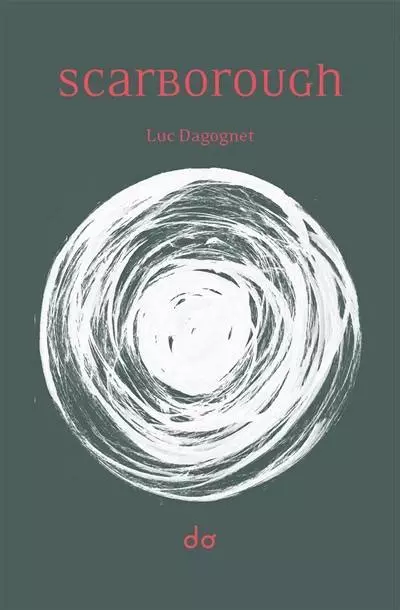
Scarborough
De Luc Dagognet
Editions Do
« Je me suis éveillé le matin avec la sensation d’avoir rêvé un message important, sans parvenir à me le rappeler. J’ai fait le tour de la chambre avant d’en sortir, au cas où le souvenir n’aurait besoin que d’un peu d’agitation pour se manifester à nouveau. »
Scarborough c’est d’abord une nouvelle d’un vieux livre offert par une vieille tante à un jeune adolescent (qui n’est autre que le narrateur du roman, devenu adulte). Dans cette histoire, au charme un brin suranné rappelant quelque bibliothèque verte de type club des cinq ou Alice, un groupe de jeunes gens partt en week-end à la campagne et pendant la nuit tous disparaissent sauf un.
Scarborough c’est aussi cette chanson de Simon & Garfunkel que notre héros entend pour la 1ère fois alors qu’il vient de lire la nouvelle. Ces quelques notes entendues dans le jardin vont lui rester en mémoire, telle une mélodie entêtante qui ne le quitte plus. Adulte, il réentend cette musique, apprend enfin son titre et de qui elle est. Et là tout se dérègle. Un mystérieux élève apparait inopinément pendant ses cours. Tout le monde semble le connaître sauf lui. Cherchant des renseignements sur la chanson, il tombe sur un enregistrement qui ressemble à une incantation « diabolique ». Puis, il fait le lien entre la nouvelle et la chanson et cherche à lire d’autres œuvres de l’auteur. Il trouve alors une autre nouvelle qui se passe… à Scarborough !
Les coïncidences s’enchainent, l’étrange et le surnaturel s’en mêlent, entrainant le narrateur dans une quête aussi floue que son esprit est embrumé (après tout la chanson parle également d’une quête pour séduire une femme : labourer un champ entre terre et mer à l’aide d’une faux en cuir, habillé d’une tunique sans couture). Il ne lui reste plus qu’à se rendre dans cette bourgade anglaise pour se défaire de ce qui pourrait s’apparenter à un maléfice. Dans cette petite ville, il fait la rencontre de Donna, de Jessie et d’Aileen, un brin sorcières, chacune à leur manière.
La chanson est toujours là et Luc Dagognet construit son roman autour de cette ritournelle, comme un refrain qu’on garde en tête et qui revient encore et encore. « Are you going to Scarborough Fair ? Parsley, sage, rosemary, and thyme ».
Laissez-vous surprendre par Scarborough.
« Tout va bien, si ce n’est la présence glaçante d’un jeune garçon inconnu, au dernier rang, qui ne fait même pas l’effort de se cacher. »
- All
- Gallery Item

Un jeu sans fin
de Richard Powers
traduit de l’anglais par Serge Chauvin
Editions Actes Sud
Sortie le 5 février 2025
« Il fit glisser ma tour de son refuge de la ligne de fond jusqu’à un avant-poste périlleux au centre de l’échiquier.
« Ah ! Tu vois ? Ton cœur s’emballe. Ce n’est pas de la logique. C’est du drame. »
Le livre début avec une histoire, celle de la création du monde : « Ta’aora créa Ta’aora. Puis il créa un œuf qui l’abritait. » Ta’aora était artiste alors il joua, inventa, imagina les fondations de la Terre à partir des « miettes de coquille », les mers et océans à partir de ses larmes, les îles à partir de ses os, les écailles de poissons et tortues avec ses ongles. Il peupla ce monde d’autres dieux qui peuplèrent à leur tour cet univers. « Il plaça les humains – enfin des compagnons avec qui jouer. »
Tel un prologue, cette cosmogonie nous donne les pièces et le plateau de jeu dans lequel va nous embarquer Richard Powers : des humains (se prenant parfois pour Dieu), qui jouent à créer et imaginer sans cesse de nouveaux possibles, au risque parfois de (se) perdre, et un terrain de jeu (d’où le titre original « Playground »), entre terre et océans.
Si au départ il est question d’échecs, le cours des choses prend un nouveau tournant lorsque Todd et Rafi (deux figures que nous suivons tout au long du roman) découvrent le jeu de go. Il n’est plus question de faire chuter l’autre, il s’agit de construire un territoire le plus grand possible. Les combinaisons sont démultipliées. Alors que Todd y voit des algorithmes et les fondements du code informatique, Rafi, en littéraire, y lit tous les drames de la vie. A la fois si proches et si différents dans leurs modes de pensée, leurs vies se séparent. Todd devient un informaticien milliardaire à la tête d’un empire de l’intelligence artificielle. Rafi part quant à lui vivre sur une petite île du Pacifique: Makatea (île dévastée par l’exploitation intensive des mines de phosphate). Quand on sait que Richard Powers a débuté comme informaticien avant de devenir écrivain, on peut se demander si ces deux personnages ne seraient pas en quelque sorte les deux facettes de l’auteur. La richesse de ce roman est aussi de mêler deux sujets de prédilection de l’écrivain : l’IA et l’écologie. On se rappelle Galatea 2.2 ou L’ombre en fuite sur la réalité virtuelle, L’arbre Monde sur l’écologie et Sidération mêlant déjà les deux. Ici la question de l’écologie se concentre sur les milieux marins menacés par un projet de villes flottantes imaginées grâce à l’IA. La plongée aux côtés de l’océanographe Evelyne Beaulieu nous réserve les plus belles descriptions du livre.
Telles une partie de go, les histoires des différents protagonistes se développent à distance, s’intriquent par moments les unes aux autres. Tel un joueur de go, Richard Powers construit ses histoires, lentement, avec méthode. Tel l’observateur d’une partie de go, le lecteur se fait surprendre, ne peut imaginer tous les coups à venir.
Dans ce roman, qui perd ? Qui gagne ? Richard Powers jouerait-il avec nous ? « Un jeu sans fin » nous dit le titre…
« C’est ainsi que tout commença : notre grand voyage à deux dans l’univers du go. Tout ce qui se produisit plus tard – le cours que prirent nos vies – découla de l’ouverture de ce livre. »
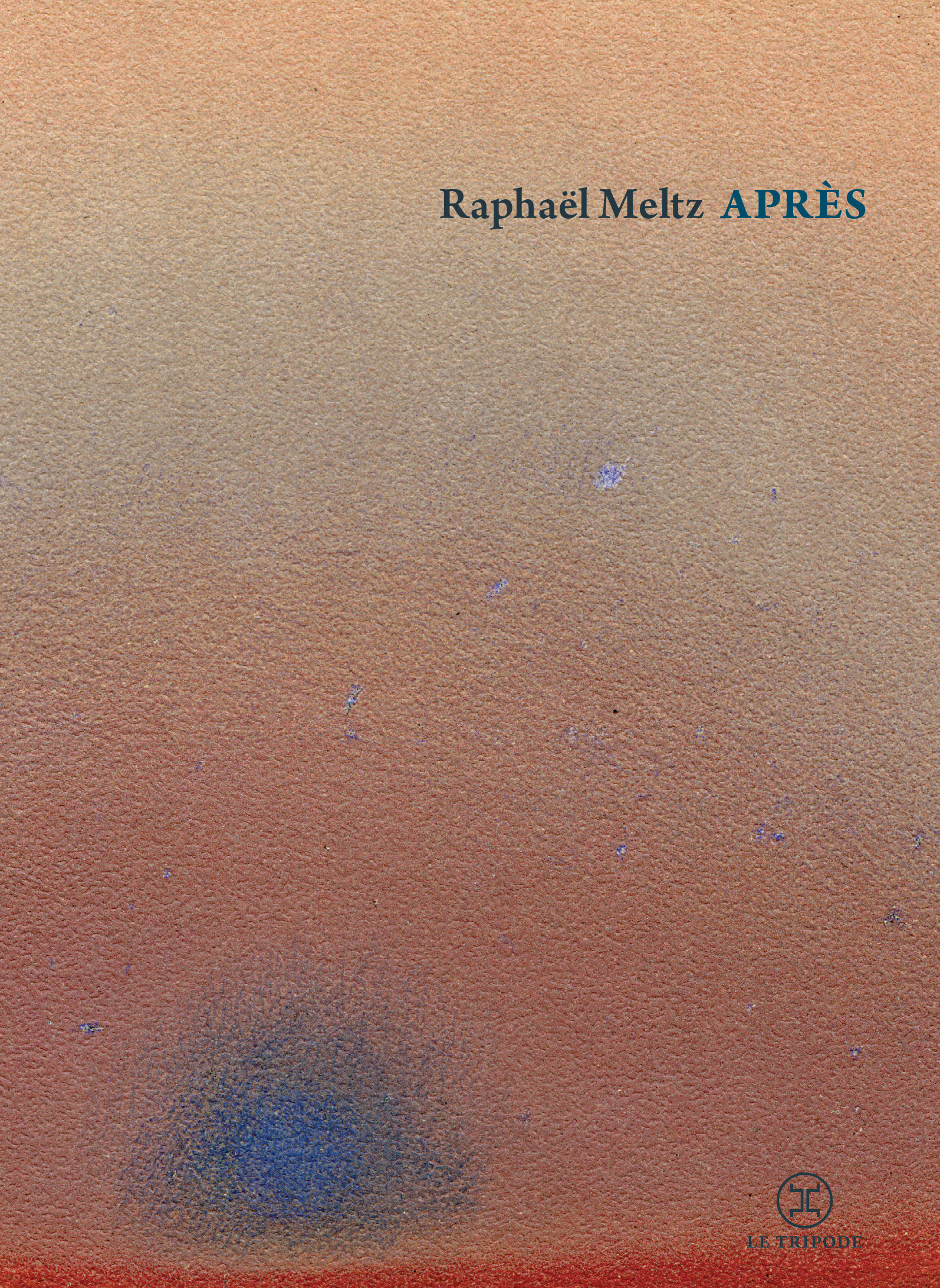
APRES
de Raphaël Meltz
Editions Le Tripode
«Lucas se dit que s’ils avaient su, tous les quatre, lui évidemment mais aussi eux trois, s’ils avaient su, avant, que leurs jours de tranquillité étaient comptés – eh bien quoi, qu’auraient-ils fait de différent ? Leur vie aurait-elle été moins normale, moins banale, moins classique ? »
De l’auteur, nous avions particulièrement aimé son précédent livre publié sous ce même nom aux éditions du Tripode, 24 fois la vérité. De quoi surmonter cette petite réserve au moment de commencer la lecture de son nouveau roman, il faut dire qu’il est énormément question de la thématique du deuil dans cette nouvelle rentrée littéraire. Mais on ne saurait le reprocher à l’auteur et l’on devrait plutôt s’intéresser à pourquoi retrouve-t-on présentement avec autant de régularité cette forme de nécessité à (re)penser la mort à travers l’écriture, à travers le fiction.
Il convient d’indiquer que la manière dont Raphaël Meltz s’empare de ce sujet est tout à fait singulière. En effet, l’auteur s’intéresse à la fabrique temporelle du deuil du point de vue de ceux qui restent (Roxanne, l’épouse, Sofia la fille, Lorenzo le fils) mais aussi de celui est qui parti (Lucas). Un accident de vélo est si vite arrivé. Mais qu’advient-il ensuite ? L’auteur organise son roman à la croisée du temps qui se déplie (minute, heure, semaine, mois, année) et des expériences, notamment sensitives, qui se réorganisent (goûter, toucher, sentir, entendre, voir, savoir). Lucas n’est plus avec eux, «il est là sans être là» mais c’est tout comme. Et c’est dans ce paradoxe que tout se joue. «Il ne peut rien. Simplement rester près d’eux ; du côté où il se trouve». Et cela donne lieu à de magnifiques descriptions de ce qu’il ressent, de ce qu’ils ressentent («le chemin de peine pour ceux qui sont restés»), en écho souvent (ne pas disposer du mode d’emploi pour faire avec cette expérience de la mort), en complémentarité parfois mais aussi en écart (la disparition brutale versus l’expérience de s’éteindre progressivement), de par l’incomparabilité de leur situation («un qui-vive au sens du souvenir de la dualité entre une âme qui vit et l’autre qui n’est plus là»). Les souvenirs et les regrets (et quelques remords) en surimpression. La tristesse qui «ne passe pas mais qui s’espace». Lucas les observe (le sourire triste et le regard éteint de Roxane,…), Lucas les accompagne à distance dans leur épreuve du deuil, comme «une autre façon de dire au revoir, (…) une façon très lente, très continue» toujours avec une infinie délicatesse, de celle qui le fait se retirer dans certaines situations quand il n’est plus à sa place.
Lucas est tout entier pris (anesthésié?) dans un bain sensoriel infini : «Comme si la superposition entre le choc à l’intersection de la rue derrière la maison et la douceur qui s’offrait à lui faisait disparaître tout ce qui fait mal». Ainsi, l’un des tours de force de l’auteur est de décrire comment du point de vue de Lucas tout prend alors plus de relief, comme une conscience aiguë de la densité de la matière, «plus de lignes, plus de détails, plus de couleurs», tout en ayant conscience que cela est amené à s’estomper petit à petit : «faire le deuil, pour lui, c’est juste se préparer à perdre leur présence – par vagues». Tout en continuant à ressentir leurs présences, il passe ainsi une année durant par différentes étapes, perdant peu à peu l’odorat, puis l’ouïe, puis la vue… Cette progressivité se matérialise aussi dans le texte par une série de «et puis» qui vient articuler le récit et trancher avec de très longs passages entrecoupés uniquement par des virgules, aussi comme pour indiquer que la vie continue son cours malgré tout, se ponctue autrement.
Un roman sensible et délicat, qui explore finement le continuum de la présence-absence, sans jamais verser dans le pathos, mais en démultipliant les points de vue, images et ressentis qui sont à la fois ceux du disparu et des vivants (qui se trouve être le titre d’une BD parue aux éditions 2024 dont Raphaël Metz est le co-scénariste).
«Tous ces mondes que Lucas ne faisait qu’effleurer et qui sont si présents maintenant».

Je te l'avais bien dit
de Candela Sierra
traduit de l’espagnol par Rachel Deville
Editions Atrabile
BD
«Nous on ne sera jamais comme ça, on est différents».
Etre ou ne pas être le mouton de Panurge…
Candela Sierra nous propose une série de petites saynètes comme un miroir qui nous serait tendu. Ces personnages semblent un brin caricaturaux, quoique… Ils se cognent tout à tour à des problèmes d’incompréhension. Ils ont besoin tantôt de faire reluire leur ego (comme devant ce magasin de miroirs où les passants-narcissiques se perdent dans leur propre image, ou comme lors d’un enterrement où l’on pique la vedette au défunt), tantôt de ne pas perdre la face quitte à jouer des rôles dans lesquels ils se fourvoient. Quand l’effort de distinction opère pour les unes, d’aucune se distingue par son chewing-gum au curry et son sachet de tofu saveur viande, l’incapacité à choisir menace pour d’autres.
L’autrice nous amène à écouter ces small talk qui s’enchainent, de «lieu commun» en «lieu commun» (avec quelques délicieuses vignettes où les protagonistes sont accablés ou ensevelis sous des blablablablabla) ou ces dates peu concluants. L’air du temps se saisit tout entier dans ces «fréquences opposées» dans lesquelles se nouent des relations impossibles.
Les personnages se trimballent d’un univers à l’autre, de l’intime au professionnel en passant par les relations amicales, toujours en étant empesés dans un rôle ou une relation dont ils ont du mal à se défaire. Songeurs, stupéfaits, abasourdis, gênés, les personnages disent leur incompréhension toujours et encore, à l’instar de cette double page de phylactères en milieu de BD, où ce sont des formes géométriques qui ont remplacé la parole, comme de nouveaux motifs possibles de dispute. Peu d’échappatoires se présentent, quand certains s’exposent à l’autoflagellation, d’autres se conforment à la pensée du plus grand nombre, quitte à foncer tête baissée, pareille à une meute. Quand certains peinent à voir (le flou rendu par la myopie ou les problèmes soigneusement mis sous le tapis) d’autres ne parviennent pas à terminer leur phrase. L’écoute se fait biaisée («j’ai l’impression que chaque fois que je te raconte quelque chose d’important et de positif, tu fais l’impossible pour le rendre négatif et lui enlever de l’importance») ou en diagonale, les ruptures par ellipse. Comme une communication impossible ou empêchée, même avec soi, «Je pense si peu dernièrement (…) que quand je me parle à moi-même, je ne sais plus quoi dire».
Une BD rondement menée qu’on lit avec plaisir et qui invite aussi, avec le rictus sardonique qui va bien, à se moquer de soi.
«Quand tu es en groupe, tu laisses la raison de côté, tu te métamorphoses et vraiment tu peux faire peur».
- All
- Gallery Item
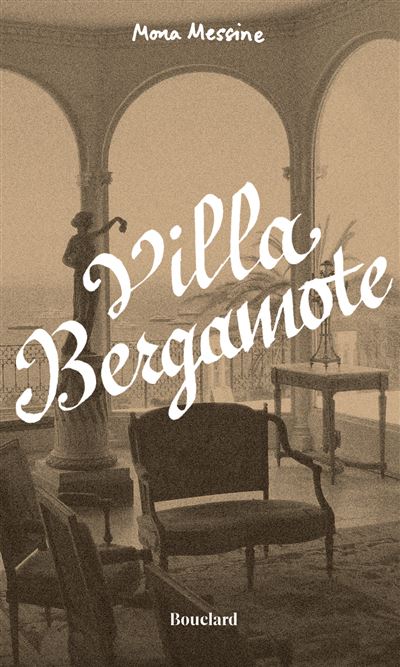
Villa Bergamote
de Mona Messine
Editions Bouclard
«J’avais toujours rêvé d’habiter quelque part une forme d’abri. Et lorsque je fermais les yeux, j’entendis à Bergamote le bruit d’un vent que je ne voulais plus quitter».
On pourrait croire à une mise en récit d’un essai du couple Pinçon-Charlot, ou à une exofiction autour de la vie des Balkany. Il y a un peu de cela dans le nouveau roman, son second, de Mona Messine. On n’est pas loin non plus de L’invitée d’Emma Cline, une percée dans le monde des ultra-riches à travers le regard non pas d’Alex mais de Roxane, issue d’un tout autre milieu et qui s’emploie à donner le change («j’ai décidé d’investir mon temps pour que l’histoire fonctionne») pour se faire adopter par cette famille et ce faisant, grimper dans l’ascenseur social. Et de toute évidence ça marche bien, puisque le mariage avec le fils de Monsieur et Madame (en majuscule s’il vous plait) est scellé et la Villa Bergamote qui trône sur les hauteurs d’un île des Antilles lui est promise. Roxane n’aime rien tant que cette villa de luxe («Bergamote m’a conquise en une seule respiration»), et puis elle a un tel besoin de disposer d’un endroit à elle chevillé au corps. Alors ici, c’est mieux encore, elle peut profiter de ce décor si faste, s’aventurer dans le jardin, profiter de la piscine, se perdre dans les différentes pièces. Mais peut-être ce lieu agit pour elle comme une prison dorée, ainsi les références à la mer, tout à côté ou presque, mais qu’elle ne parvient jamais à approcher tout à fait. Elle va d’étonnement en étonnement : surprise de la vie sociale, version comédie et manigance, qui s’organise à la nuit tombée. Fascinée par cette atmosphère qui fait et défait les réputations, les alliances par ces coulisses où se fabriquent les destins et qui prolongent ce décor faste.
Mais à défaut de connaître tous les recoins de la propriété, qu’est-ce donc ce bureau qui recèle un magnum .357, elle a plus rapidement fait le tour des propriétaires. Le vernis s’écaille, la peinture de Bergamote s’effrite («au fur et à mesure des années, je me mettais à voir la poussière et les fissures de leur échafaudage»). Investis dans la politique, le couple est pris dans des affaires, des sales affaires, blanchiment de fraudes fiscales, malversations, malgré tout l’arsenal déployé pour esquiver, maquiller. Les casseroles finissent par faire tout un tintamarre, mais rien y fait : «C’était comme si chaque accusation pouvait leur faire gagner de l’argent en plus, au moins pour diffamation, et surtout du lustre (…) A cette époque-là, le tollé fut équivalent à si l’on avait traité le présentateur du JT le plus influent de France de gros dégueulasse. On aimait le monde qui continuait. On avait peur de la rupture. C’était la force des habitudes». «Super-déni» et outrance à gogo pour (faire) oublier la corruption, passer à autre chose.
Roxanne finit par réaliser que si elle a fait en sorte d’être «pétrissable» («laisser les mots des autres faire de moi quelque chose») pour s’adapter, s’incruster, elle reste un élément de décoration, plus proche du petit personnel, et au final pas si différemment traitée qu’Alain le carlin, toujours à distance des conciliabules, des lieux où se forment les décisions. Mais elle n’est pas dupe, elle voit bien les supercheries, ici les dépôts qui s’organisent dans le garage, là l’évocation d’un conteneur. Elle ne supporte plus leur trop-plein de barbaque, la mascarade romantique a assez duré.
Dès le premier faux-pas, sa détestation finit par se voir : «je suis la traîtresse, je suis le «mais», la maîtresse, aujourd’hui le contremaître et picador». Dès lors elle prépare sa sortie, «Ce matin, j’avais choisi de boutonner lundi avec mardi sur mon chemisier. J’allais précipiter leur chute sans qu’ils s’en aperçoivent» mais c’est sans compter sur les représailles qui coagulent.
Mona Messine excelle dans le maniement des codes de la satire, de la quasi tragicomédie avec des formules qui fouettent, avec cette galerie de personnages tout à fait crédibles dans leurs agissements, et cette narratrice, détachée sans l’être, qui s’en sort à merveille dans son entreprise de démystification.
«Assez belle pour approcher le luxe de quelques soirées, trop pauvre pour arriver première sur la liste. Toute l’histoire, elle ne tient qu’à ça»

Une danse pour les doigts humains
de David Lespiau
Editions Héros Limite
«à l’intérieur
aiguilles et dés à coudre
mécanique du clavier des mains
reprise par des prothèses, des agrafes
mentale»
David Lespiau projette 112 éclats poétiques où il poétise des variations autour des doigts, des sons, des temps et des images qui s’y rattachent. Ces fragments articulés dessinent une «ligne de signes», «une ligne continue sonore labyrinthique», «une forme auto-ondulatoire en boucle», entre danse et silence, «entre deux mouvements». Les phalanges sont orchestrées, ou «tatouées de lettres». Passage en revue, dans un «temps détramé», de l’anatomie de la main, «mains de chirurgien ou de pianiste», des bouts d’ongle à la paume en passant par l’index. Ça impulse, ça compose, ça transpose, ça pianote, ça remue, ça compte, ça forme «une partition pour mots muets». Ça travaille l’écriture «au rythme tactile». Partition chorégraphiée et digitée. Langage tout en geste, entre les lettres, entre les notes. Les mots comme des doigts, qui flottent, qui martèlent, avec «un léger différé» sur le clavier. La petite musique du télétravail.
La forme de ces variations se déplie et s’agrège au gré d’observations, de descriptions, d’assertions, d’expressions telle «une phrase en train de se faire». Un jeu poétique tout en doigté.
«à tout moment sans les voir
pris dans le bourdonnement
séparer rythmes, tons, durées
les regarder tomber
entre eux»
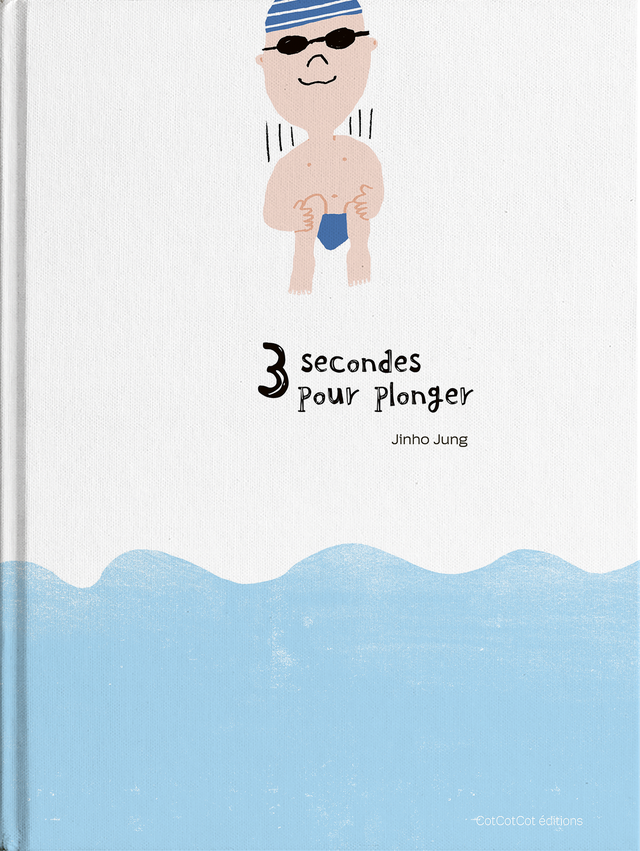
3 secondes pour plonger
De Jinho Jung
Chez Cotcotcot Editions
Album jeunesse
« Tout le monde dit que je suis un peu mou. »
Qu’il en faut du courage pour plonger de ce plongeoir qui parait si haut ! Et pour commencer, il faut avoir le courage de monter les innombrables marches qui forment, vues d’en bas, un labyrinthe interminable. C’est le temps qu’il faut au jeune garçon que nous suivons tout au long de l’album pour recenser tout ce qu’il n’arrive pas à faire assez bien (« je ne suis bon à rien ») : manger rapidement, résoudre des calculs, jouer au baseball, battre ses adversaires au Taekwondo. Pas dit qu’il est beaucoup confiance en lui… Aura-t-il le courage de sauter ?
Mais au milieu de cette ascension, les choses se renversent. Il ne semble plus subir la situation. Au contraire, il nous explique sa philosophie de vie : « moi, gagner, ça ne m’intéresse pas. Parce qu’alors quelqu’un doit perdre. » Là, la vue est vertigineuse, on croirait tomber dans un puit sans fonds. Ce qu’il aime, c’est être avec ses amis et s’amuser à plonger. Et il y arrive très bien ! Son sourire à la fin est communicatif. Pas la peine d’être le meilleur, d’être fort, d’être rapide. Il suffit de trouver ce qui nous plait vraiment pour s’épanouir comme lui. Pas mal comme idée !
Texte (concis) et illustrations (stylo, tampon et ordinateur) se marient et se complètent parfaitement, donnant de la hauteur et de la profondeur. D’une grande efficacité. On aime aussi tout particulièrement les expressions des visages (jetez un œil aux sourcils… Ils jouent beaucoup dans la transmission des émotions).
C’est le 4ème album coréen de Cotcotcot Editions, et le 2ème que nous présentons après Le crayon de Hye-Eun Kim (qu’on aimait notamment pour la richesse des détails des illustrations). Cela nous laisse à penser qu’il faut suivre et Cotcotcot (pour ceux qui nous suivent ce n’est pas tout à fait un scoop tant on affectionne cette maison d’édition) et la littérature jeunesse coréenne !
Allez… 3, 2, 1… Lisez
« … je suis juste venu pour plonger. »
Votre libraire vous partage chaque semaine ses conseils de lecture et coups de cœur. Face à l’ immensité de choix qui s’offre à vous, constituez votre P.A.L et trouvez votre prochain livre de chevet ou une idée de cadeau. Nous pensons également à toute la famille avec nos recommandations spéciales jeunesse.
- All
- Gallery Item

La longe
de Sarah Jollien-Fardel
Editions Sabine Wespieser
«Nos vies s’imbriquent naturellement, nous mélangeons nos amitiés, nos familles, nos goûts. Notre relation ne s’encalminera jamais, elle avancera, solide et viscérale».
A ce stade, c’est sans conteste mon premier véritable coup de cœur de cette rentrée littéraire hivernale. On le sait, il n’est jamais évident de réussir un second roman, d’autant plus quand le premier (Sa préférée) a été multi-récompensé. C’est chose faite avec La longe où l’on retrouve tous les ingrédients de ce qu’on aime, une dimension romanesque consolidée, des personnages fouillés et multiples dans leur composante, une histoire d’amour qui s’écrit dans toutes les nuances, des lieux où s’ancrent l’histoire merveilleusement bien décrits, un dispositif narratif savamment maîtrisé, «la bande-son» soignée.
On suit Rose, née dans le Valais, devenue ostéopathe, mariée à Camil, un gars du coin, architecte renommé, et mère d’une petite Anna. Rose qui cultive une relation de grande proximité avec ses grands-mères, Eugénie et Lucie, un drôle de duo d’«arrières». Sauf qu’un jour la Rose, «combattive conciliante» va petit à petit s’éteindre, ne parvenant pas ou plus à faire face à un terrible événement qui est venu par effraction dans leur vie : Anna va être fauchée par une camionnette. L’horreur. «Comment dire la désolation des désolations, l’absence comme cratère». A en devenir folle comme sa propre mère qui avait «des bêtes» qui grignotaient sa tête, à ne plus pouvoir se calmer. «Je suis attachée à une longe, sans colère, absente à tout». «Rien, rien n’apaise mon chagrin qui, comme mon corps, enfle jusqu’à me faire mal aux côtes, jusqu’à m’étouffer». Hystérie, mutisme, autodestruction. Redoublement des doses de molécules.
Après un épisode d’hospitalisation, Rose va vivre plusieurs mois durant dans un mayen au cœur de la montagne, à l’abri du bruit du monde mais à l’écoute de la forêt et avec des «pensées tentaculaires» qui l’engloutissent. On va la suivre sur ce chemin escarpé du deuil.
Sarah Jollien-Fardel sonde subtilement l’état de Rose, décrit aussi les prémices de la maladie («avant que je m’enténèbre»), l’inconfort avec lequel Rose était devenu mère, tout ce qui pourrait être constitutif d’une forme de fragilité mais aussi «tout le terreau» de la résilience «entretenu par une vie de lectures et de bonté». En outre, l’autrice décrit avec une grande justesse la position intenable, tenant lieu de l’engravement (en référence au titre d’Eva Kavian paru aux éditions de la Contre-Allée, cette position comme échouée, égarée des aidants) dans laquelle est plongé Camil, celui qui donne du mou ou resserre la longe de son épouse, qui condamne les portes, qui fait prendre le traitement. Avec une situation amoureuse quasi impossible mais qui tient.
Et puis une rédemption souterraine travaille, s’esquisse à partir d’une voix, la voix d’Hélène qui se faufile à travers la porte, des lectures qui se font jour, «l’écho des émotions qui persiste après la lecture» ; «jusqu’à oublier, durant le temps de la lecture, le reste. Tout le reste». Jusqu’à redevenir une fille-oiseau (référence à «Bird Gerhl», I Am A Bird Now d’Anthony and the Johnsons).
Tout à fait for-mi-dable !
«Je m’assieds en ouvrant mes bras, il écarte les siens, nous pleurons d’autres larmes, moins douloureuses, plus amples. Elles nous rapiècent le cœur, elles nous pardonnent l’un à l’autre».

Estime de soi et fin du monde
de Luke Healy, traduit de l’anglais (Irlande) par Géraldine Chognard
Editions Cambourakis
BD
«Vous n’êtes pas fou, vous n’êtes pas un monstre, vous avez juste une petite tendance narcissique».
Luke, le personnage principal de cette BD, a clairement le visage de son auteur, Luke Healy. Mêmes traits, même prénom, même nom. Une autofiction donc ? Ce qui est sûr, c’est que ce roman graphique se présente comme une sorte de journal intime écrit à la troisième personne. Cela tombe bien, c’est justement ce que la psy de Luke lui conseille de faire pour lutter contre le stress et rebooster son estime de soi («Chaque soir, je veux que vous écriviez quelques phrases sur vous. Mais faites-le à la troisième personne : «Luke Healy est…» Soyez objectif.»)
Il est question de deuil, de regrets, de difficulté à vivre tel qu’on est, du jugement d’autrui et de la difficulté de s’en détacher. Luke est stressé, angoissé même, a une piètre image de lui. Il voit une psy qui lui donne des exercices à faire, il s’achète des livres de développement personnel, et écoute en boucle un podcast sur l’estime de soi et les voies du bien-être, persuadé, ou s’auto-persuadant d’échafauder ainsi un «plan d’auto-amélioration optimal». Il s’emploie à faire des travaux pratiques pour aller mieux, de ceux qui se revendiquent des concepts du développement personnel que Liv Stromquist s’évertue à dénoncer un à un dans sa dernière BD, La pythie vous parle.
Luke a un frère jumeau, un jumeau vis-à-vis duquel il s’infériorise en permanence, et c’est justement son frère qui prête sa voix à ce podcast de «Serenit’App». Un double, celui qu’il aurait pu être, voulu être… C’est un peu comme si son frère en personne tentait de le coacher. Plus troublant encore, ils ont la même voix, il pourrait donc avoir l’impression qu’une petite voix intérieure lui donne des conseils.
On rencontre aussi sa mère, avec qui il partage «un drôle de sens de l’humour» («On est les personnes les plus drôles de la terre, je te rappelle.»). Elle tente de lui rappeler qui il est vraiment quand il se perd un peu ou se dévalorise à l’excès.
Et puis il y a toute une galerie de personnages, juste à côté : le fiancé de son frère et son témoin, une rencontre d’un soir, deux nageurs, une archéologue, deux officiers de police, différents collègues de différentes entreprises pour lesquelles il travaille, un couple au bord du divorce, …
On croise aussi deux souris qui ne veulent que son bien et deux oiseaux (et même une baleine synthétique) qui amènent le lecteur à regarder différemment la situation qui est en train de se dérouler.
Luke tente inlassablement de reprendre le contrôle de sa vie, de se «débloquer» mais n’y parvient jamais tout à fait, se faisant déborder par les situations, pendant que le monde continue à changer et se dérégler, à l’image des tempêtes présentes à plusieurs reprises, noyant notamment Los Angeles.
Une BD inventive au niveau de la forme, à l’instar des cases, avec des vignettes encadrées et d’autres non, et avec une variation infinie de ces jeux selon les planches. Inventive aussi lorsque Luke est aux prises à des formes d’introspection.
Une BD qui vient interroger comment s’exerce le conditionnement social et les nouvelles formes de contrôle, à l’instar du coussin connecté qu’il balade avec lui en vacances pour faire croire à son employeur qu’il travaille. Luke apparaît comme un être préoccupé, avec une conscience aiguë des bouleversements de notre époque, bien en peine de trouver la place qui est la sienne pour ne pas être submergé, trop égoïste ou rester sans rien faire dans cette affaire.
«J’ai passé chaque jour de ma vie à m’inquiéter pour l’avenir. A angoisser face aux catastrophes annoncées. A m’efforcer de faire advenir des choses positives. A bosser tout le temps. Tout ça pour quoi ?»

Je me regarderai dans les yeux
de Rim Battal
Editions Bayard, collection littérature Intérieure
«J’eus le sentiment que mon visage s’était arrêté pour toujours dans cette expression de douleur, crispé dans une adolescence infinie où je devrais toujours me cacher pour avoir le moindre geste, le moindre projet, qui s’écarterait même le plus légèrement des convictions des autres».
La collection de Bayard «Littérature intérieure» veut se «concentrer sur ces mouvements intimes [douleurs, joies, éblouissements et inquiétudes] qui donnent forme à nos paysages singuliers et sens à notre existence commune». Nous sommes en plein dans ces mouvements et paysages-là dont témoigne Rim Battal à travers son personnage principal qui n’a pour seul tort d’avoir fumé une cigarette à la fenêtre de sa chambre. On a beau ne pas être sérieux quand on a 17 ans, cette chose-là ne se fait pas. Et à Marrakech, ça se fait encore moins. Cette transgression déclenche le courroux de la mère qui dans la foulée subtilise et commente au Bic rouge le journal intime de sa fille et occasionne sa fugue. Un moment de bascule advient : «peut-être étais-je, sans m’en douter, en train de quitter définitivement l’enfance, de lui faire mes adieux». Cette dernière trouve refuge chez sa tante Aida à Casablanca, fidèle alliée, mais il s’avère que cette dernière relaie l’exigence familiale («Je pensais sa confiance totale, à toute épreuve. Et la voilà qui doute de moi. La voilà qui rejoint le camp des soupçonneux qui farfouillent dans ma blessure, tirent sur l’élastique de ma culotte pour voir ce qui se passe en dessous»). Le retour au domicile ne pourra se faire que si la jeune fournit un certificat de virginité. Elle abdique finalement et fait l’objet de ce que l’autrice désigne comme relevant d’ «un viol institutionnel», «cette violence collective admise comme une célébration de la puberté». «Mon sexe avait été ouvert sans désir et sans consentement, sur ordre et avec la connivence de toutes celles et ceux qui étaient supposés me protéger de ceux qui tenteraient d’ouvrir mon sexe sans amour, de le toucher sans mon consentement».
Rim Battal rend compte de la manière dont le primat de la tradition et les codes d’honneur opèrent et infusent, comment l’injonction «vivons cachés, vivons heureux» s’organise au quotidien, à bonne distance du regard du voisin, comment le père de la personnage principale lui a appris à faire preuve de «diplomatie», «l’art du mensonge et du louvoiement» et comment la survie passe par l’utilisation d’un double discours et d’une codification du langage parlé («Nos moutons, nous les appelions aussi les champignons, c’était notre code pour parler de garçons sans être grillées par nos parents» ; son pseudo sur MSN, «Queen of the damned»). L’autrice resitue les violences intrafamiliales qu’elle a dénoncées pas à pas, d’où elles procèdent et les mécanismes de déni pour qu’elles se perpétuent : «la violence de ma mère est le résultat d’une violence plus grande qu’elle ignore avec application, qu’elle n’est pas prête à regarder en face de peur de s’écrouler, de couler à jamais». Elle réinscrit (et ce faisant d’une certaine manière réhabilite) sa mère comme étant aussi celle qui la protége ; «Soudain, je réalise le grand barrage qu’a été ma mère. Je vois ses bras ouverts, pleins de mythes et de mensonges, de combines et de tensions, pour nous protéger contre toutes les formes de violence».
La seconde partie du récit traite de l’empouvoirement de la personnage principale («j’ai su que, désormais, je construirai mon éthique moi-même, selon mes propres critères dès lors que j’ «aurais les moyens de mon autonomie» ; «j’ai perdu cette virginité du regard, j’ai les outils, j’ai un peu de savoir et de théorie 5… les mots et les concepts sont mes armes et mon armure») qui réussit à organiser, comme un retournement, une exposition adoubée par le roi du Maroc dont l’une des œuvres est un drap maculé d’une tache de sang.
Ce livre n’est pas sans nous faire penser, dans les dérives qu’il dénonce, Aux ventres des femmes, roman de Huriya (éd. Rue de l’Echiquier). Il parvient à faire passer le lecteur par une sorte de grand huit émotionnel, alternant les moments où il s’identifie avec force à la narratrice, passant de moments de révolte, de dénonciation, à des moments plus ironiques, attendrissants ou réconfortants. C’est notamment dans ce continuum d’émotions contradictoires qui accompagnent le récit des premières fois que réside la force de cette écriture.
«J’ai compris qu’un tabou pourrait être ainsi défini : zone d’ombre morale qui bénéficie à une injustice».
- All
- Gallery Item

De nos blessures un royaume
de Gaëlle Josse
Editions Buchet Chastel
«J’avais cherché mes mots, jusqu’à trouver ceux qui iraient peut-être jusqu’à toi. Entre ton monde et le nôtre, c’est ce petit pont fragile que je tente de faire tenir à chaque instant».
Encore un titre dont Gaëlle Josse a le secret, un condensé de son écriture si juste, si ciselée. De nos blessures un royaume (en allant vers ce nouveau livre on garde en tête d’autres titres comme Les heures silencieuses ; Nos vies désaccordées ; Et recoudre le soleil ; A quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ?). On retrouve là parfaitement encapsulé toute la trajectoire de vie que ce roman suggère, un je-ne-sais-quoi qui relie et prolonge aussi les titres précédemment égrenés (ainsi ce passage «les images qui attendent la nuit pour surgir» ou encore «La lumière du plein jour a effacé les ombres nocturnes»).
On suit Agnès, la narratrice, danseuse professionnelle, qui a monté sa propre salle de danse et fait des spectacles en parallèle. Ce qu’on sait très vite, c’est qu’elle a perdu, il y a déjà un an de cela, son amoureux, Guillaume. Cela précipite son départ. Seule avec son petit sac à dos, en bus, et en essayant de ne pas se cogner. Comme pour «repousser la fatalité, dompter la pesanteur».
C’est dans cette itinérance de 1000 kilomètres («avec des détours et des étapes [Mantoue, Crémone, Trieste, Zagreb], des hésitations, des repentirs, des visages, des rencontres ou des possibilités de rencontres»), ce « dépli » (pour dire qu’il ne s’agit pas d’un repli et pour dire le besoin de son corps de se déplier autrement qu’en dansant, «remettre en route la machinerie du corps» ; «Pas question de rester là, encalminée, de demeurer le jouet d’une adversité qui se moque de moi») vers différents lieux que s’établissent les coordonnées de la recherche d’Agnès.
Le seul « compagnon » de traversée d’Agnès est un livre qui était vénéré par Guillaume, Quelques Eden, lettres à ma fille de Julien Lancelle. La narration organise un va-et-vient entre des extraits de ce livre, la vie de ses personnages (Julien, Madeleine, Emma), la vie qui a été la leur avec Guillaume et le compte-rendu du voyage qu’Agnès nous relate. «La mémoire est enfer et refuge, dans ses frontières poreuses et imprévisibles avec le réel» et avec l’imaginaire, aurait-on envie de rajouter en lien avec cette référence permanente au livre inventé de Lancelle.
Si cette mise en abime permet à ce que Guillaume, jardinier hors pair, puisse se superposer à Julien, l’infatigable observateur de la nature, le périple permet, quant à lui, à Agnès de parler de Guillaume sans en avoir l’air, de l’emmêler à cette triade, comme «un écho de nos jours passés», et de se poser la question : «Qui écrit l’histoire commune, en fin de compte ?».
Et c’est au Museum of broken relationships de Zagreb qu’Agnès recherche une consolation, une destination pour déposer ce livre. Mais si le pèlerinage ultime n’aboutit pas, le temps et l’espace du deuil se métamorphosent, la quête de soi se prolonge car «le monde est en mouvement et elle aussi».
L’Esperluette recevra Gaëlle Josse le 16 mai, ça vous laisse donc 4 mois pour lire et relire ce roman très réussi.
«Il faudrait savoir garder à distance les souvenirs, les considérer comme des étoiles, lumineuses, lointaines, mais ça ne marche pas comme ça».
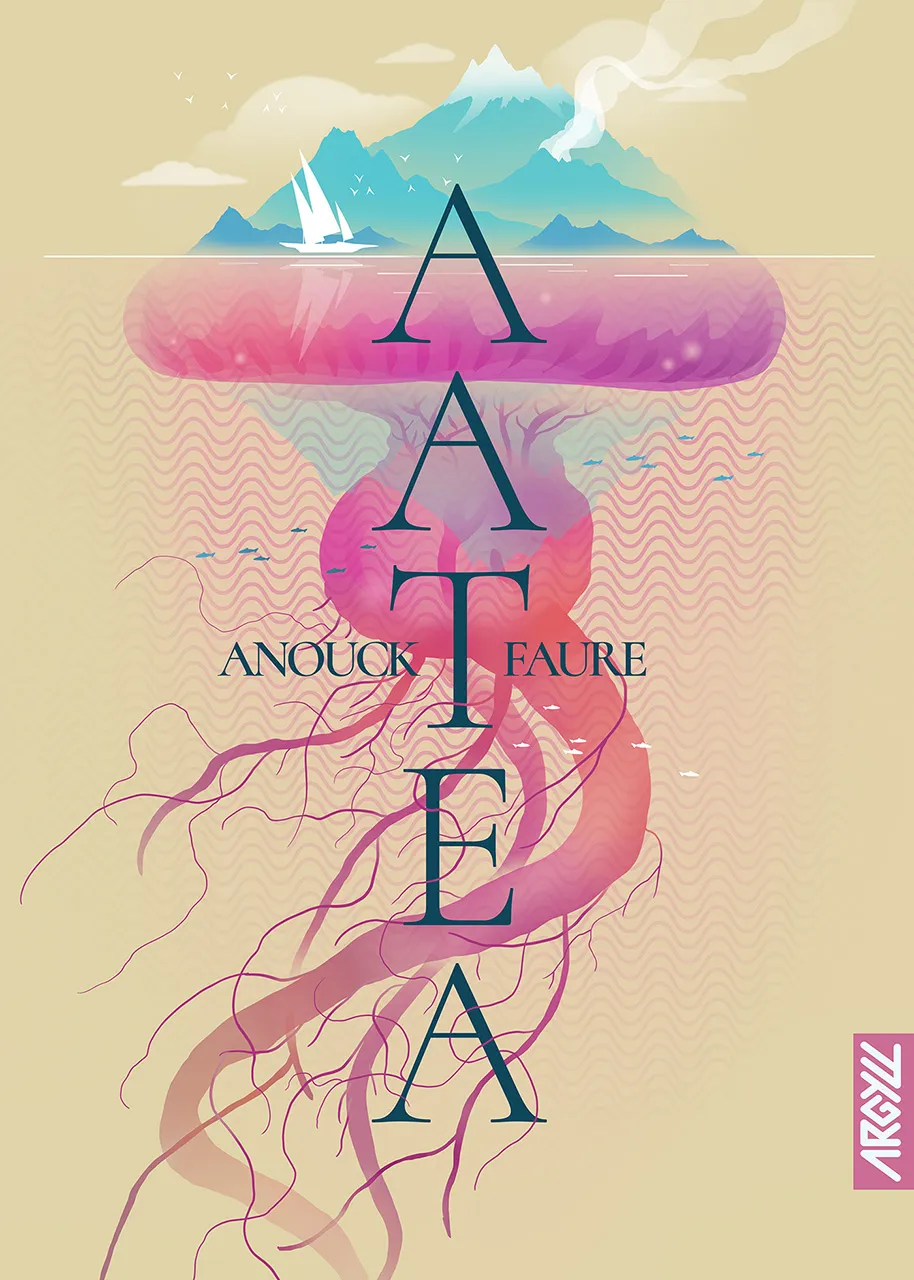
Aatea
d’Anouk Faure
Editions Argyll
«Tant qu’il a les récits d’Atura, tant qu’il a un navire, le silence, l’écrin de la Nuée autour de lui…»
On avait apprécié son univers un brin gothique et torturé qui s’exprimait dans la noirceur de la couverture de La maison biscornue de Gwen Guilyn aux éditions du Panseur. Cette fois-ci elle développe son imaginaire aussi bien par l’écrit que le dessin. Elle crée de toutes pièces un univers entre mers qui se superposent, îles vivantes et roches. La couverture (seule illustration de Xavier Colette, toutes les autres étant de l’autrice) nous laisse percevoir un monde qui pourrait, en surface, être semblable au nôtre. Mais sous l’eau, l’île semble se transformer en méduse et ses racines ne finissent pas de s’enfoncer dans les profondeurs, créant l’envie de les suivre pour découvrir des espaces peut-être encore inexplorés. A la lecture du roman, nous découvrons, par des descriptions jamais trop longues et toujours mêlées aux actions, les méandres de la Nuée (ces bras de mers qui se jettent les uns dans les autres). Et pour étoffer notre cartographie imaginaire, Anouk Faure use de son talent d’illustratrice et distille ça et là des dessins à l’encre de chine qu’elle peuple d’êtres marins, d’insulaires et autres peuples.
Si nous découvrons que les îles sont liées entre elles par ces racines, nous comprenons aussi rapidement que les humains, pour une partie d’entre eux – les insulaires, sont liés à elles par un filament au creux de leur nuque. Et seuls les personnes porteuses de ce filament peuvent fouler le sol et toucher les racines des îles sans être intoxiqués mortellement. Aatea, le personnage principal, n’en fait pas partie. Né trop tôt sur un bateau, sa mère, Kanume – grande exploratrice à la recherche d’une nouvelle île, n’a pu lui donner accès au filament de l’île Enatak assez rapidement. C’est donc en navigateur qu’il trouvera sa place (comme sa grand-tante Atura). Et c’est seul et dans la Nuée qu’il se sent le plus libre. C’est là qu’il entre en connexion avec les éléments qui l’entourent, qu’il « onçoit » (cette faculté si particulière qu’ont les navigateurs de (re)sentir les éléments, entendre les moindres bruits, percevoir toutes les vibrations du monde). Nous le suivons dans une sorte d’Odyssée où rencontres, épreuves, et découvertes se succèdent. Il fuit de tout son être les rapports de domination, cherche à aider les plus démunis, se lie à une petite fille nomade, tel un père d’adoption.
Un roman qui sent les embruns et cultive un univers à part entière qui stimule notre imaginaire.
«Il onçoit. L’une des premières règles de navigation consiste à ne pas sauter dans un nouveau danger en essayant d’en fuir un premier. Il laisse les vibrations tisser pour lui une cartographie mentale de ses environs élargis.»
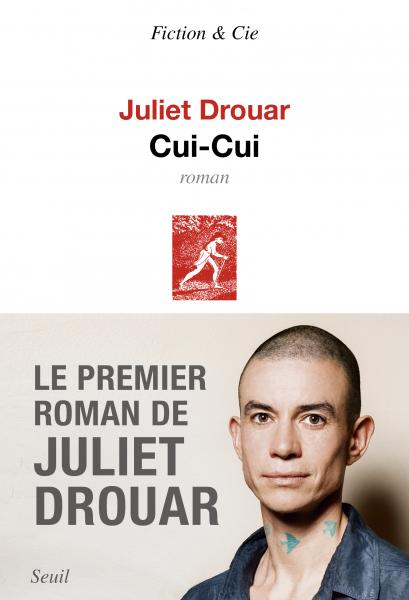
Cui-Cui
de Juliet Drouar
Editions du Seuil
«Je traverse la vie dans une sorte d’acouphène permanent, une sorte de brouillard entre elle et moi».
Juliet Drouar est connu comme étant l’auteur d’essais remarqués, comme Sortir de l’hétérosexualité ou La Culture de l’inceste, qu’il a codirigé avec Iris Brey. Cui-Cui est son premier roman qui prend place sur un terrain qui a tout à voir avec les recherches (sur les violences sexuelles et dominations d’âge notamment) qu’il mène par ailleurs, et l’on y retrouve trace dans l’écriture de l’exigence de l’universitaire de bien citer ses sources, venons-en donc à cette fiction avec des notes de bas de page.
On suit, dans une France de 2027, Cui-Cui, un ado de 13 ans (il se pense au masculin mais son entourage ou au collège on lui prête un genre féminin), victime d’abus de la part de son père et qui à partir de là, cet endroit dont l’auteur ne parle qu’à partir de descriptions plus ou moins elliptiques (le bruit des pas de son père lorsqu’il se rapproche, le refuge qu’il trouve dans la salle de bain, seule pièce qu’il peut fermer à clef), est bousculé de toutes parts. Tout en douleur, le corps qui s’anesthésie, le coton dans les jambes, les sanglots de stress. «J’ai tous les membres qui claquent comme un squelette mexicain» ; «Il faudrait que je boive en continu pour ressentir quelque chose de l’extérieur et pas être entraîné par le fond».
En même temps que la violence l’enferme de manière insoutenable, à l’instar de ces démangeaisons insoutenables liées à ses crises d’eczéma ou aux automutilations qu’il s’inflige en se cognant la tête, il découvre des militants enthousiastes dans la défense de causes avec lesquelles il apprend à se familiariser, à l’instar des droits des mineurs (contre la domination adulte, et qui politise l’action de fuguer). Son repli, son malaise se ressentent au point qu’une prof, Mme Gisèle, volontariste mais démunie, se trouve investie elle aussi d’une cause qu’elle fait sienne, protéger coûte que coûte Cui-Cui. Ce volet n’est pas sans nous faire penser au livre Les loyautés de Delphine De Vigan dans la décomposition des dilemmes moraux que peut générer le fait de signaler la situation, dans les maladresses relationnelles que ça peut susciter, sur la relative méconnaissance du champ de la protection de l’enfance (comment s’y prendre, comment ne pas surinterpréter une parole recueillie, qui interpeller ?). Même s’il est résolu à partir, Cui-Cui ne sait plus trop bien dans quel espace protecteur s’abriter, celui formé par le quatuor avec Leïla, Aude et Alexandra semble ne pas suffire, faire confiance alors à l’institution scolaire et à sa gardienne Mme Gisèle ou rejoindre le collectif autogéré ?
Juliet Drouar dote magnifiquement son personnage principal d’une rébellion chevillée au corps («le poulpe géant enragé tapi dans les fonds marins»), sujet à la porosité des sentiments, l’ambiguïté des relations dont celle avec Leïla, le tout au diapason avec ce « trouble dans le genre« qu’incarne Cui-Cui.
Ce qui fait la force de ce livre tient aussi à sa langue, qui recourt ici à l’argot, là à des anglicismes, ou encore à des références cinématographiques choisies (La vie d’Adèle), ainsi qu’à une écriture nécessairement inclusive. A cette façon aussi dont le narratif ne s’épuise pas dans le réel des situations décrites, en laissant toute la place aux non-dits, encore une fois, au trouble et partant à des espaces ouverts, où le lecteur peut s’engouffrer, prolonger à sa façon ce qui n’est pas écrit.
Bouleversant mais à ne pas glisser entre les mains de celles et ceux qui se définiraient comme anti-woke, sous peine d’irruption eczémateuse subite et contagieuse.
«J’aimerais avoir une hache dans ma chambre d’enfant. Peut-être qu’à Joué Club il devrait y avoir un rayon haches».
- All
- Gallery Item
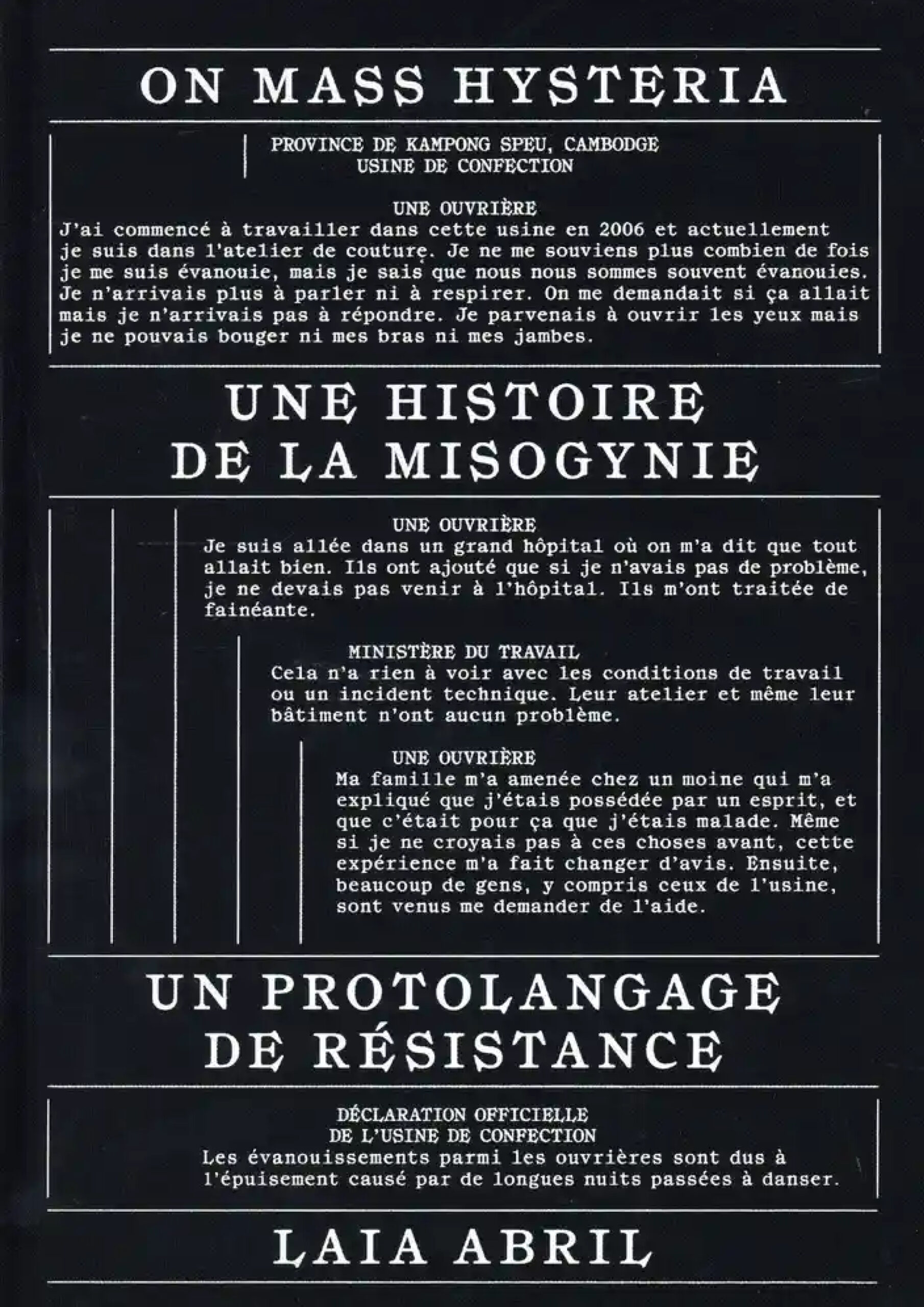
On mass hysteria ; Une histoire de la misogynie; Un protolangage de résistance
de Laia Abril
Editions Delpire & Co et Libella
« J’ai fait un rêve lorsque je suis tombée malade. J’ai rêvé d’un grand nombre de roses rouges avec au centre une rose blanche très lumineuse. »
Laia Abril est une artiste plasticienne, écrivaine et photographe née en 1986 à Barcelone. Elle vit et travaille à Barcelone. Sa pratique artistique est fondée à partir de recherches qu’elle déploie sous forme d’images et de textes afin de mettre en lumière une pluralité de récits concernant les conditions systémiques d’oppression des femmes. Grâce aux archives qu’elle donne à voir et aux nombreuses interviews qu’elle rédige, Laia Abril nous donne accès à des phénomènes sociologiques malheureusement invisibilisés ou traités injustement. Ses recherches au long cours sont organisées par chapitres tels que On Sexuality (Lobismuller, Femme love), On Eating Disorders (On Diet Culture, The Epilogue,Thinspiration), An History Of Misoginy (Chapter Two: On Rape, Chapter One: On Abortion, Genesis Chapter: On Mass Hysteria, Menstruation Myths, Feminicides) et donnent lieu à des expositions et/ou des publications. Son travail est d’envergure internationale et a notamment été exposé aux rencontres de la photographie d’Arles en 2016 (On Abortion), à la biennale de l’image de Liège en 2020 (On Rape) et prochainement au BAL à Paris du 17 janvier au 18 mai 2025 pour son travail déployé dans le livre On mass hysteria ; une histoire de la misogynie ; la genèse qui traite de l’oppression politique et sociale des femmes dans la manifestation de maladies collectives, qui a longtemps été appelée « ‘hystérie collective ». À propos de ce terme, Laia Abril déclare « Il est évident que nous avons un lien très fort avec le mot hystérie et la manière dont il a été utilisé au cours de l’histoire pour contrôler les femmes et pour minimiser leurs souffrances ».
Sa recherche s’articule autour de trois études de cas : une épidémie de paralysie des jambes dans un pensionnat catholique pour jeunes filles à Chalco au Mexique en 2007, une épidémie d’évanouissements chez des ouvrières dans des usines de confection au Cambodge depuis 2012 et une épidémie de tics dans un lycée de la Ville de Le Roy dans l’Etat de New York en 2012. Pour chacun de ces cas, Laia Abril propose une pluralité de lectures possibles ; des archives de journaux, des captures d’écrans de vidéos, des retranscriptions d’enregistrements des victimes et des autorités, ainsi que des interviews avec des chercheurs ou chercheuses en médecine, anthropologie et sociologie. Ce corpus nous fait passer d’un point de vue à un autre, de réalités individuelles au déni collectif, d’images aux textes puis aux articles. Cette forme plurielle et saccadée nous met au cœur de cette histoire de la violence passée sous silence. À partir d’une même réalité, plusieurs analyses et hypothèses apparaissent, soit par le biais psychiatrique, soit par une analyse systémique et sociologique. Certaines autorités ne cherchent pas quelle pourrait être la cause systémique de tels phénomènes, mais préfèrent en accuser les victimes et les responsabiliser injustement. « L’usine n’est pas à l’origine des évanouissements, les émotions des ouvrières sont seules en cause. Leur mauvaise alimentation pose aussi problème. » déclare l’administration de l’usine de confection cambodgienne (p. 180). L’anthropologue Aihwa Ong montre dans ses travaux que ces évanouissements collectifs peuvent être vus comme un « langage inconscient de protestation contre la domination masculine et l’oppression subie sur le lieu de travail » (p. 161), voire même, selon Maurice Eisenbruch, d’une « réponse corporelle inconsciente à un traumatisme intergénérationnel », faisant référence au génocide cambodgien par le régime des Khmers Rouges de 1975 à 1979.
C’était lors de ma première semaine de travail à l’Esperluette, Xavier me tend ce livre à la couverture noire et rêche. Les quelques fragments de récits inscrits sur la couverture ont tout de suite retenu mon attention. Je n’avais pas encore ouvert le livre que j’entendais déjà les paroles de ces ouvrières, importantes et tragiques, à côtés des déclarations froides et injustes des autorités. « Je suis allée dans un grand hôpital où on m’a dit que tout allait bien. Ils ont ajouté que si je n’avais pas de problème, je ne devais pas venir à l’hôpital. Ils m’ont traitée de fainéante » ; « Les évanouissements parmi les ouvrières sont dus à l’épuisement causé par de longues nuits passées à danser ». Le fait que ces citations soient inscrites à l’extérieur du livre, autrement dit sa partie la plus visible et accessible, m’a tout de suite donné envie d’écouter ces histoires que je sentais recueillies avec justesse par une personne voulant rendre visible et dénoncer ces phénomènes. S’il s’agit d’une histoire de silences manifestés par la réaction des corps, ces paroles inscrites dans la couche superficielle du livre, sa peau, ne peuvent que leur donner tout l’espace et toute la visibilité qu’elles méritent. Je m’y suis plongé avec toute mon attention, le souffle coupé à chaque page, la colère au fond de mes intestins, et l’empathie qui traversait la peau de mes doigts contre ces images de tortures. Aujourd’hui, je prends le temps d’écrire, de rendre visibles encore un peu plus ces récits et ce travail que j’admire. Je ne peux que féliciter l’importance et la justesse de cette recherche. Demain, je reposerai ce livre dans la librairie afin qu’il puisse de nouveau toucher d’autres consciences que la mienne.
« Tant que l’on ne s’attaque pas aux problèmes politiques et structurels, que ce soit l’oppression des femmes en Afghanistan ou les conditions de travail dangereuses au Bangladesh, d’autres épidémies surviendront. »
Enaëlle Forest
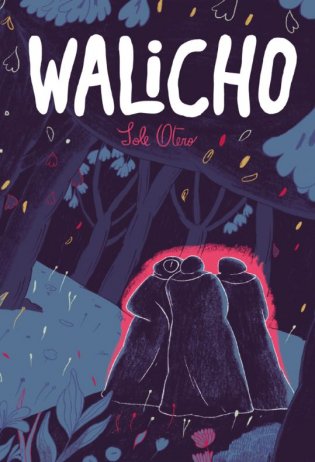
Walicho
de Sole Otero
traduit de l’espagnol (Argentine) par Anne Plantagenet
Editions Çà et Là
BD
«Tu va bientôt comprendre que si toi tu es peu commune, moi je suis exceptionnellement bizarre».
Après qu’elle ait remporté en 2023 avec Naphtaline le prix du public du festival d’Angoulême, on retrouve l’immense talent de Sole Otero avec Walicho.
On retrouve la même invention graphique, mais dans une veine où l’horrifique se mâtine de surnaturel, de réalisme magique et d’animisme, cette même façon de combiner des couleurs vives (avec ce rose, tout en contraste, qui nous en met plein les yeux), de faire jaillir des cases les phylactères et de les raccorder aux personnages qui prononcent ces dialogues ou monologues, des personnages aux contours si singuliers avec des détails dans les visages tout à fait saisissants, parfois savoureusement déformés. Cette nouvelle BD rassemble neuf histoires qui ont un certain nombre de points communs à commencer par trois sœurs aux pouvoirs magiques, jamais éloignées de leur bouc protecteur avec qui «elles n’ont pas une relation très normale», et qui défient, en ayant soigneusement recours à quelques actes de sorcelleries, l’ordre patriarcal sous toutes ses formes. On saute d’une histoire à l’autre, avant de comprendre ce qui les relie. Chaque histoire répond à sa propre logique, à sa propre grammaire visuelle, avec, au milieu de l’album (partie intitulée «un peu plus normal»), cette démultiplication de petites vignettes constituant la décomposition d’un quotidien enfermant, et où seuls les mails semblent s’échanger, ou bien la partie «mêle toi de tes affaires» où l’on retrouve un agencement plus proche de ce qui constituait l’ambiance familiale et les coloris de Naphtaline, ou encore la partie «Graciela veut savoir» qui se décline toute en bichronie. Mais le tout constitue bien une fresque à part entière avec une circulation d’une histoire à l’autre.
C’est bien, entre passé et présent, une partie de l’histoire de l’Argentine qui défile sur plusieurs siècles, et on retrouve ici ou là des références à la culture mapuche et à la langue mapudungun, toujours bien accompagnées par les précieuses notes de la traductrice.
C’est qu’il s’en passe des choses dans ce Manoir de Palenque, des sorcières-guérisseuses y opèrent «en harmonie avec le lieu», elles pratiquent en secret des avortements.
Des histoires parfois mystérieuses, à tout le moins déconcertantes et parfois diaboliques. Ensorcelant à souhait.
«Walicho : en langue mapuche, être qui personnifie tous les maux et les malheurs, et qui est relié à des éléments naturels singuliers : vieux arbres solitaires et mystérieux, grandes pierres, grottes, sentiers étroits. En créole et en espagnol, diable, Satan, force du mal. En argentin, maléfice ou sortilège réalisé par la magie noire ou apparentée».
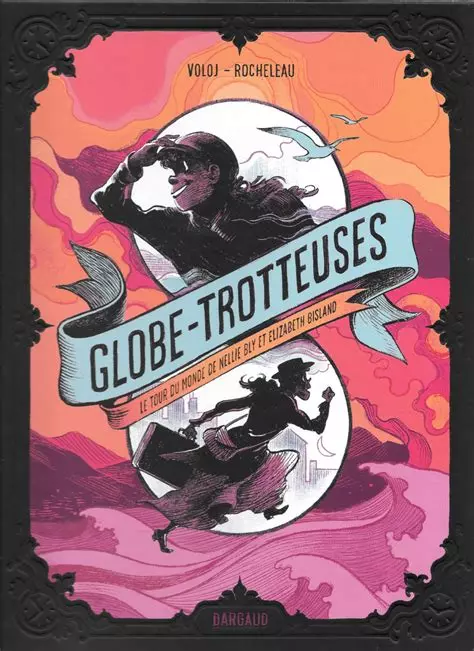
Globe-trotteuses - Le tour du monde de Nellie Bly et Elizabeth Bisland
De Julian Voloj et Julie Rocheleau
Chez Dargaud
BD
« …On lui reconnaitra des qualités de pugnacité, de détermination, d’indépendance et de débrouillardise… Et ce, partout où elle ira. »
Globe-trotteuse nous narre l’histoire vraie de 2 journalistes américaines (trop peu connues il me semble) travaillant pour 2 journaux concurrents à la fin du 19ème siècle. Nellie Bly, après avoir infiltré un asile (ce qui en fait une pionnière du reportage clandestin), décide de tenter de battre Phileas Fogg, personnage de Jules Verne, et de réaliser un tour du monde en moins de 80 jours. Quelle drôle d’idée pour une femme, se disent plus d’un homme de l’époque ! A commencer par le patron de The World. Mais son audace paie et Pulitzer (qui créera quelques années plus tard le prix littéraire du même nom) finit par accepter de lui financer le voyage. Apprenant cela, le Cosmopolitan décide également d’envoyer une femme faire le tour du monde : Elizabeth Bisland. Cette dernière n’est pas aussi enthousiaste que Nellie mais part malgré tout. Nous suivons alors les 2 voyageuses à un rythme effréné qui, parties en sens contraire, ne croiseront pas du voyage (Nellie ne sait même pas qu’elle a une concurrente). On embarque avec elles sur des bateaux, dans des trains, sur des calèches, des pousse-pousses, on court à perdre haleine avec elles (surtout Nellie). On subit tempêtes, retards, annulations, et autres péripéties. On voyage aussi un peu dans le temps.
Le rapport homme – femme, les préjugés sexistes, et ceux liés au colonialisme, encore très présent à la fin du 19ème siècle, sont croqués avec justesse.
Le caractère intrépide et libre des 2 globe-trotteuses se ressent aussi bien dans les dialogues que dans les vignettes. Les expressions du visage sont particulièrement parlantes. Et lorsque l’une ou l’autre a le mal de mer, on s’y croirait vraiment ! Que dire des « rêves caféinés » ou, dès le prologue, de l’incursion dans l’asile de l’île de Blackwell (cela nous fait d’ailleurs dire qu’il ne faut peut-être pas mettre cette BD dans les mains de trop jeunes enfants – à partir de 12 ans c’est bien).
Décapant et instructif
Deux femmes à découvrir, une BD à lire
« Je veux battre Phileas Fogg. Je veux faire le tour du monde… en moins de 80 jours !! »
- All
- Gallery Item

My love
de Niki de Saint Phalle
Editions Gallimard
« Where shall we make love ? on top of the sun ? in a field of flowers ? »
My love est né en 1971 des mains de l’artiste peintre sculptrice et écrivaine (Mon secret, 1994) féministe franco-américaine Niki de Saint Phalle. Les éditions Gallimard ainsi que la Niki Charitable Art Foundation permettent aujourd’hui de le saisir de nouveau grâce à cette magnifique réédition sortie en avril 2024. My love est un livre d’artiste*, une consolation, un poème, une peinture ruisselante, un accordéon muet, une brèche autobiographique et commune, un amour qui change de forme. Connu pour ses sculptures de corps aux traits tirés, gonflés et incroyablement imposants (Nanas, 1964), elle a également commencé sa carrière en tirant à la carabine sur des ballons remplis de peintures accrochés à des toiles blanches (Tirs, 1961). Niki de Saint Phalle est une artiste guérisseuse, engagée, poète, armée, amoureuse de l’amour et de l’amour des autres et de l’art et des autres encore. C’est un amour qui n’est pas réservé à l’amour romantique**, même s’il s’agit là du sujet de ce livre. C’est un amour qui prend soin des luttes comme dans sa très belle œuvre My heart belongs to Black Rosy (1965), qui soutien et permet de valoriser une représentation importante de la militante afro-américaine Rosa Parks.
Livre-accordéon aux dessins colorés et frénétiques, les pages se tournent et se déploient. On peut le lire en quelques minutes tout comme le regarder pendant des heures. Chaque page pourrait bien, s’extraire un peu plus, s’arracher au livre, le quitter et trôner sur un mur que l’on regarderait comme on regarde les tableaux des musées ou la vue panoramique d’une ville. On y trouve des fleurs et des étoiles, des mains et des téléphones. Le tout se lit comme un poème visuel, une longue phrase dont on retient le souffle, une larme qui traverse la peau depuis le coin de l’œil jusque dans le cou. Les dessins illustrent le texte, l’accentuent, le console presque. Comme si chaque mot était un être à part entière, une entité qui existe en volume et en couleurs. Mais rien ne peut nous dire si le texte a précédé le dessin ou si le dessin a précédé le texte. De toute évidence, chaque page constitue un espace-temps à part entière, celui d’une question, d’un rêve ou d’une souffrance.
Cette histoire d’un amour est une histoire où dans sa fin commence un début. C’est un amour étendu, qui s’étire de la jungle jusqu’aux lèvres en passant par des objets du quotidien tels qu’une robe, un lit, du temps. Puis à mesure que ce temps s’étire apparaît des nuages et de la pluie. Cet amour, comparé à une fleur, finit par se faner. « Our love was a beautiful flower (1) it grew (2) and grew (3) an grew (4) the sun helped it grow (5) the rain helped it grow (6) and then the flower blossomed fantasticaly (7) winter came and the petals started to fall (8) and then the flower died (9) I took the petals and put them in a box (10) and I locked the box in my heart ». C’est finalement une histoire de rupture, mais cette rupture n’aurait pas exister sans amour, et cet amour s’il a un jour existé, a trouvé sa place quelque part où il ne disparaît pas. Consolés par le dessin de cette boîte recueillant ces pétales, les mots de Niki de Saint Phalle nous éclairent avec douceur et espoir sur l’un des sujets les plus communs et partagés de la littérature. J’y ai plongé sans douleur, quelques larmes ont arrosé mes yeux.
« I feel asleep under a beautiful tree »
`
*https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=video&id_video=623
**À propos d’amour, bell hooks, 2000
Enaëlle Forest
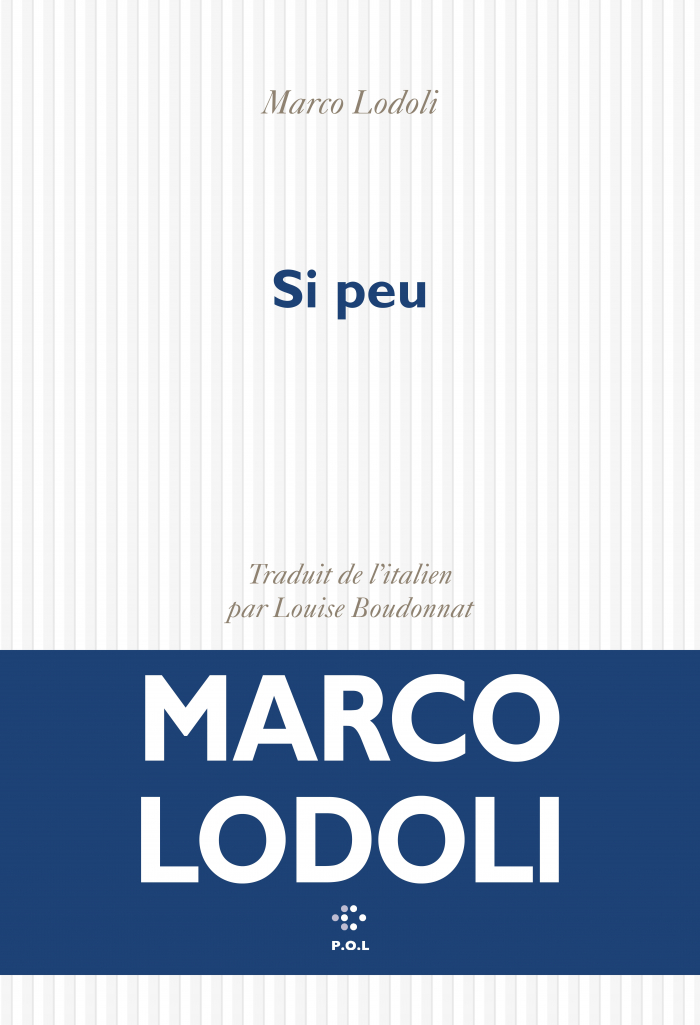
Si peu
de Marco Lodoli
traduit de l’italien par Louise Boudonnat
Editions P.O.L
«L’amour ne produit rien d’autre que ce qu’il est, c’est seulement le merveilleux gaspillage des rares énergies intérieures que la vie nous a transmises. Des talents ni investis ni enfouis, mais simplement dépensés ou perdus.»
Quel texte délicieux que celui signé par Marco Lodoli. Il emprunte une forme continue, ramassée (pas de chapitre, pas de rupture, pas d’emphase), une bulle d’histoire qui se prête à une lecture d’une traite, et dans laquelle on vient se nicher comme dans un cocon.
On suit sur près de quarante ans la narratrice qui officie en qualité de concierge dans le petit lycée de Torre Maura dans le sud-est de Rome. Elle est toute entière consacrée à rendre plus fluide l’organisation des petites choses du quotidien, «une qui ne fait rien, mais qui tient patiemment le monde uni». Mais sa vie bascule lorsqu’un certain Matteo Romoli surgit dans l’établissement, un prof de lettres aux cheveux fous qui se distingue en ne donnant pas d’interrogations, auteur à ses heures perdues. Matteo la trouble au plus haut point, mais elle garde ses sentiments par-devers elle. «J’aimais Matteo parce que cet amour était toute ma vie, avec lui ou sans lui, dans le fond, ça ne changeait guère, dans le fond personne ne possède rien».
Elle vit un amour platonique à l’âge adulte, une vie par procuration («heureuse pour lui, seule, chez moi»), car l’énamourée aime à se nicher discrètement dans les plis de la vie de Matteo . Et comme si l’admiration à distance de cette quasi dévote ne suffisait pas, comme si le suivre ici et là ne remplissait pas suffisamment le vie de son existence, elle s’imagine aussi l’avoir à ses côtés : elle dresse une table pour deux, fait l’acquisition d’une bouteille de bon vin qui l’attend, lui achète et repasse une chemise blanche, lui écrit des lettres qu’elle n’enverra jamais, elle s’échine à faire les dissertations qu’il donne à ses élèves. Elle veut être sa consolatrice de l’ombre («il n’était pas heureux, je sentais qu’il avait des préoccupations secrètes, une fine entaille à panser»), prête à prendre sa défense face aux critiques qui ne le ménagent pas à la sortie de ses livres ou face à ses collègues peu solidaires.
La réciprocité n’est pas au rendez-vous, il la remarque tout juste, lui prête un prénom qui n’est pas le sien et s’adonne à une passion amoureuse avec Maddalena.
On peut avoir l’impression tenace que cette narratrice-qui-n’est-pas-Caterina-comme-le-pense-pourtant-Matteo se perd à vivre en vain, à aimer comme dans «un rêve solitaire infini», mais ce n’est pas tout à fait ça. «Peut-être que quelque chose ne tourne pas rond en moi, pourtant je me sens souvent heureuse, quand je vois Matteo mon cœur s’emballe et il me semble que ce n’est pas le mien, mais le cœur de la vie». Il y a quelque chose de précieux qui résiste et confine à une forme de pureté («il faut faire peu et le faire bien, se vouer à la pureté sans ajouter de poids inutiles» ; «une éventualité qui reste suspendue dans le champ des possibles inassouvis et c’est ce qui nous rend encore plus purs, plus limpides») dans cette vie imaginée, dans cet amour projeté, dans cette relation non advenue.
A l’instar du personnage principal de Perfect Days, de sa place quasi immobile, comme invisible («j’étais plus ou moins un objet qui avait la même utilité que le distributeur de sucreries et la machine à café»), on voit défiler le monde sous ses yeux, «l’allure et l’attitude» des personnes qui fréquentent l’établissement («je n’ai pas fait d’études, mais depuis ma petite table à l’entrée de l’école, j’ai lu et observé bien des choses et j’en ai compris certaines»).
Une écriture qui, au gré des «angles et courbes», dessine comment s’actualise, instant après instant, un amour silencieux qui vient nous étreindre.
«J’étais heureuse comme j’étais, sans espoir, parce que tout espoir est prétention, un investissement mesquin sur l’avenir, un pari qui réclame de la chance».
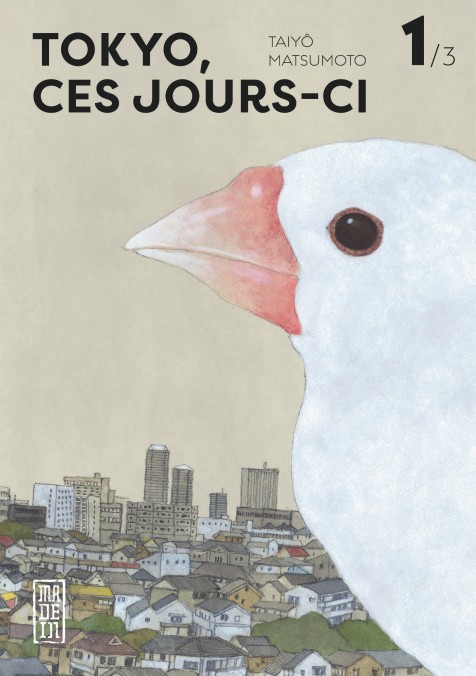
Tokyo, ces jours-ci
de Taiyô Matsumoto, traduit du japonais par Thibaud Desbief
Editions Kana
Manga
«Je peux comprendre qu’il soit douloureux d’ouvrir les yeux, mais… Depuis plusieurs années… Je ne sens plus aucune vie émaner de vos mangas.»
Premier tome d’une courte série de 3 volumes, ce manga semble, à première vue, un «simple» manga sur l’univers des mangas. En effet, le personnage principal, Shiozawa, est éditeur de mangas. Nous le rencontrons au moment où il décide de démissionner et souhaite tourner la page avec ce milieu. Mais rapidement il choisit finalement de partir à la rencontre de mangakas qu’il a édités pour leur demander d’écrire pour lui. On est donc bel et bien dans cet univers, entre créateurs et éditeurs. Mais c’est sans compter sur le fait que l’auteur est Taiyô Matsumoto. On retrouve sa sensibilité dans chaque portrait : tous sont présentés par petites touches, tel un peintre impressionniste. L’expression des émotions est tout en retenue, on les perçoit grâce aux bribes d’histoires personnelles dévoilées. Et une constellation de questions ressort, englobant bien plus que l’univers des mangas : qu’est-ce qui nous guide dans notre travail au quotidien ? Ou plutôt, et surtout, qu’est-ce qui guide un artiste ? Que puise-t-il chez lui pour créer ? Comment celle-ci reflète-t-elle son âme ?
Des vies en demi-teintes, avec leurs difficultés, leurs déceptions. La grisaille est là, mais un vent souffle et on devine (notamment à la fin de ce tome 1 lors que la mangaka – caissière de supermarché se remet à dessiner) qu’après la pluie pourrait bien apparaître quelques rayons de soleil, une respiration, un nouvel élan.
Le lecteur, porté par le rythme, assez lent, de la narration, prendra le temps de lire aussi finement les illustrations. Le tracer, loin de la ligne claire, amène de la matière. Les hachures mettent du relief. On dirait presque parfois qu’on regarde à travers un fish-eye, mettant en exergue un détail, un objet, un micro-univers. Et que dire des pleines pages concluant chaque partie ? Paysages citadins à la météo changeante, ils semblent nous donner le ton, l’état d’âme du moment de Shiozawa.
De la poésie introspective en manga.
«Aujourd’hui, appeler le bouquiniste et dire adieu aux mangas»
- All
- Gallery Item

Propre
d’Alia Trabucco Zerán
traduit de l’espagnol (Chili) par Anne Plantagenet
Editions Robert Laffont
«Les faits sont arrivés sans prévenir, entendez bien ceci une bonne fois pour toutes. Et, dans ce cas, il est très difficile, voire impossible, de les empêcher».
Cela se saurait si les prix littéraires venaient systématiquement récompenser des textes hors du commun, il n’est qu’à parcourir le petit livre d’Arnaut Vivant, «Station Goncourt, 120 ans de prix littéraires», paru l’an passé aux éditions de La Fabrique, pour se faire une idée un peu précise sur à quoi peut bien tenir un prix et pour prendre un tant soit peu de recul avec ce que l’auteur appelle «la République des Lettres».
Si les bandeaux ne se suffisent pas, on aurait parfois tort de ne pas se laisser guider par tel ou tel prix, à commencer cette année par le Prix Fémina Etranger.
On tient là une histoire qui se déroule à Santiago, racontée du point de vue d’Estela, employée à domicile d’un couple, lui médecin, elle avocate, parents d’une petite Julia, tout à fait fantasque, mystérieuse et désespérée, un peu comme Gabrielle dans Les maisons vides de Laurine Thizy (et avec les mêmes troubles du comportement alimentaire). Dès le début du roman, la fin de l’histoire est connue, à l’âge de 7 ans la petite va mourir. L’autrice s’attarde sur les chemins qui mènent à cette fin, connue d’avance. Le processus n’est pas sans nous rappeler, le sujet non plus, le livre de Samira Sedira, Des gens comme eux. Ce que vient nous dire un passage à l’acte des violences qui enserrent le contexte dans lequel elles prennent forme. Elle nous décrit, dans l’immobilité de sa chambre, «la pièce du fond» avec une porte en verre dépoli, de «la marge du temps qui s’écoule» (c’est de cet espace-temps que se déploie un monologue caractérisé comme une succession de fragments), comment opère, sept années durant, le dysfonctionnement, la fuite en avant de cette famille, comment se jouent au quotidien les rapports subalternes qu’ils entretiennent (une des forces du livre réside aussi dans cette manière de montrer comment elle est rendue invisible par ses employeurs, la mère de la narratrice aimant lui rappeler «il ne faut pas aimer ceux qui commandent ; ils s’aiment seulement entre eux»). C’est à partir de ce lieu de repli que surgissent aussi des éléments d’irréalité (l’autrice sait jouer avec le trouble, le dédoublement aussi, avec des images comme des présages qui viennent s’incruster dans le récit, comme celles du figuier, celle de Yany la chienne errante, l’importance de la commissure des lèvres), des souvenirs aussi de son enfance et de sa mère dans le Sud, à Chiloé. Alia Trabucco Zerán déplie par le détail des activités domestiques et du corps, cette «machine à routines», ce qu’être au service signifie «dans la langueur et la largeur d’une vie».
On pourra trouver aussi un écho avec le livre de Leïla Slimani, Une chanson douce. Ou comment à partir de traces, d’indices déposés ici ou là, l’inévitable se trame («dans le silence (…) tous les mots existent à la fois doux et rugueux, tièdes et froids»), et l’autrice de s’amuser, en tissant ses digressions comme une toile d’araignée entre les mots et les choses, jusqu’à ce que «les contours de la réalité se mettent à vibrer», avec les codes de l’intrigue criminelle.
Une autre originalité de la narration réside dans la manière dont l’autrice se permet de convoquer le lecteur comme pris à témoin, mais aussi dans cette auscultation de ce qui caractérise les rapports, faussement intimes, gouvernants-domestique, avec des variations infinies d’interactions qui viennent en dire long sur le rapport de classe et de mépris à l’oeuvre dans ce huis-clos où le seul extérieur qui s’invite est celui des écrans télé. Les dernières pages nous rappellent comment le réel politique chilien se rappelle à la narratrice quand cette dernière fuit, les rues de Santiago étant à feu et à sang, elle devient alors malgré elle partie prenante des soulèvements en train de se faire, le collectif rejoignant ici son économie de survie.
Un roman prenant, d’une grande force narrative.
«La vie, c’est un peu comme ça : une goutte, une goutte, une goutte, une goutte, et alors on se demande, perplexe, comment se fait-il qu’on soit mouillé ?»
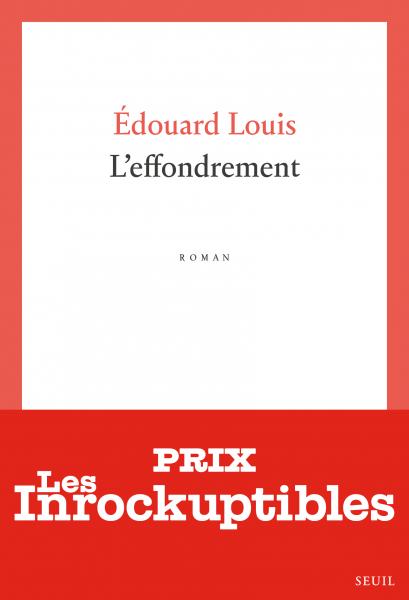
L'effondrement
d’Edouard Louis
Editions du Seuil
«À compter de ce jour, l’existence de mon frère est devenue pour nous un récit. (…) Je me souviens du silence. Je me souviens comme les nouvelles de mon frère et de sa vie chez les Boinet nous arrivaient par touches minuscules, comme dans le processus de création d’un tableau où les premiers gestes du peintre ne permettent pas de deviner la toile à venir ni même l’objet qu’ils représentent.»
Ce dernier livre d’Édouard Louis marque la fin d’une fresque familiale (En finir avec Eddy Bellegueule, Qui a tué mon père, Combats et métamorphoses de la vie d’une femme…) qui en est toujours restée très justement à cette première étape : celle de l’esquisse, des premiers traits inachevés qui ne figent pas le sujet, qui lui laisse la possibilité de s’échapper, de rester en mouvement. Ses livres dessinent des portraits de corps en fuite, de corps dont certaines parcelles, si petites soient-elles, ont parfois réussi à se défaire du déterminisme social. Ce sont ces touches minuscules, ces morceaux d’histoires, ces bouts de récits, qui constituent avec justesse une œuvre qui dit ce qui nourrit le cœur de l’injustice sociale, ce qui lui donne à boire et à manger, la gave, la noie, et la laisse mourir la bouche ouverte. «Certains jours, il me semble que l’Injustice, ce n’est rien d’autre que la différence d’accès à l’erreur, il me semble que l’Injustice, ce n’est rien d’autre que la différence d’accès aux tentatives, qu’elles soient ratées ou réussies, et je suis tellement triste, je suis tellement triste.»
Le personnage de son frère est pris dans une constellation de violences perpétuelles. Le temps de sa vie est arrêté. Il est en suspens, s’accroche à des vérités qui puisent dans la haine et dans le rejet de l’autre pour se sentir exister. Lire l’histoire d’un homme aussi détestable m’a fait ressentir depuis l’intérieur ce qu’était une situation de violence et d’injustice sociale. Il m’a paru important de comprendre cette situation, de la connaître depuis ce récit. Les descriptions de ces scènes (violences physiques et verbales, agressions sexuelles, tentatives de suicide) sont factuelles, parfois fictionnelles, mais jamais romancées, et leurs intérêts n’est pas de défendre ou de justifier ses actes. Il s’agit plutôt de faire entrer en littérature des réalités invisibilisées, jusqu’à écrire avec la langue des dominé·es et se demander si la littérature peut les accueillir : «Je ne sais pas si la littérature peut retranscrire ces mots-là. Je doute de sa capacité à communiquer la simplicité et la rudesse avec lesquelles mon frère les prononçait. À quoi ressemblerait un livre composé exclusivement avec ce langage ? Si ce langage existe dans le monde, est-ce qu’il peut, ou doit, exister dans les livres, ou est-ce que les livres doivent marquer un écart entre le langage du monde et le leur ?» Dans Dialogue sur l’Art et la politique, Édouard Louis dit, à propos des films de Ken Loach : «Je pense qu’ils sont beaux parce qu’ils sont tristes et violents, et que la réalité est triste et violente. Et voir le réel tel qu’il est me donne de la force.»
Édouard Louis déroule, à travers son récit, le fil d’un déterminisme social en même temps qu’il le coupe, qu’il le détruit. Ce qui s’effondre, je sens, au fond, c’est ce doute qui peut hanter parfois pour toute une vie la réalité d’un·e transfuge de classe : Aurais-je pu ou dû avoir la même vie ? Aujourd’hui, ce qui délimite sa vie à lui, en tant qu’auteur, c’est la beauté et l’importance de ses livres, ce qu’ils montrent des réalités qui ont besoin de représentations. Il ne s’accapare pas la vie de son frère, mais la regarde comme s’il regardait dans un miroir brisé, et à travers ces fragments, c’est son identité à lui qu’il constitue, son portrait, son récit, sa fuite. La forme de son texte morcelée, avec des questions, faits numérotés, remarques, répétitions, doutes, phrases en italique ou entre parenthèses, répond à l’impossibilité de raconter l’histoire de son frère avec précision ne l’ayant pas vu depuis 10 ans. Mais cette forme disloquée est aussi un effondrement et un adieu avec grâce, finesse, et désinvolture. La littérature, l’art, la culture dite légitime, quand elle est exclusivement l’apanage des classes dominantes, peut paraître comme une forme figée. Édouard Louis, par son engagement politique fort et son immense culture littéraire, peut, dans une beauté infinie, donner à son récit la possibilité de s’évader, de s’échapper. Il l’effondre et nous effondre aussi à chaque page qui se tourne. C’est avec reconnaissance que j’ai fermée ce dernier livre, assise sur mon canapé, regardant au loin les fenêtres des immeubles en face.
«Rien ne peut dire cette distance entre nous. Rien ne peut dire la distance, mais cette distance dit tout. La distance est une mémoire. Même quand je ne pensais pas à mon frère, je ne l’oubliais pas.»
Enaëlle Forest
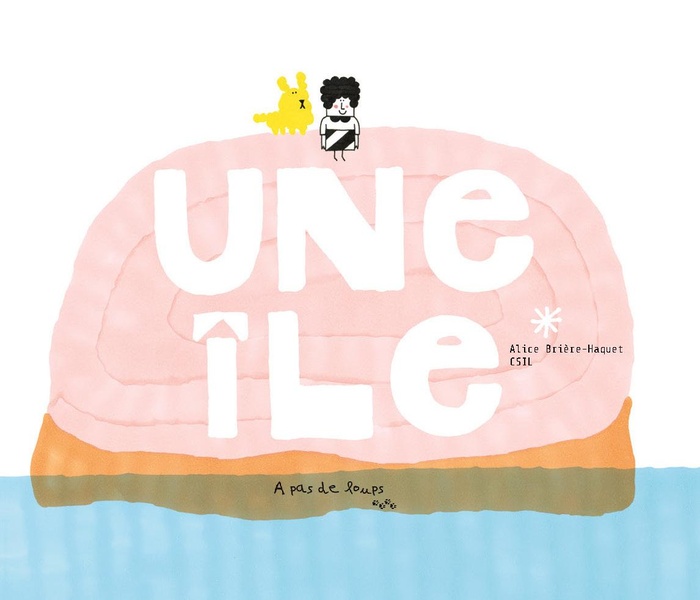
Une île
d’Alice Brière-Haquet et CSIL
Editions A pas de loups
Album jeunesse dès 3 ans
«Certains matins, j’aimerais bien partir.»
Quelle joie de découvrir un nouvel album jeunesse d’une maison d’édition qu’on aime beaucoup, A pas de loups, de surcroit écrit par Alice Brière-Haquet qui nous a régalé avec les Philonimo, et illustré par CSIL, une illustratrice découverte avec Josette au bout de l’eau. Il ne peut s’agir que d’un album à ouvrir au plus vite !
Savourons d’abord la couverture : une héroïne toute frisée et souriante et son chien au sommet d’une île aux allures d’escargot et aux couleurs acidulées qui donneraient bien envie d’aller à leur rencontre. Pourtant c’est justement de solitude qu’elle rêve… Ou presque. Elle partirait bien sur une île déserte… Qu’elle peuplerait de personnes choisies sur le volet : son chien, quelques amis, sa famille, quelques voisins (gentils ou crétins, «pour l’équilibre») et bien d’autres personnes encore. Sans oublier des animaux en tous genres. C’est sûr, les jeunes lecteurs (et moins jeunes aussi certainement) seront absorbés par tous ces habitants dessinés au feutre noir et aux aplats de couleurs contrastés. On pourrait même jouer à chercher des ressemblances avec ses proches.
Plus si déserte cette île… Alors peut-être que notre héroïne souhaitera un jour trouver une autre île tranquille… qu’elle risque bien de repeupler également.
Alors ? Rester seul ou entouré ?
Allez, on se relit cet album pour y réfléchir !
«Je n’emmènerais que mon chien…et puis quelques amis.»
- All
- Gallery Item
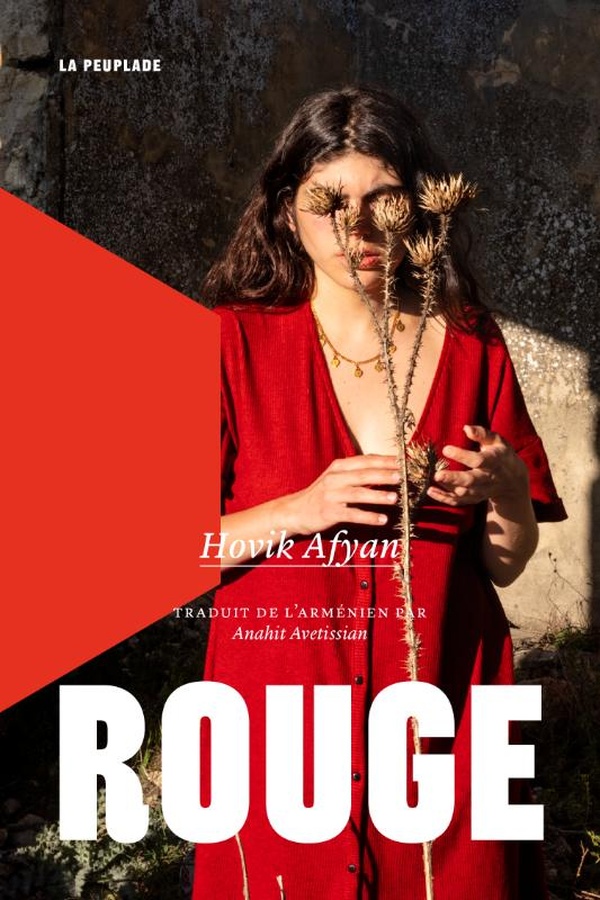
Rouge
de Hovik Afyan, traduit de l’arménien par Anahit Avetissian
Editions La peuplade
«Arous avait découvert que les guerres naissaient du manque d’amour, dans le but de trouver l’amour. On fait la guerre pour une femme, comme ce fut le cas à Troie, ou pour la terre et le pouvoir, comme ce fut le cas à Troie…»
Ce roman narre par petites touches, telle des tableaux, des fragments de vie. Des va-et-vient entre année 198X et 20XX (désignées comme telles dans le texte), entre une champ de fleurs, un village à la frontière et Erevan. Une vingtaine d’années d’écart, et pourtant peu de changements, la guerre, toujours présente, plus ou moins proche. Une histoire de femmes et d’hommes, d’enfants aussi, qui tentent de vivre ou survivre. Ici c’est la guerre du Haut-Karabakh, entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, mais la force d’Hovik Afyan, c’est de nous proposer un texte qui pourrait se transposer dans chaque territoire en guerre. C’est une histoire universelle et atemporelle (l’imprécision des années renforce cet aspect) qu’il nous raconte. Le drame de la guerre.
Lumière sur un champ de fleurs rouge cerise, à la frontière de deux pays en guerre, une femme et un homme, mis à mal par la vie, qui s’aiment tant bien que mal. Arous est danseuse, Aram est peintre. Des coups de feu, deux corps d’enfant, un cri, le rouge du sang séché sur les corps. L’art peut-il survivre en temps de guerre ? Peut-il sauver des vies ? Peut-il seulement dire l’horreur de la guerre ?
Autres lieux, autres instants, mais toujours l’amour qui guide, tient en vie, de manière chaotique :
dans un village à deux pas de la frontière, un abri, des femmes qui attendent leurs maris, un homme (unijambiste) qui défend cet abri et imagine redonner le sourire à l’une d’entre elles en faisant revenir son mari (pris en otage par l’ennemi). Un garçon parti cueillir des roses rouges pour l’anniversaire de sa mère. Une femme qui se sent vivre lorsqu’elle quitte son domicile où son mari demeure (revenu de guerre aveugle, sourd et en fauteuil) et devient pour quelques heures modèle pour un peintre.
Dans un style tout à fait différent, ce roman m’a fait penser à celui d’Émilienne Malfatto, Le colonnel ne dort pas (éditions du sous-sol), sur le non-sens de la guerre, d’une guerre qui dure.
Chaque tableau nous amène aussi avec subtilité, dans la déclinaison d’un rouge fragmenté, sur le fil ténu de la vie.
«Si à cet instant l’ennemi était entré dans notre pays, la guerre aurait perdu devant l’amour. Probablement…»

On n'est pas des bourgeois
de Fabienne Swiatly
Editions Bruno Doucey
collection «soleil noir»
«Comment ça, je rêve au-dessus de mes moyens ? Encore heureux que je ne rêve pas au rabais».
Fabienne Swiatly n’en est pas à son premier recueil où l’autrice s’emploie à appréhender les questions sociales qui burinent notre société. Pour ne citer qu’eux, on rappellera chez le même éditeur, dans la même collection, Elles sont au service, recueil paru en 2020, ou un peu plus ancien à La Fosse aux Ours, Gagner sa vie (2006). Son intention est clairement positionnée dans la postface, l’autrice y rappelle, «tenter par l’écriture de donner à voir ce qu’on ne sait plus vraiment regarder. Tenter par l’écriture de donner une voix à celles et ceux qu’on ne sait plus écouter. Tenter, par petites touches, de révéler ce que la pauvreté raconte de notre société». Le ton est clairement aussi donné avec la première page où s’égrène ces phrases, ces sentences de mort comme dirait Pierre Tévénian qui se sont incrustées dans l’opinion publique, énoncées par des politiques, par une peur du déclassement, un menu déroulant de verdicts définitifs tombés dans le domaine public et que l’on pourrait à l’envie à son compte, sans vergogne, pour mettre à l’index, «les gens d’en bas, salauds de pauvres !».
Nous est offerte une lecture du monde d’en bas, ce que l’autrice a pu observer ici ou là, au gré de ses déplacements dans son camion aménagé. L’exercice qui n’en est pas un n’est pas tout à fait nouveau pour elle, pour celle et ceux qui la suivent sur son blog la trace bleue (https://latracebleue.net) où elle consacre une rubrique à des «portraits de gens».
Fabienne Swiatly scrute, tout en prose, le quotidien, comme il lui arrive de le prendre en photo. Des courts poèmes qui énoncent, qui dénoncent. Ponctués d’une chute. Une phrase-uppercut en italique qui nous retient («J’ai du mal avec leur générosité déductible des impôts» (…) «Il paraît que la pauvreté est de retour. Moi, je ne l’ai jamais vue partir» (…) «Côté résidence, certains ont droit a du secondaire alors qu’ici on manque cruellement du principal»).
On va d’un lieu à l’autre, d’un habitat précaire à l’autre, avec le bruit de la circulation en bruit de fond, l’observation se fait à partir des lieux où se fabriquent imperceptiblement ou pas l’indésirabilité, l’invisibilité de l’Autre. C’est que les fragments de vie s’additionnent, les observations se cumulent et se dessinent ainsi un tableau d’ensemble qui nous est brandi. Des corps allongés à même le sol, les agragats de cartons qui sont décrits nous rappellent aussi les statistiques publiques têtues sur le devenir de cohortes de jeunes confiés à l’ASE et qui se retrouvent jeune adulte à la rue, sur ce que vient signifier sur les vies de ceux concernés la délocalisation de telle usine. La prose se fait photographie de ces vies à l’écart, mise à l’écart de l’autre côté du périph’, de ces formes de survie qui s’organisent («la pauvreté t’oblige à devenir roi. Roi de la débrouille !», «l’art d’accommoder les restes») dans le «no man’s land des grandes villes». Et un peu partout sourde une forme de microsolidarité, «la pauvreté n’empêche pas la solidarité».
L’un des mérites de ce texte, c’est que Fabienne Swiatly réintroduit une forme de conflictualité (quelque peu dissoute depuis l’adhésion à la thématique de l’inclusion) nous rappelant que «la pauvreté n’est pas une fatalité mais le résultat de nos modes de vie et de nos choix politiques». Fabienne Swiatly, qui n’est définitivement pas une poète bourgeoise, se rappelle de l’évidence selon laquelle «il y a des riches parce qu’il y a des pauvres», et chaque page vient sensiblement en attester.
«On me propose des ateliers de confiance en soi. Va nourrir tes gosses avec ça».
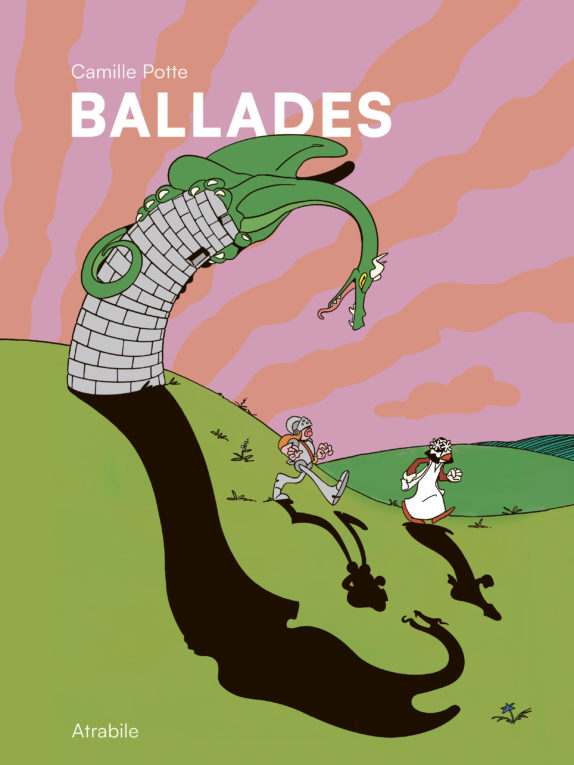
Ballades
de Camille Potte
Editions Atrabile
«Je suis le seigneur Gourignot de Faouet, frappé par une effroyable malédiction, j’ai été changé en une répugnante grenouille».
Les bédéistes savent faire honneur aux amphybiens en cette fin d’année ; après Jérémie Moreau et son Alyte, voici Camille Potte qui s’en amuse. Grenouilles mélomanes et salamandres aux pouvoirs extraordinaires sont de sortie. Les sorcières le sont également.
L’autrice s’amuse aussi à remanier du vieux français («esbigne toi, poltron») comme avait pu remarquablement le faire Guillaume Lebrun avec Fantaisies Guérillères (ed. Bourgois). Il faut à la fois une bonne dose de talent et de culot pour reprendre de la sorte les codes de la chevalerie pour les décomposer, recomposer à l’envie, en jouer pour mieux les déjouer, pour en faire ainsi une farce.
Comment questionner notre époque en convoquant l’imaginaire médiéval ? C’est tout le programme auquel s’attache Camille Potte.
Ses personnages s’étirent, débordent, ont un visage qui parfois se réduit à une bouche exagérément proéminente, de petits yeux ou pas. La dessinatrice se fait un délice d’avoir recours à des courbes, («c’est la résistance du papier qui amène un désir de courbe» – extrait d’un interview avec Marie Richeux dans son bookclub). Des rebellions s’organisent dans le royaume, un renversement menace. Derrière le complot familial, d’autres révoltes menacent («Nous n’avons point pris en compte le fait que l’absence de seigneur puisse déclencher des velléités égalitaristes. Ne vous méprenez point, je trouve formidable qu’ils s’adonnent à de petites fantaisies créatrices. Simplementn je crains qu’ils ne perdent de vue le principe de réalité. Le pouvoir, voyez-vous, c’est avant tout une question d’habitude»).
Camille Potte se moque des archétypes du prince, du valet, ils deviennent l’objet de moquerie infinie. Le prince est d’une telle gourmandise qu’il ne sait résister à l’attrait d’une tourte qui le transforme aussitôt en grenouille. Grenouille dont le peuple serait prêt à s’accommoder, arguant que « mieux vaut être gouvernés par une grenouille que par un tyran». Pendant ce temps c’est Gounelle la chevalière qui va faire sortir Patin la princesse de sa tourelle («Dix ans que je mire l’horizon àb travers le même feneston ; j’avais envie de voir à quoi ça ressemblait l’autre côté»).
Cette BD est d’un bout à l’autre déjantée et très inventive tant dans sa composition graphique que dans les formes et dialogues utilisés. Une BD qui fait bien rire et qu’on va défendre toute cette fin d’année.
«Quand vous estes damoiselle et membre de la garde, mieux vaut bien maestriser vostre communication».
- All
- Gallery Item

Alyte
de Jérémie Moreau
Editions 2024
«Toutes les affaires du monde résonnent partout»
Quel plaisir de retrouver Jérémie Moreau, avec ses jaillissements de couleurs, son graphisme dont il a le secret, avec une nouvelle fable écologique, pleine de féérie, jamais très loin d’un univers à la Miyazaki.
On suit le périple d’Alyte le crapaud accoucheur, l’unique rescapé de sa fratrie, qui cherche à s’en sortir. Une sorte d’anti-héros attachant et mélancolique qui va rencontrer toute une série d’animaux, du saumon, au bouquetin, en passant par l’aigle, le hibou, le bousier (prénommé Musk qui n’hésite pas à se confectionner sa propre planète, «la planète va mal. Moi je m’en fais une nouvelle, et dès qu’elle est prête je la mets sur orbite») et le sanglier, auxquels se rajoutent l’arbre et la montagne, qui vont tour à tour le protéger ou lui dispenser des conseils pour déjouer les pièges à l’aulne de leur propre expérience, croyance ou rapport au monde, jusqu’à ce qu’il comprenne que ce qui le menace lui comme ses congénères c’est la léthalyte, ce bitume qui s’étend de plus en plus, «la mort incarnée», cette urbanisation qui progresse, qui menace.
Alyte forme avec les autres animaux un tout relié, «un carrefour de vies» inter-dépendant (la singularité de chacun est renforcée par sa désignation, tous les êtres rencontrés sont affublés d’un nom), et c’est ensemble, solidaires les uns des autres qu’ils mènent un front pour ne pas disparaître.
Dans cette exploration du monde sauvage où l’humain n’est pas là, à la seule exception de la silhouette d’une petite fille, les couleurs fluo s’emballent et les regards noirs des êtres vivants non humains, inquiets et inquiétants nous fixent comme pour tenir ensemble beauté et cruauté de l’écosystème.
«La léthalyte déchire nos familles, nos territoires, la léthalyte nous isole, nous asphyxie, nous assèche, elle nous délie».

La Pythie vous parle
de Liv Strömquist
Editions Rackham
«De nos jours, la société, le monde sont truffés d’individus qui frénétiquement dispensent des leçons de vie en tout genre».
Après l’astrologie, Liv Strömquist s’attaque au développement personnel. On retrouve avec plaisir son ton engagé, les références nombreuses qu’elle mobilise, sa mise en page variée tout autant que colorée et saturée de textes.
Pour prendre la mesure du phénomène, Liv Strömquist fait choix de s’arrêter sur quelques exemples bien sentis, telle la scène inaugurale où une femme détaille sa routine du skin-care pour tonifier sa peau, tel le succès du youtuber Rollo Tomassi au sein de la manosphère qui professe ses conseils masculinistes à l’envi, ou celui du groupe de développement personnel, le «Selfhealers Circle» fondé par la psychologue Nicole LePera, autrice de « Guéris tes blessures ». «Sur internet, on trouve quantité d’experts qui donnent à peu près les mêmes recettes miracles (une pincée de wellness, un soupçon de pleine conscience et une dose de développement personnel)».
D’où nous vient l’essor de ce «self-help» ? Comment le fun est devenu obligatoire, comment, à défaut de se battre contre la mort, « se battre contre les causes de la mort devient le sens même de la vie» ? Comment expliquer que notre société devienne de moins en moins tolérante envers ce que la vie comporte en matière de déceptions, pertes, chagrins ?
«Au fond n’importe quel Charlatan est capable de concocter deux trois formules sur la meilleure façon de vivre», mais «derrière cette tendance à vouloir répandre la bonne parole, il y a avant tout le sentiment de puissance qu’en retire le Charlatan».
Afin de mieux prendre de la distance avec ces phénomènes de société, Strömquist guide notre réflexion en allant d’un penseur à l’autre, en puisant du côté de Theodor Adorno, Zygmunt Bauman, Byung-Chul Han, Ian Craib, Eva Illouz, Jacques Lacan, Martha Wolfenstein, Slavoj Zizek, ou encore Hartmiut Rosa. L’empilement des références n’altère pas la fluidité du propos, certainement aussi parce que les concepts (résonance, emodity, le soi réflexif…) sont reliés les uns aux autres notamment par la force du visuel qui restitue la logique du propos.
Strömquist esquisse dans cette BD, et de façon toujours amusée et ironique, sept conseils sur la manière dont nous devrions vivre et des raisons pour lesquelles nous devrions le faire, tout en étant parfaitement lucide sur le fait que ce qui défaut le plus souvent n’est pas tant d’avoir conscience de ce dont on a besoin, mais confiance dans notre capacité à le faire.
«N’importe quel idiot peut se douter qu’il existe un intérêt économique énorme à pousser les gens à croire qu’ils ne sont pas assez beaux et qu’ils jouissent insuffisamment de la vie».
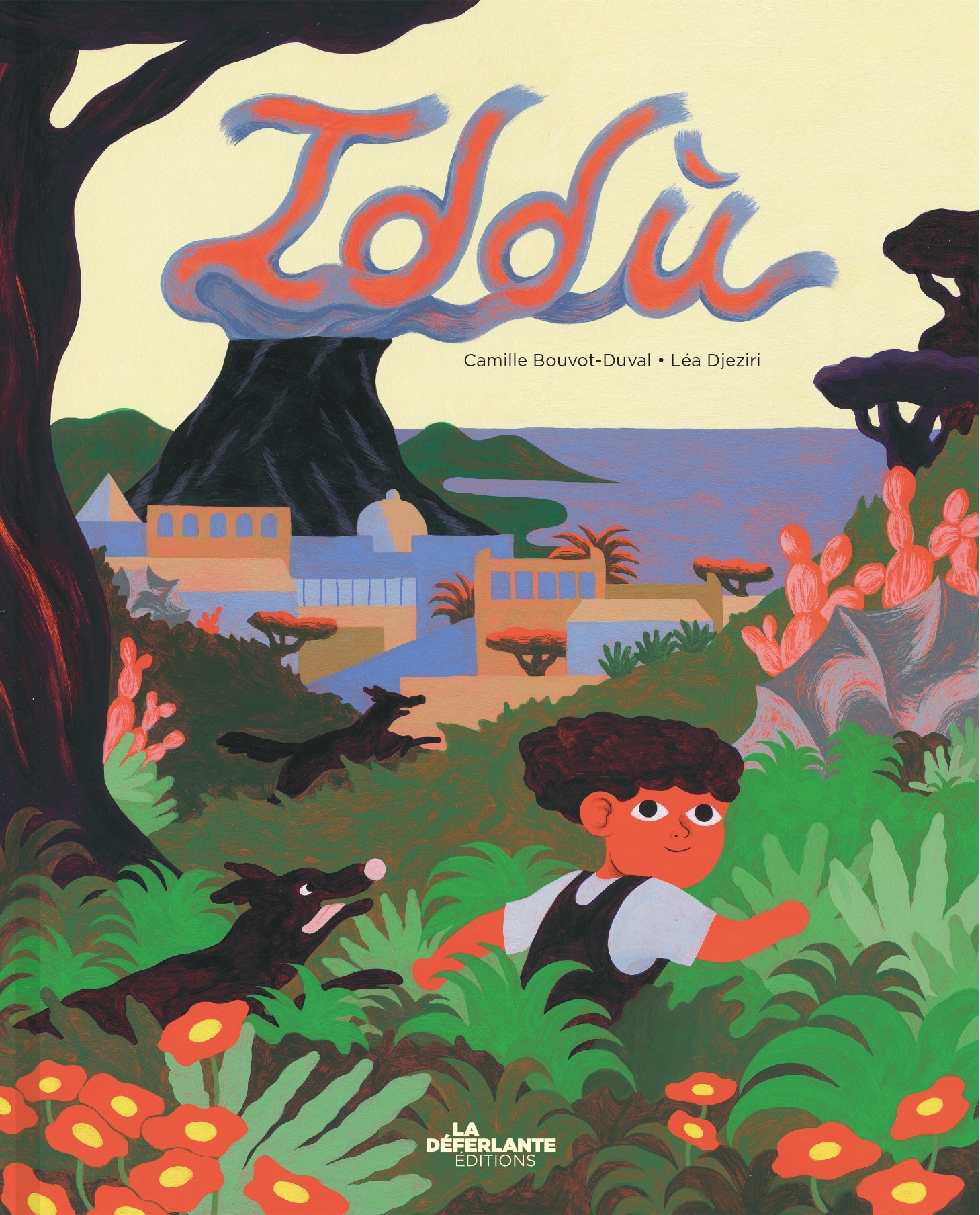
Iddù
De Camille Bouvot-Duval et Léa Djeziri
Editions La déferlante
Album jeunesse à partir de 6 ans
«C’est ce volcan : sa lumière passe à travers mes paupières, j’y vois comme les yeux ouverts».
Iddù, c’est le petit nom du Stromboli, cela veut dire «lui» en sicilien. C’est que pour les habitants de l’île, c’est plus qu’un volcan, c’est bel et bien un voisin, quelqu’un avec qui ils vivent au quotidien, selon ses «humeurs». Il est aussi surnommé le «phare de la Méditerranée» car ses éruptions régulières sont visibles de loin, surtout la nuit.
Dans ce conte écoféministe, Camille Bouvot-Duval et Léa Djeziri décident de faire du volcan un personnage central pour évoquer l’importance de vivre en harmonie avec la nature. Elles imaginent des adultes qui perdent le sommeil et décident qu’Iddù en est responsable. Un mouvement se crée «contre la nuisance volcanique» : «sa petite lumière brille d’un feu trop ardent !», «Nous allons éteindre le volcan ! ». Plus facile de trouver un coupable à leurs insomnies plutôt que de chercher les raisons intimes et profondes de ces nuits sans sommeil.
Face à cette révolte, il y a l’enfant Dodu et un cercle de femmes qui prennent soin de lui : l’agricultrice avec qui il aime cueillir des tomates dodues comme lui sur les flancs du volcan, la cheffe cuisinière, la voyante et la tatoueuse. Elles vont constituer une chaine de solidarité pour protéger à la fois les habitants et calmer Iddù.
Léa Djeziri a choisi, pour nous emporter sur cette terre tumultueuse, de jouer sur les contrastes : l’orange et le bleu surtout. Des superpositions de couleurs créant de la profondeur et des nuances sombres parfaites pour les nuits éclairées par Iddù. On sent la matière de la lave, des vagues aussi. Les yeux des personnages noirs comme du charbon nous transpercent.
Un album qui déborde d’une force vitale et communicative.
«Iddù mâche son chewing-gum de magma, s’étire sur l’asphalte, fait claquer des bulles jusqu’au ciel…»
- All
- Gallery Item
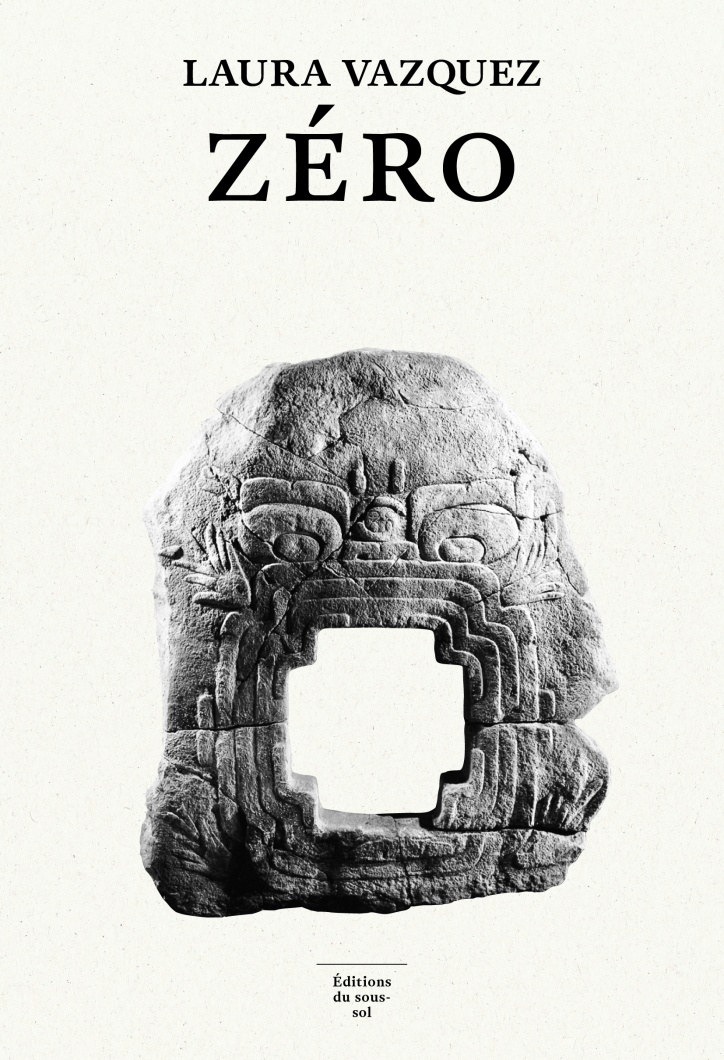
Zéro
de Laura Vazquez
Editions du sous-sol
A paraître le 7 novembre
«regarde
on dirait que le silence se déplace dans la lumière
regarde si tu te tais si je me tais
on dirait qu’il se déplace»
Une certaine impatience nous tenaillait depuis la sortie de son précédent livre, Le livre du large et du long, qui lui avait valu le Goncourt de la poésie. Depuis Laura Vazquez a été pensionnaire de la Villa Médicis, c’est de cet endroit qu’elle a écrit Zéro. Cette fois-ci une pièce de théâtre, à la forme très libre, telle qu’elle en a le secret. Une tragédie lesbienne versifiée en 5 actes. Une histoire d’amour, ce qui n »est pas sans nous rappeler le dernier Kae Tempest ; ces deux-là ont quelque chose à voir dans leur façon de travailler la langue, de travailler son flot, les mélanges de texture, l’anticonformisme en acte d’écriture.
Il y est question du désir de fusion de deux femmes, fusionner pour se confondre («au moment où ton ombre peut devenir mon ombre ton ombre n’est pas ton ombre») et comme pour mieux essayer de comprendre l’impossible du monde. Un texte où s’emmêlent des images qui vont et viennent : dans une baignoire, une mère en train de laver le corps mort de sa fille, peut-être aussi pour conjurer le fait que «parfois les gens ne se parlent plus parce qu’ils sont morts ce n’est pas rien». On retrouve donc cette obsession de la mort, de la douleur, des visages. Du pouvoir des mots aussi, «si je nomme le ciel je le tue, le ciel n’est pas le ciel, c’est forcément un autre ciel quand je dis ciel tu ne pense pas».
Un couple de femmes qui s’aiment tout autant qu’elles se disputent, se jalousent. Deux femmes, la mère et la fille. Deux femmes, les deux amoureuses, qui essaient de se mettre dans la tête l’une de l’autre («cette personne je l’aime tellement c’est comme si je disparaissais c’est comme si je n’étais plus moi»), de trouver dans l’Autre les réponses de tout : «à cause et pourquoi deux filles disent des mots comme à cause et pourquoi» ; «mais tu ne trouves pas que le malheur se colle au mot pourquoi le malheur et le mot pourquoi».
A chaque binôme son intensité de police d’écriture, d’un gris pâle à un noir prononcé. Une affaire de contraste et d’écart :
«il y avait un écart entre le monde et ma fille
et même entre le monde et le monde et les surfaces
des choses et les surfaces des choses».
Une écriture qui résiste de toute sa structure à ce qu’on lui attribue un sens, nous obligeant à lire et relire certains passages, à laisser tomber parfois, pour mieux y revenir ensuite. Une écriture qui se joue des formes, à l’instar d’un éclatement de lettres, «certaines lettres avaient besoin de compagnie», d’une juxtaposition de mots sans espacement, d’une disparition organisée de mots. A l’instar de la mère et de la fille, «on ne comprend pas toujours ce qu’elles disent les paroles des rides viennent peut-être par la mère et les rides parlent».
Les personnages sont poreux à l’état du monde, «ma fille avait ses désordres et les désordres de ma fille étaient les désordres du monde» ; «on pourrait croire que je pose mes sentiments sur les objets ou que mes sentiments se posent sur les objets».
Les majuscules et la ponctuation ont déserté, les didascalies sont enchâssées dans le texte l’air de rien. Le silence se diffuse et «les lombaires tiennent les corps». En lisant le texte on entend Laura Vazquez scander, psalmodier à sa façon si singulière. Ça fait partie aussi intégrante des images qu’on se fait du texte. Ça marche pleinement avec cet extrait où l’on entend la langue marteler, la rythmique se déployer, la magie de la répétition opérer :
«et le lendemain
le lendemain
c’est le lendemain
et le lendemain
fers merveille
la grêle la merveille
le crâne la merveille
et pourquoi la grêle si nous avons des crânes si fragiles
et simples
pourquoi simples
pourquoi des pierres merveilleuses».
Tout comme on s’imagine Laura Vazquez dessiner à l’envie des zéro, «si la ligne est parfaitement fermée on ne peut pas trouver le début ou la fin». On retrouve cette même continuité, notamment de forme, malgré les ruptures, «on marche on traverse les places les endroits mais c’est la même vallée la même plaine tu vois».
Du théâtre qui s’allie à une poésie de l’intranquillité, un brin dégénérée. Une nouvelle fois, brillant !
«le mot pourquoi est toujours en train de chercher
est-ce que ce ne serait pas le mot le plus seul du monde
le plus seul de la langue humaine
le plus entouré de silence»
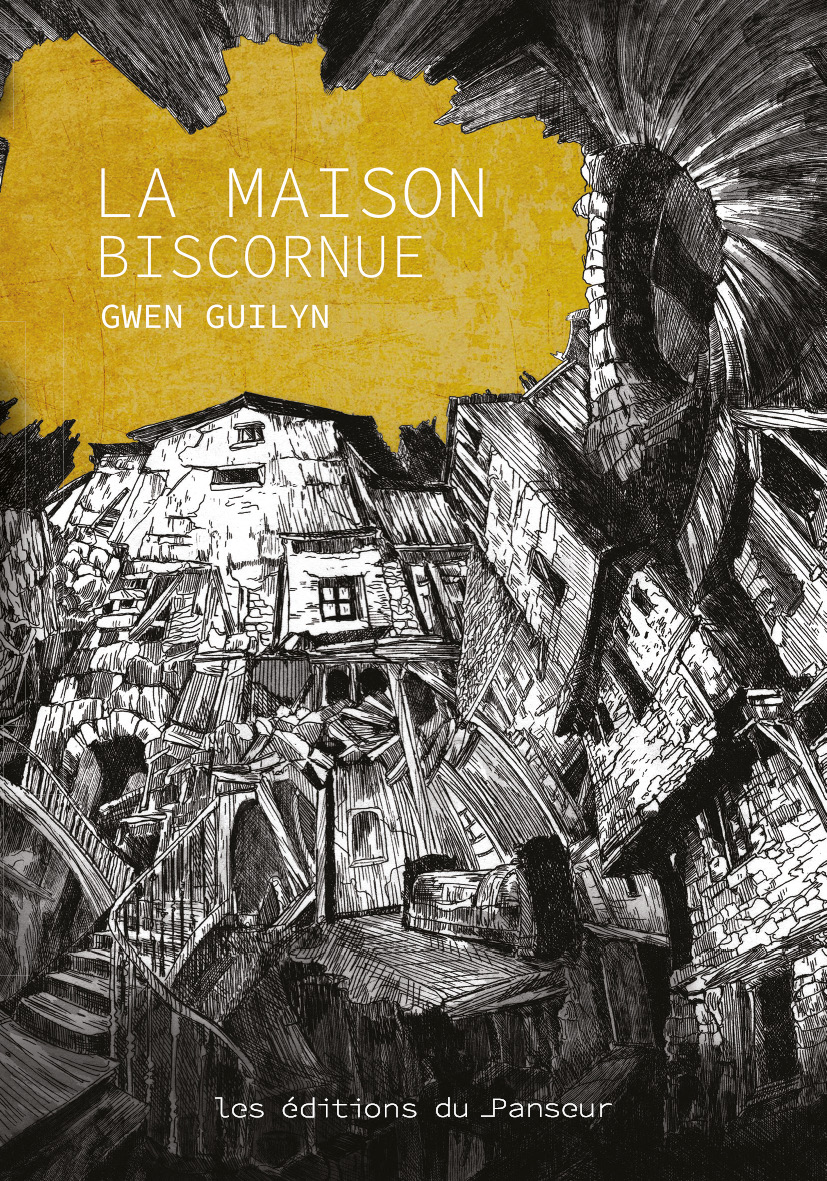
La maison biscornue
de Gwen Guilyn
Editions du Panseur
«Elle comprend plus ce qu’elle voit. Le couloir est à peine assez haut pour qu’elle passe à genoux, comme si la maison s’était tassée vers le milieu, et il s’est tournicoté de partout.»
Les Editions du Panseur ont pour habitude de proposer des couvertures monochromes recouvertes d’un extrait, donnant ainsi le ton et plongeant directement le lecteur dans l’histoire. Cette fois-ci, ils ont fait appel à Anouck Faure pour illustrer, admirablement, la couverture de La maison biscornue (cette artiste plasticienne et autrice sortira d’ailleurs chez Argyll un roman de littérature de l’imaginaire en janvier 2025, Aatea). L’illustration nous plonge radicalement dans la maison biscornue qui vient comme nous enserrer, nous aspirer. Rien de tel que cette vision pour démarrer cette histoire avant même d’ouvrir le livre. Nous sommes fin prêts à nous immiscer dans cet antre, mais pourra-t-on en sortir indemne ? C’est que Gwen Guily imagine un huis-clos aux allures cauchemardesques…
Il y a d’abord cette maison qui a perdu sa porte, qui se tord, se transforme au fil du temps. Des pièces disparaissent, des couloirs rapetissent, des escaliers s’aplatissent, des fenêtres s’obstruent. La maison, vivante, a mille voix, celles des ancêtres passés par là, la sienne aussi sans doute. Elle retient en son sein les membres d’une famille, ou du moins ce qu’il en reste : la Mahrgrand, l’Ongre, le Pahr, la Fille et l’Aut’ Fille. C’est que dehors, c’est dangereux, il y a des monstres, parait-il. A moins que la monstruosité soit déjà entrée dans la maison ? La Mahrgrand dirige ce petit monde à la baguette. Il n’est jamais question de s’arrêter, il y a toujours une tâche ménagère à accomplir ou un bout de jardin à désherber. L’Ongre, quant à lui rit, frappe et parle sans arrêt («brailler du rire tout le temps et cracher les phrases les unes après les autres encore et encore»), et tente de redresser la maison qui se « biscorne« toujours plus. Le Pahr n’est que l’ombre de lui-même, endeuillé par la disparition de P’tit Frahr il y a fort longtemps, esseulé depuis le départ de la Mahr puis de son Fils. Il est pas bon à grand-chose comme dirait la Mahrgrand. Et puis il y a les filles : la Fille qui entend toutes les voix de la maison et l’Aut’ Fille, qui elle n’entend rien et part le plus souvent dans ses rêves. Un jour, l’Ongre se fait mordre par la maison et tout cette vie qui n’allait déjà pas bien est comme aspirée dans un trou noir, dans un cauchemar.
Cette sensation de cauchemar est d’autant plus prégnante que Gwen Guilyn transforme non sans malice les mots pour leur donner encore plus de matière, de viscosité. Son écriture, comme la maison, tord, déforme, noircit, engloutit. Comme ces noms et adjectifs qui deviennent verbes : «ça la follait», «il peure que la maison s’écroule», «ça la triste», «la Fille voudrait larmer de nouveau».
Il y a dans ce roman, un peu de conte (on pense ici aux gravures des contes de Perrault réalisées par Gustave Doré), d’histoires d’épouvantes, de rêves transformés en cauchemars. Mais, comme dans un tableau de Soulages, du noir ressort toujours de la lumière.
Un livre frissonnant à souhait.
«Il peure tellement qu’il sait plus où il va. La maison, la Mahrgrand, l’Ongre, les Filles, tout est trop lourd pour lui. Il se sent plier. Et s’il plie, il casse.»
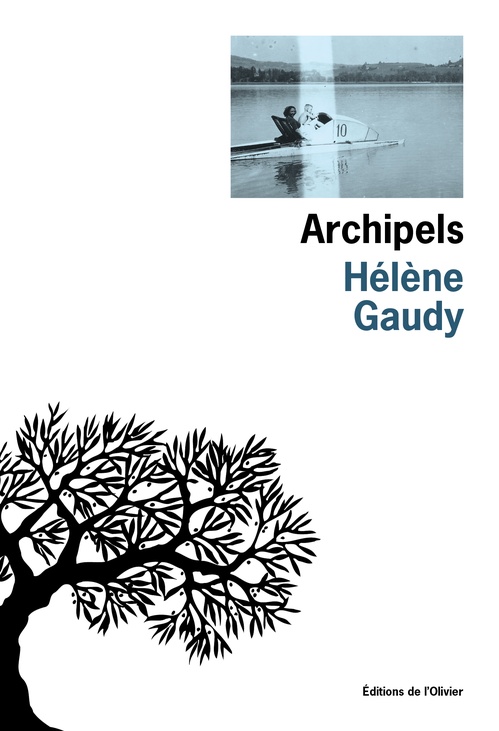
Archipels
d’Hélène Gaudy
Editions de l’Olivier
«Il est rare qu’un récit survienne au moment où l’on est prêt à l’entendre».
Hélène Gaudy nous entraîne avec Archipels dans un récit qui déploie une «enquête de proximité» sur son père d’abord, sur son grand-père ensuite, sur les liens, sur soi, sur cette mémoire familiale qui se dérobe. Par quoi nos souvenirs sont-ils constitués ?
Avec une île au loin, une île métaphore comme déclencheur, «chaque famille est une île, un écosystème, enrichi ou perturbé par les espèces invasives, une île dont le tréfonds repose au fond de l’eau». C’est d’abord à travers des lieux que s’organise la remise en ordre de la mémoire, à commencer par l’atelier de son père, à partir duquel elle le redécouvre. Ce n’est pas sans nous faire penser au très beau livre de Clémentine Mélois, Alors c’est bien. Pour atteindre le passé de son père, elle traque les traces laissées dans les strates d’objets, fétiches, babioles, ficelles, coffrets, carnets (il nous faudrait, dans ce lien aux traces et aux objets, aux objets «être vivants», à ces objets [qui] forment des familles», faire ici référence au livre de Gaëlle Obiégly, Sans valeur), sonde leurs origines, pour essayer d’entamer une partie du mystère que constitue notamment l’enfance de son père («son propre passé lui reste inaccessible»), cet endroit d’où il serait resté («le devoir de rester, toute sa vie, au seuil de son enfance comme d’un lieu où on a oublié quelque chose et qu’on ne peut quitter»). En exhumant et en se rattachant à cet ensemble hétéroclite d’objets, tels «un détour de mémoire», elle s’attaque «à l’amnésie qui couvre sa vie d’une couche si solide qu’on la prend pour une peau».
Alors que cet homme a été marqué par ses nombreux voyages, il est désormais comme insaisissable, toujours à côté, contraint par l’immobilité, comme tenu par cette accumulation d’objets. Car le père de la narratrice, à l’instar du grand-père de cette dernière, ne jette rien. «On passe des années à étaler de la peinture, à noircir des failles, à meubler nos intérieurs, et un jour, on se retrouve à dire à nos enfants qu’ils pourront tout jeter si nos vies les encombrent». Et au milieu de ce tropisme de collectionneur, d’archiviste, au milieu de ces réserves, de ces «remparts d’objets», affleure ici le syndrome de Diogène, «accumuler, c’est le contraire d’habiter. C’est combler le moindre espace vide jusqu’à s’exclure soi-même, jusqu’à se remplacer» ; «comme si la peur maladive que les choses se perdent avait fini par oeuvrer à leur enfouissement, à leur disparition». Cette famille, des logisticiens de la disparition-dissimulation.
L’entreprise initiale initiée par la narratrice tend à la dépasser : «je voulais fixer les points saillants, les détails, mais le dessin s’agrandit, des centaines et des centaines de points, comme les centaines de grains de beauté sur nos corps, que je ne sais plus comment relier». A défaut d’ordonnancer parfaitement les pièces du puzzle, à défaut de trouver l’assemblage possible de tous ces objets, laisser s’infiltrer les «souvenirs en sourdine», les habiter et relier les lieux : l’atelier, la maison des grands-parents près de la mer, le lieu tenu secret où ils habitaient pendant la Résistance. Comme si, appartenant à une lignée d’enfants uniques, les relations familiales agissaient différemment : «Peut-être est-ce pour cela qu’il me semble souvent que nous avons tous les quatre quelque part le même âge, un âge qui dépasse l’époque où se déroulent nos vies et nos différences, l’âge profond et seul des enfants uniques qui, à défaut des relations horizontales avec des frères et sœurs, en développent d’autres, verticales, droit vers les profondeurs. Nos mains plongent parfois au travers des eaux sur lesquelles les autres font la planche. Et la surface s’ouvre. Et le passé remonte».
Une écriture agissante qui restitue fort bien l’itinéraire parcouru dans la relation de l’autrice avec son père entre le début du récit et la fin, qui parvient à sonder les angles morts de son entreprise, «la vie commune rend myope (…) je suis trop près», et les projections qu’elle suscite, comme «la peur de découvrir à quel point nous sommes semblables». Hélène Gaudy à partir de la retranscription des coordonnées de cette rencontre tardive, fait montre d’un sens (dans la triple acception du terme : signification, sensibilité et direction) du récit remarquable.
Alors que lundi 4 novembre sera décerné le prix Goncourt, on croise fort les doigts pour que le nom d’Hélène Gaudy trouve une majorité de voix. Peut-être est-ce l’heure de reconsidérer le paysage littéraire au sens où l’autrice nous rappelle l’étymologie du mot paysage, pagere : ficher en terre une borne. En 2024, peut-être que certaines bornes érigées entre fiction et non-fiction n’ont plus autant lieu d’être. Il convient d’y voir le plus souvent une différence de degré plus que de nature. Et surtout, il convient de reconnaître la qualité d’un tel récit, qu’on l’appelle roman-enquête ou autrement : il est tellement bien écrit et tellement touchant.
«Que reste-t-il aux enfants de ces histoires à peine vécues par leurs parents, de cette électricité qui le parcourt, le soir, quand il est seul, et ne trouve au matin aucun corps conducteur ?»
- All
- Gallery Item
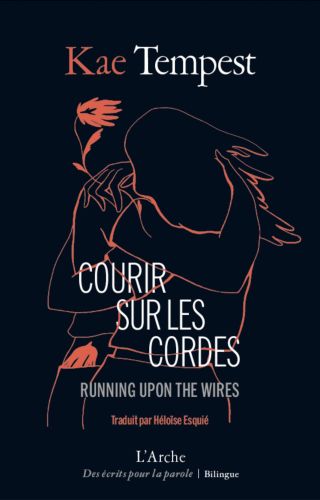
Courir sur les cordes – Running upon the wires
de Kae Tempest
traduit par Héloïse Esquié
Editions L’Arche
(Collection Des écrits pour la parole)
«Avec le temps ce sera comme si rien n’était arrivé
Avec la distance nos corps vont oublier
En attendant que l’eau chauffe, tout à coup être ramené.e.s en arrière
Et comprendre ce truc ce truc insondable qu’a dit l’autre»
A chacun de ses recueils, à chacun de ses concerts un émerveillement.
C’est peu dire qu’on accueille avec délectation ce nouveau recueil bilingue de cette figure majeure du spoken word. Le sujet (une histoire d’amour) paraît de prime abord peut-être moins incisif, moins baigné de cet art de revisiter les mythologies grecques. Mais Kae Tempest oblige, on se doit de suspendre tout jugement hâtif. Et en effet, suspendons-le.
Kae Tempest ne nous déclame pas cette histoire d’amour selon les codes usuels, c’est à rebours que l’histoire nous est présentée, comme nous le rappellent les trois parties, «la fin», «le milieu», «le début». Commencer par la fin, histoire d’amour qui finit mal comme dans la chanson («rien ne dure dit la vague tombée»), et zigazaguer dans l’intensité de cette histoire d’amour.
Ça claque de nouveau, ça relie comme on aime l’intime à l’universel.
On passe tour à tour des thèmes de la perte et de la rupture («Je te cherche mais tu as disparu» ; «Presque sûr.e que mon cœur est perdu» ; «seul.e à nouveau»), de l’espoir qui résiste («Y’a un truc bloqué en moi, un truc qui croit toujours que tu m’as pas quitté.e, un truc qui lâchera pas le rebord qu’il cramponne»), du souvenir ému («je vois la forme de ton corps dans la moindre branche d’arbre, un bol de céréales, une cruche d’eau, je te vois dans le bois flotté, la statue taguée, le toit de la gare» ; «attiré.e par un truc indicible dans une chanson»). Mais aussi de la mise à distance («trois mois sans contact») dans une forme de bulle hermétique («j’entends des cris par la fenêtre ouverte – ça me fait un choc de me rappeler que les autres existent»), de l’admiration-vénération («Je psalmodiais ton prénom je te prenais pour une divinité» ; «elle dirige le monde entier le fait tourner» ; «Et toutes les forêts sont elle, et toutes les racines, Et toutes les vallées sa voix, et toutes les comètes» ; « Le monde entier n’est qu’une mauvaise blague, une blague tordue sur ta beauté»), de la complicité («j’apprends à reconnaître chaque note sur la partition de ton silence») au rapprochement fusionnel («Notre feu rugissait avec une formidable autorité, Et il illuminait ce paysage lamentable» ; «Le matin je t’enfile avec mes chaussettes»). De la force d’aimantation de l’Autre («Et ton corps penche vers moi en tous points, comme il fait quand tu es heureuse avec moi» ; «Ses courbes sont mon seul horizon»), au tropisme de la possession («Son sourire c’était le ciel, sauf qu’il était à moi»).
Kae Tempest reprend la grammaire de l’amour dans une forme revisitée des Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes façon XXIème siècle, si ce n’est que si les fragments sont là, de discours il n’en est point. C’est du spoken word tout en ressenti, empreint de lyrisme intime.
Kae Tempest joue avec les courbes d’intensité, célèbre les courbes de la sensualité aussi, «les motifs apparaissent, réapparaissent». Iel compose une géographie de l’Amour qui s’ancre dans le nuancier de son expérience vécue. Cet amour grouille d’ardeur. Puissamment.
«Yes, we do repeat. Motifs
occur again, again
This does not mean
we are not new
You are not her.
This is not then
(Running upon the wires)»

La mer intérieure. En quête d'un paysage effacé
de Lucie Taïeb
Editions Flammarion
(Collection Terra Incognita)
«On sait qu’il faut, aux corps, donner sépulture, mais que faire d’un village rasé ?»
De Lucie Taïeb, nous avions beaucoup apprécié Freshkills, Recycler la terre (ed. La Contre Allée puis chez Pocket) , mais aussi Capitaine Vertu (ed. De l’Ogre) et plus dernièrement sa traduction de Printemps sombre d’Unica Zürn avec sa postface très éclairante.
Cette fois-ci on retrouve Lucie Taïeb avec un récit documentaire qui emprunte de nouveau à plusieurs genres et qui va prendre la forme d’une déambulation dans un récit très personnel, avec une incarnation de figures proches (mère, grand-mère, …) qui viennent comme s’incruster dans le récit.
Lucie Taïeb va s’intéresser à des villages sorabes (Cottbus, Lacoma et Horo principalement) situés dans la région de la Lusace dans l’ex-Allemagne de l’Est, au bord de la Spree, quelques villages qui ont été rasés, effacés pour les besoins de l’exploitation de mines de lignite (pour les besoins notamment de la centrale thermique située à quelques kilomètres) ; lieux finissant par devenir à l’arrêt d’exploitation de la mine de véritables no man’s land, avant d’être transformés en lac. Et une mise en abîme opère : se questionner sur la maison des autres, c’est aussi parler de la maison de son enfance à soi, «abandonnée aux ronces et aux intrus» et qui finira par brûler. Jusqu’au questionnement vertigineux : «Au-delà de quelle frontière commence le déracinement ?»
Sur le terrain ou à distance, Lucie Taïeb fait un véritable travail de recherche, à scruter les archives («l’Archive des villages disparus»), à explorer les récits alternatifs, à sonder les projets de renaturation, l’attachement au lieu (- «la questionne serait donc pas, après la perte, de trouver quelque chose qui ressemble ou rappelle ce que l’on a perdu, mais celle des conditions nécessaires à recréer un attachement, une curiosité, un désir» – dans le cadre d’une pensée très latourienne), la recréation ex-nihilo de villages «clonés», les batailles juridiques qui ont eu cours, à l’écoute des témoignages d’habitants déplacés (les époux Domain), du storytelling des compagnies à la manœuvre, des traces laissées.
Elle en arrive à considérer que «ce qui a été détruit ne peut être restauré ni remplacé. Ce n’est pas céder à une mélancolie excessive, mais seulement tenter d’imaginer une fidélité aux lieux, un attachement, que d’affirmer : l’irrémédiable existe». Pour situer ce caractère irrémédiable, Lucie Taïeb convoque le livre d’Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas où il est demandé à ce que le prince qui a usé deux chevaux puisse les restituer intacts, tels qu’ils étaient avant qu’ils ne soient saccagés. De la même façon, les archives retrouvées sont éprouvées et confrontées à l’aulne des propres souvenirs de l’autrice et notamment de présences inquiétantes, spectrales, des silhouettes mystérieuses. Ainsi chemin faisant, à partir de son terrain initial se tissent des ramifications avec la vie de l’autrice.
En rendant compte des luttes qui ont émaillé ce territoire, l’autrice évoque aussi la lutte qui a été celle, dix-neuf ans durant, de sa mère face à un cancer. Et d’insister sur l’importance d’apprendre de ces luttes.
Lucie Taïeb est invitée à une fête commémorative, mais une fois sur place, elle renonce finalement, «comme s’il pouvait y avoir quelque chose de plus intéressant ou de plus juste dans le fait de ne pas y aller», cela la renvoyant à d’autres situations vécues, amoureuses notamment, où elle s’est comme dérobée à elle-même ou à la situation. Pas vraiment de dérobade à dire vrai, mais une sorte de réserve d’inquiétude chevillée au corps, comme si elle ne pouvait parfaitement correspondre, «coïncider» avec celle qu’on attendait, avec ce qui était attendu («le protocole m’a échappé»). «Mon identité se dissipe dans l’intensité de mon regard vers l’extérieur, de mon écoute, et lorsque je reviens vers moi, il me paraît étrange de devoir répondre de quelqu’un que je suis si peu»
A la lecture de ce livre, on pense beaucoup, de par l’évocation des mines et de leurs conséquences sur les paysages, les gens qui habitent ces territoires troués, à Amiante de Sébastien Dulude (ed. La Peuplade), à Kiruna de Maylis de Kerangal (ed La Contre Allée) mais aussi, s’agissant des logiques à l’oeuvre dans la disparition de certains lieux, à Inventaire des choses perdues de Judith Schalansky (éditions Ypsilon).
Un livre où Lucie Taïeb parvient superbement à «trouver des espaces et des temps où déposer le masque». Une écriture au bord de l’abîme, d’une grande sincérité.
«Lacoma. Morne lac.
Je ne sais pas ce qu’est un lac (mais ce n’est pas cela).
Je ne sais pas ce qu’est un sol (mais ce n’est pas cela).
Je ne sais pas ce que je vois : il faut l’écrire»
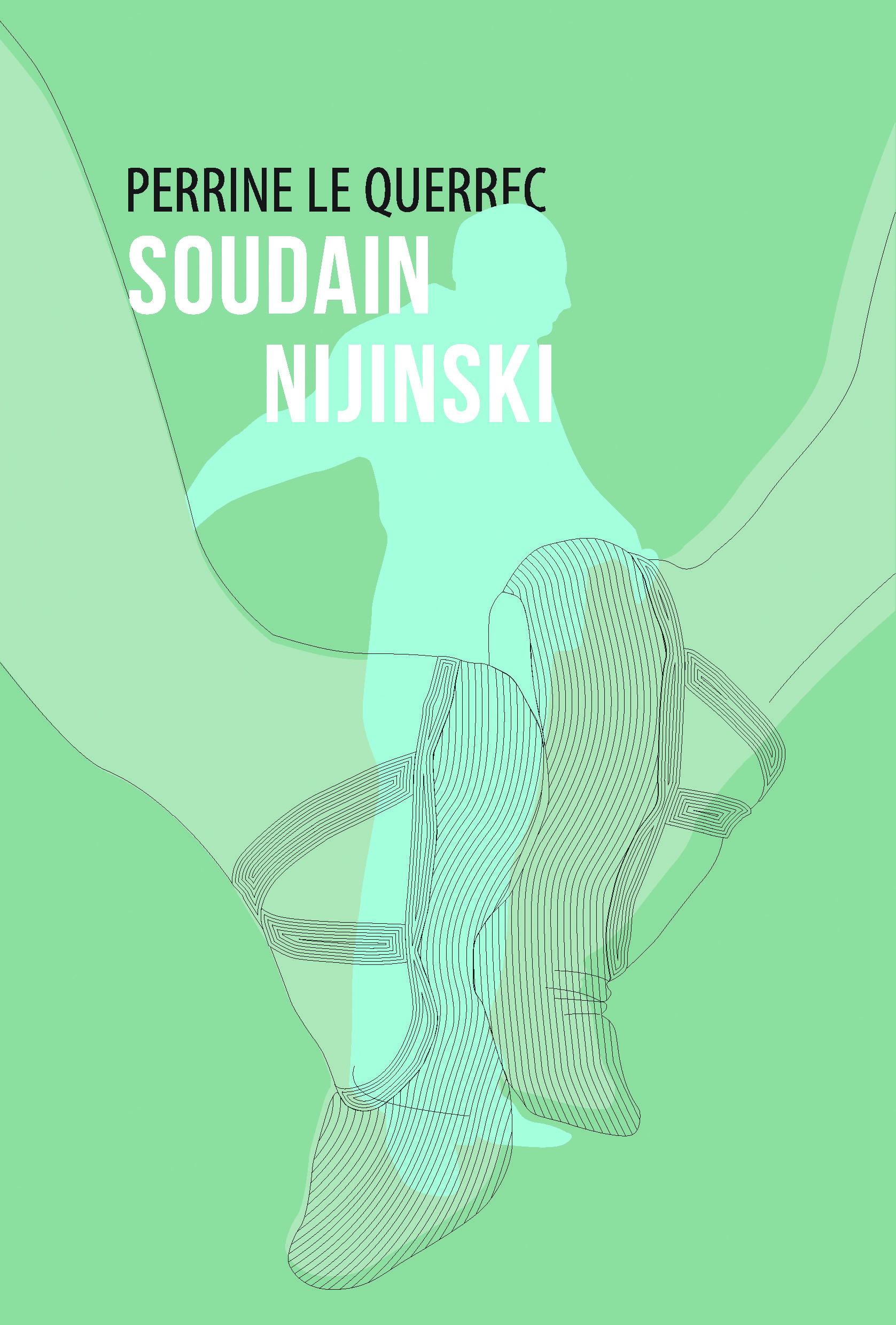
Soudain Nijinski
de Perrine Le Querrec
Editions La Contre Allée
(Collection La Sentinelle)
«Après l’expérience du mouvement qu’il a menée jusqu’à son terme, avec son génie de l’excellence et de la créativité le voilà le danseur dans l’expérience de l’immobilité.»
De Vaslav Nijinski on connait le nom. Pour peu qu’on s’intéresse un peu à la danse, on l’associe à la virtuosité de la danse classique, aux ballets russes du début du 20ème siècle. Peut-être aussi au scandale de l’Après-midi d’un Faune ou du Sacre du Printemps de Stravinski. Et puis, en 1919, tout s’arrête. Ou plutôt, sa carrière de danseur s’arrête. Un mythe est né. Généralement on n’en sait pas bien plus.
Mais Perrine Le Querrec ne s’arrête pas à cet aspect de Nijinski, elle s’intéresse au contraire surtout à ce qu’on ne connait pas ou peu de lui. Elle s’appuie alors sur son expérience d’archiviste pour aller, pendant 7 ans, chercher, creuser, fouiller, compiler des informations et ainsi tenter de reconstituer l’après, combler des blancs, saisir l’état de cet homme, dans ses silences, son immobilité et ses états psychiques. «Sept années de recherches, de découvertes, de déceptions, de bouleversements.»
Elle nous partage la fulgurance de la danse de cet homme hors du commun, les louanges qu’il a pu recevoir («Et un soir il conquit Paris. Dès son apparition. Nijinski danseur étoile. Paris défile autour de lui.»), mais aussi les critiques les plus acerbes («de justes sifflets ont accueilli la pantomime trop expressive de ce corps de bête mal construit, hideux de face, encore plus hideux de profil»), face à une incarnation de la danse qui vient déranger, heurter, peut-être toucher trop fortement le spectateur. «Qui entre en danse entre en transe entre dans la procession du diable entre en possession»
Perrine Le Querrec passe aussi derrière le rideau, et nous découvrons alors les fêlures présentes dès l’enfance, les accidents de la vie («l’enfant innocent condamné à la noyade, le père immobile devant la Neva où s’enfonce le petit Vaslav», «Stanislas [son frère] grimpe sur le rebord de la fenêtre», «il y a l’histoire du pupitre à musique», «il y a [aussi] l’histoire du mariage. Romola de Pulszky, la groupie, arrive à ses fins.»), la manipulation des personnes qui l’entourent (le prince Lvov, le chorégraphe Diaghilev – «un corps sur lequel les mots Désir et Possession et Sexe et Assaut et Consommation se plantent»), jusqu’à sa femme qui ne supporte pas son état de folie et va jusqu’à orchestrer son ultime saut.
Et Nijinski s’arrête de danser, alors Perrine Le Querrec s’intéresse à ses écrits (sa notation de la danse et ses cahiers) et nous fait ressentir son état lors de ses 30 années d’errance entre différents asiles d’aliénés, passant dans les mains des éminents spécialistes de l’époque, subissant jusqu’à 228 chocs d’insuline. L’écriture de Perrine Le Querrec donne forme à cet état fait d’immobilité, de folie et de danse intérieure. Il y a les saccades, les répétitions, les silences, les respirations et les apnées, les envolées, la souffrance, le bouillonnement intérieur.
Ce livre c’est une rencontre entre le lecteur et Nijinski, entre Perrine Le Querrec et Nijinski («autant d’interprétations, autant de pas vers lui, mon Nijinski»).
«Nijinski-le-faune, Nijinski-le-spectre, Nijinski-le-pantin, Nijinski est, Nijinski sait, sa tête penchée sous le poids des cornes invisibles, force pure, il ne fait pas «le faune», «le fou», il devient, totalement.»
Elaine
- All
- Gallery Item

Le plancher
de Perrine Le Querrec
Editions La Contre Allée
sortie le 18 octobre 2024
«Alexandre, Joséphine, Paule, Simone et Jeannot : il y avait une histoire où les parents étaient heureux et Paule, Simone et Jeannot trois enfants gais et insouciants. Mais on n’était pas dans cette histoire-là».
Perrine Le Querrec n’aime rien tend que s’attacher follement à des personnages, des personnages tout en singularité, qu’il s’agisse de personnage de fiction à l’instar de Jeanne L’Etang ou qu’ils aient existé, pensons à Hannah Hoch, à Unica Zürn ou encore aux Tondues, aux victimes des « tournantes de Fontenay » pour n’en citer que quelques-unes.
Jean Crampilh-Broucaret (1939-1972) dit Jeannot fait partie de ceux-là. Sa vie reste marquée par un père mort par pendaison et la claustration qui va s’ensuivre et le faire rester à l’écart du monde réel, avec sa sœur Paule et sa mère Joséphine, avant que cette dernière ne décède et soit enterrée à l’intérieur de leur maison. Un drame familial matérialisé par une inscription épigraphique que va s’acharner à écrire Jeannot à même le plancher. Ce texte gravé par Jeannot, pour lequel on bute encore quant à l’attribution d’un sens, sera retrouvé en 1993 par un psychiatre de Pau. Le plancher de Jeannot, considéré comme une oeuvre d’art brut, peut être observé dans le cadre d’une exposition portée par le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA)* et ce jusqu’au 27 avril 2025.
Perrine Le Querrec revient sur cette histoire de famille qui tourne mal, épouvantable. Avec elle, on marche en permanence sur le chemin de crête de la folie. Tous les ingrédients de l’abîme sont là pour que les protagonistes s’y précipitent : leur ferme, véritable citadelle assiégée, est située dans un village, les Deux-cents, «qui complote et murmure à leur passage», entre les membres de la famille refermés les uns sur les autres le silence règne («un enfer qu’on porte mais qu’on ne prononce pas»), les lieux sont truffés d’ennemis intérieurs, d’esprits mauvais et une antenne-relais qui envoie ses mauvaises ondes, l’humeur de Josephine qui «bascule», les parents qui sont en désaccord permanent, Simone l’une des filles qui s’extrait du giron familial, et le père qui brutalise, qui ferme les portes de l’enseignement à son fils, qui commet un inceste sur sa fille aînée et qui donnera l’EnfantX. «Ce n’est pas un père, juste une forme de violence ; Ce n’est pas une mère, juste une forme d’indifférence ; Ce n’est pas une famille, juste une forme de récit ; Ce n’est pas eux, juste une forme de silence (…) Une longue cohabitation avec l’inhabitable».
Jeannot, et sa souffrance rentrée, se construit dans ces impossibilités de relation : «Le temps du désespoir court jusqu’à l’horizon, effondre la terre à ses pieds, s’accroche aux cimes, se pend à l’écorce des arbres. Jeannot avance à travers les arbres». Même sa Destinée (petite-amie) se dérobe. Provisoirement c’est sa participation à la guerre d’Algérie qui lui permettra de se mettre à distance de la pétaudière familiale. C’est le suicide par pendaison de son père qui le fera revenir précipitamment, «se précipite[r] dans l’inexistence», revenir sur un autre champ de batailles. Chacun des trois survivants poursuit son fantôme. «Ils sont rayés de la carte des vivants ; Ils sont effacés du planisphère ; Ils sont barrés des registres; Ils sont oubliés de leur nuit». Et quand la mère décède, Jeannot et Paule deviennent le sosie l’un de l’autre («ils ont le même visage, la même voix, le même langage, la même histoire»), «prisonniers du bagne familial, aliénés dans l’asile commun». Ils laissent tout à l’abandon, «ronces et chiendent terminent leur course dans la maison». Avant que Jeannot ne s’investisse de tout son corps sur le plancher, le plancher devient le soliloque de Jean, «son radeau de bois». «Mains-mâchoires édentées à force de gueuler, creuser, graver». «Dire, creuser-dire, forcer-dire, taper-dire, fou-dire».
«Si Jeannot le veut, bois devient papier. Voici venu le moment de dire. Voici venu le temps d’écrire.
Le plancher
Dur
Stable
Il est là
Il accueille, ranime, offre son espace
Réel
Habité
Habitable»
La langue de Perrine Le Querrec est de celles qui savent creuser, marteler, se réinventer, les mots en jaillissent, viennent cogner. Celle qui se soucie remarquablement bien des trous et des points de suspension dans les récits, dans les psychés, sans jamais refermer complètement les choses («une suite à imaginer. Une fin suspendue»). Une écriture qui prend au sérieux le «fond des formes» du délire. La marque de fabrique d’un livre qui marque.
Ce texte si singulier nous fait penser à La décharge de Béatrix Beck, de par le côté « dysfonctionnel » de la famille où l’inceste et la mort se côtoient également ou encore à Zizi Cabane de Bérangère Cournut plus pour l’aspect complètement dévasté de la maison (une maison qui «rend ses entrailles») où la nature reprend tout petit à petit, et pour la confusion des places, et le caractère «abandonnés» des membre de la famille Ferment, avec de la même façon une mère étrangère à elle-même au mari, aux enfants ; ceux-là même qui se demandent de la même façon «où pouvons-nous blottir nos enfances ? Où sont les bras de nos parents ?»
C’est profond, troublant et ça secoue fort. On adore. Tellement.
«Allongé dans ma litière de copeaux je touche les lettres, je sais ce que je dis. Je dis ce que j’ai vu. Je dis que ma rétine, ma vue, mon œil et les images. Je dis les abus. Je dis noir sur noir. Je dis et je ne vacille pas. Je dis ce qu’ils m’ont raconté. Leurs interdits. Je dis à leur place, je dis à leur faute, je dis à leur face, je dis à leur tête ? Je dis ma puissance. C’est à vous de me regarder maintenant».
*cf.https://musee.mahhsa.fr/accueil-mahhsa/programmation-culturelle/

Ce que j'ai vu, entendu, appris...
de Giorgio Agamben
traduction de l’italien par Martin Rueff
Editions NOUS
«Comme si au centre de tout ce que j’ai essayé de vivre et d’écrire il y avait un instant, un quart de seconde, parfaitement vide, parfaitement invivable».
Giorgio Agamben figure certainement parmi les plus grands philosophes contemporains, grand spécialiste de Walter Benjamin, d’Heidegger ou encore de Michel Foucault, mais ce n’est pas ici avec un nouvel essai que l’on va à sa rencontre. On se situe plutôt entre Pensées pour moi-même de Marc Aurèle ou Signes au bord du chemin d’Ivo Andric, ou encore ce petit texte infiniment sensible d’Etel Adnan, Déplacer le silence.
On y retrouve trace de ses préoccupations philosophiques, de la théologie à l’histoire de l’art en passant par le langage. Et une grande sincérité, dans cette écriture «à la hâte», celle qui caractérise nos existences lorsque le crépuscule menace. Celle-là même que Giorgio Agamben évoque dans la deuxième partie du livre «Ce que je n’ai pas vu, entendu, appris…», cette petite feuille sur laquelle il a écrit quelques mots encore enfant et que sa mère lui présente tardivement et qui «contenait la description exacte de ce qui m’apparaissait alors comme le secret de ma pensée».
Agamben écrit avec ce qu’il y a de plus personnel, convoquant ici des souvenirs, là des réflexions. Ces courts textes, pareils à des miscellanées, agissent tels des repères existentiels, des formes de leçons de vie testamentaires et dont le lecteur serait désigné comme potentiel héritier.
Agamben enracine ses réflexions sur des terres qu’il a foulées, de l’Italie, à la Turquie en passant par l’Allemagne, la France et l’Inde. Il enroule ses cogitations dans une pensée qui l’a précédé, quelques philosophes (Bachelard, Spinoza, Erigène, Averroès, Épicure, Lucrèce, Platon) poètes ou écrivains (Kavafis, Homère, Kafka, Anna Maria Ortese) jusqu’au marionnettiste Bruno Leone.
A partir de cette constellation de lieux et d’auteurs, de ses sensations qui l’ont traversées, il rend compte de sa vision de l’intimité, des couleurs, du bonheur, de la contemplation, de l’imagination, de la parole, de l’exil, du mythe, de la fiction. Et à travers ces notions, c’est toute une vie qui défile, dans cette «sensation simple et quotidienne d’exister». Comme s’il était écrit, saisi par ce nuage de mots.
On retrouve une pensée qui s’intéresse aux «intermédiaires», aux «interstices», qui se déploie dans «la capacité à habiter non pas la maison, mais le seuil, non pas le centre mais la marge».
Un petit livre qui rappelle combien Agamben participe à «l’intensification politique de la langue». Il témoigne de cette tentative de se rapprocher de ce qu’il estime être un non-secret, à savoir, «une complication qui s’explique et une explication qui se complique et s’enveloppe en soi-même».
Aussi concis que percutant.
«Tout se passe comme quand nous voulons nous rendre à tout prix quelque part et que, par la suite, sur la route, en cheminant, et en vivant, nous avons oublié où.»

Nos lèvres disparaissent
de Geneviève Peigné
Editions des Lisières
« Il était une fois une maladie cachée. Taboue. Elle n’avait acquis un nom qu’à la toute fin du XIXème siècle. Comme tant d’autres pathologies, pourtant, devait-elle exister depuis ce qu’on appelle commodément la nuit des temps… »
Cette maladie, c’est le lichen scléreux. Si vous cherchez sur wikipédia, vous trouverez cette définition : « Le lichen scléroatrophique (LSA) ou lichen scléreux, également dénommé balanite scléreuse oblitérante lorsqu’il affecte le pénis, est une maladie chronique de la peau et des muqueuses touchant principalement les zones génitales de l’homme et de la femme. Il peut apparaître à tout âge mais surtout après la ménopause, et n’est pas contagieux. À ce jour, la cause de cette maladie n’est pas connue. » Si vous demandez autour de vous qui connait cette maladie, il est fort probable que personne n’en ait entendu parler. Si vous demandez à votre généraliste, il est également possible qu’il ne soit pas très au clair sur cette maladie. Et si, malheureusement vous êtes atteinte de LSA, on risque de vous promener entre dermatologue et gynécologue et le diagnostic sera sans doute lent et hasardeux. Car cette maladie est encore trop peu connue. Cela fait penser à une autre maladie, l’endométriose, qui sort enfin du silence mais est encore mal comprise et mal diagnostiquée.
Alors, forcément, ce témoignage polyphonique de Geneviève Peigné, fait œuvre d’utilité publique. Mais pas seulement, car il s’agit bel et bien d’une œuvre littéraire, mêlant des passages qui pourraient être tirés d’un journal de bord (daté du mardi 2 octobre 2012 au lundi 4 janvier 2021), des considérations sur la maladie, le corps médical, son propre corps, les relations intimes, la culpabilité, une réinterprétation de Barbe Bleue, et bien sûr des témoignages de femmes atteintes du LS.
Qu’on soit atteinte ou non de cette maladie, cette lecture reste et fait réfléchir, interroge sur ce qu’on dit ou passe sous silence, ce qu’on peut réellement comprendre de l’autre (comment appréhender par exemple la douleur de l’autre, ses sensations alors que les mots sont si pauvres et insuffisants pour cela ?). Geneviève Peigné met aussi en lumière la force du collectif, la nécessité de ces groupes de pairs pour supporter, accepter,vivre avec la maladie. « Mais maintenant, vous prenez d’abord du temps pour vous-même. Sachant que tu n’es pas seule avec LS. » Car c’est dans ces espaces-là que s’élaborent et s’éprouvent des formes d’expertise d’usage partagée.
Il s’agit aussi de l’intime, et l’autrice en parle sans tabou. Comment continuer à avoir du plaisir ? Est-il possible / sera-t-il toujours possible d’avoir des relations sexuelles ? Comment en parler à son/sa partenaire ? « L’objectif est de faire le point sur la nouvelle réalité provoquée par la maladie, sur les possibilités de maintenir l’ouverture du vagin, sur l’amour autrement. »
Geneviève Peigné a su trouver la forme qui permet de servir le sujet traité.
Comme le bandeau l’indique, on a affaire à un tabou à lever et pour ce faire, ce livre a besoin de votre soutien.
« Les maladies ignorées, tues, ne le sont jamais par hasard. La mythique libération sexuelle n’admet que l’invulnérabilité mâle et la disponibilité du féminin. La société doit se soigner. »
Elaine
- All
- Gallery Item

Les terroiristes ou le clan de Très Cantous
d’Aurélie Soubiran,
Editions de l’épure
«Comment le nom de Plageols devient-il soudain l’une des perles d’un collier de figures incontournables pour qui veut comprendre une époque fondamentale de la construction du vin tel qu’on le boit aujourd’hui ? »
A la rencontre d’un clan de vignerons, du côté de Cahuzac, entre Gaillac et Albi, non loin de Castelsarrasin et de Cordes-sur-Ciel. C’est qu’ici la géographie a son importance, il y est question de terroir. De terroir et d’une famille, les Plageoles. J’ai nommé Robert le grand-père, Bernard l’un des trois fils, et son épouse Myriam et leurs deux enfants, Romain et Florent. Rendre compte de ce clan.
Voilà l’entreprise à laquelle se livre Aurélie Soubiran, dans un texte hybride, de par la pluralité des matériaux compulsés : extraits d’entretiens, photos, en passant par des extraits de journal de bord, d’observations, d’archives. Elle enchâsse dans ce texte des indications sur comment elle s’est employée pour raconter cette histoire (avec son lot de découragement, et d’excitation propre à cette démarche que l’autrice qualifie d’ «autruispection»).
Chacun des protagonistes de cette saga familiale s’inscrit à la fois dans une forme de continuation et d’innovation par rapport à la génération précédente. Chacun à sa façon. «Ce qui émerge en creux, c’est la complémentarité des générations : Robert l’érudit, le frustré des grandes études, satisfait de plus en plus son appétit de connaissance, de lecture et d’écriture, quand Bernard l’amoureux du geste et du lieu, le vigneron dans l’âme, transforme l’essai en réalité» ; «La notoriété des vins, l’aura du domaine Plageoles, c’est une toile tissée à plusieurs mains, c’est un feu ravivé par plusieurs souffles».
Robert s’illustre par son érudition fait figure de référent, s’est fait une notoriété par la mise en place d’un conservatoire de vignes oubliées et en valorisant les cépages autochtones de Gaillac. C’est dans cet enchainement que va naitre la cuvée Terroirist, dont l’étiquette deviendra le logo du domaine. Bernard qui commence par voyager et cotoyer les milieux libertaires avant de s’ancrer au bercail avec Myriam (dont une partie du travail restera longtemps invisibilisé), lesquels vont professionnaliser le domaine. Il lui faudra malicieusement concevoir une étiquette frondeuse «Bernard Plageoles et père» pour disputer la mainmise de son père. «Ce n’est pas tellement que j’avais envie de faire mon vin pour exister, mais mon père prenait une telle place… C’était soit l’un, soit l’autre».
Un récit tout en sensibilité qui nous fait côtoyer l’intime (les affaires de famille où se déploie un conflit d’ego, la part d’ombre du patriarche). L’autrice cartographie les différents lieux, salons ou autres entités vigneronnes, les différentes rencontres et les «amis inspirants» (Véronique Cochran, Michèle Aubéry, Marcel Lapierre, Jérôme Galaup, Sébastien Bras), les intuitions (le pouvoir d’attraction des cépages autochtones), les moments de prise de conscience (quand une tentative d’introduction de produits phytosanitaires d’apparence «magique» vient contrarier la transformation du jus en vin) et les articles ou reportages qui ont compté (Routard, Envoyé Spécial, un papier dans la Revue du Vin de France). Par ces évocations, et c’est d’ailleurs l’un des grands intérêts de la démarche présentée, l’autrice parvient à recomposer la densité des relations amicales, d’associations de vignerons sans lesquels le domaine et la légende Plageoles ne seraient pas ce qu’ils sont. «Au-delà de la nature du projet, je prends peu à peu conscience de l’interrelation entre les rencontres, la notoriété croissante et le feu de la passion : tout se nourrit et se tient, tout est entremêlé».
C’est aussi un magnifique livre sur comment s’opère, parfois avec difficulté, la question de la transmission, de la capacité à faire confiance entre générations d’une même famille. Entre succession, transition et ego : «Le vigneron œuvre pour le temps long,les vignes lui survivront, les vins aussi pour certains. Comment accepter de ne plus être au cœur de l’arène, alors que la lumière est enfin sur soi ? Comment ne pas céder à la tentation de faire soi-même, quand des décennies d’expérience vous soufflent la solution sur laquelle tâtonne votre progéniture ? »
On apprend plein de choses à la lecture de ce livre : ce à quoi consiste l’ampélographie, la complantation. Le rythme du livre, favorisé par cette variation successive de points de vue structurée en trois parties, est tout à fait prenant et lorsqu’on est parvenu à son terme on est tout à fait acquis à «cette joie intime de l’écriture qui dit l’autre».
«Mais s’il y a du sauvignon partout, s’il y a du gamay partout, à un moment ça va coincer. Pourquoi nous, on ne travaillerait pas nos vieilles variétés ?»
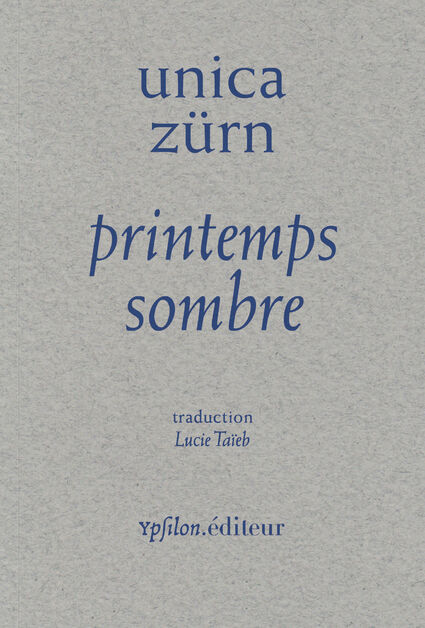
Printemps sombre
d’Unica Zürn
traduit de l’allemand par Lucie Taïeb
Editions Ypsilon
«La vie uniforme et préservée, au sein de la famille, est depuis longtemps ennuyeuse, et tout est permis pour que l’excitation reste intense. La vie est insupportable sans le malheur».
Un petit texte considéré comme un livre culte. L’appel à s’en saisir ne se refuse donc pas. Merci aux éditions Ypsilon de le ressortir (initialement publié en 1969) avec une nouvelle traduction impeccablement servie par Lucie Taïeb. Je devrais dire, tel que je le conçois, que le fait que ce soit Lucie Taïeb qui en signe la traduction renforce la désirabilité de ce texte.
On y retrouve les souvenirs d’enfance d’une jeune berlinoise délaissée par ses parents, ballottée entre «la force d’attraction» exercée par son père, plutôt du genre aux abonnés absents, une mère plutôt malveillante et un frère qui la surveille en permanence quand il n’en abuse pas. Dans ce «climat de malheur» domestique, il ne lui reste guère que la force de son imagination (elle convoque ainsi des héros, à l’instar du capitaine Némo, «plus proche et plus compréhensible que les êtres qui l’entourent» – «elle croit au merveilleux. Il pénètre par toutes les portes closes») et la découverte des fantasmes et de son corps, comme en apesanteur, pour s’évader. Une recherche de plaisir mêlée de souffrance et de douleurs, ce qui participe, s’agissant d’une enfant ou d’une pré-adolescente, au sentiment de malaise que peut procurer la lecture de ce texte. Elle est sans cesse à la recherche d’un «complément réel» au vide oppressant («les bâillements de l’ennui») qui la menace. Une vie entenaillée entre l’attente et la peur que tout prenne fin.
Après le prof vénéré, après son ami Eckbert avec qui elle partage une écriture secrète, ce sera l’inconnu de la piscine, un maitre-nageur au regard magnétique.
A chaque fois, elle se trouve bien seule pour faire ses premières expériences, sans accompagnement aucun d’un adulte («C’est là son destin que de devoir, enfant encore, éprouver son premier amour. Elle n’est pas préparée le moins du monde et se retrouve sans défense»).
A la lecture de ce texte on pense à un autre récit, qui prend place durant les mêmes années, et qu’on a pu lire dernièrement, et également remarquable de justesse, celui de l’enfance de Colette Peignot, Histoire d’une petite fille, publié aux éditions de la Lanterne. Avec, et cela en devient plus que navrant dans l’aspect récurrent de la chose, certains invariants, comme la question des abus sexuels mais aussi ce besoin irrépressible de se sortir de l’enfermement familial, et avec pour butée la même fin tragique. Le tout resitué à la hauteur de la psyché d’une enfant à la recherche d’absolu.
Il conviendrait certainement de prolonger la lecture de ce roman d’apprentissage avec un livre que Perrine Le Querrec a consacré à Unica Zürn, prenant la forme d’une fausse biographie. Ça s’intitule Ruines et c’est publié aux éditions Tinbad. Les deux textes invitent s’il le fallait à en découvrir un peu plus sur cette spécialiste tourmentée de l’anagramme.
«Elle se plonge à toute force dans l’imagination pour pouvoir supporter la vie».
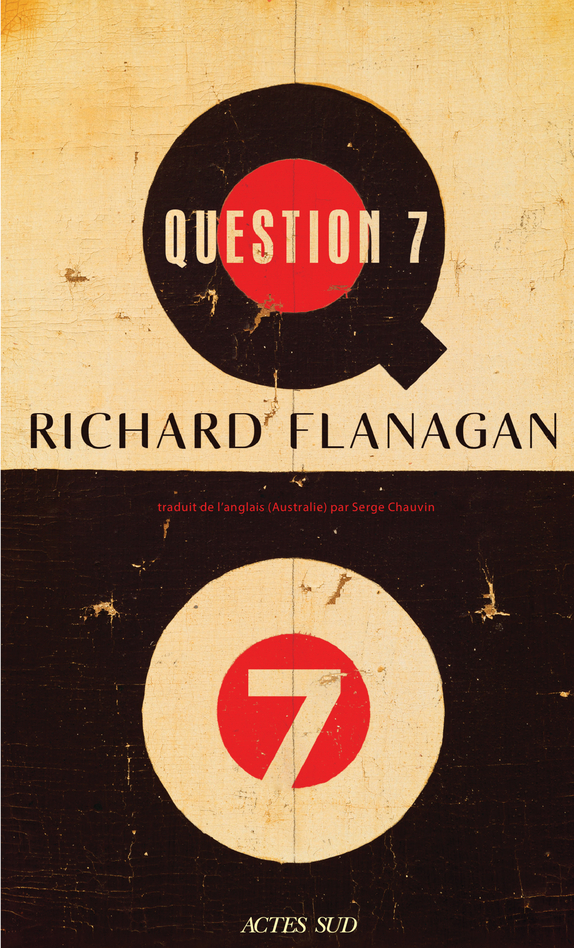
Question 7
De Richard Flanagan
traduit de l’anglais (Australie) par Serge Chauvin
Actes Sud
« Et je me rends compte en écrivant ces lignes que le souvenir est tout autant une création qu’un témoignage, et que l’un sans l’autre est comme un arbre sans son tronc, des ailes sans leur oiseau, un livre sans son histoire. »
Feuilleter ce livre donne le ton : des chapitres courts et ramassés, qui permettent de suivre le fil des pensées de l’auteur, entre éléments autobiographiques, grande histoire et pensées philosophiques, littérature et sciences. Alors bien sûr, cette œuvre n’est pas linéaire, elle suit parfois des méandres tortueux, il y a des sauts dans le temps et dans l’espace, mais c’est justement ce qui en fait sa richesse et son originalité. Richard Flanagan nous parle tout d’abord du camp de travaux forcés au Japon dans lequel son père serait certainement mort si la bombe atomique n’avait pas explosé à Hiroshima. Richard n’aurait par conséquent jamais vu le jour. Il tente de visiter ces mines d’Ohama, des décennies plus tard, mais les Japonais semblent plus ou moins frappés d’amnésie quant au traitement réservé aux prisonniers de guerre… Cela l’amène à évoquer le largage de la bombe, et surtout son origine. On apprend alors comment Leo Szilard a imaginé la possibilité d’une réaction en chaine permettant l’explosion d’une bombe atomique. Il s’avère que la lecture d’une œuvre d’H.G. Wells en particulier lui en aurait donné l’idée : La destruction libératrice. Or cette œuvre n’aurait sans doute pas vu le jour si Wells n’avait pas rencontré Rebecca West. Richard Flanagan réfléchit également à l’histoire de son île, la Tasmanie, à l’extermination des aborigènes par les bagnards anglais, aux barrages qui dénaturent et transforment les rivières. Il est aussi beaucoup question de l’amour qu’il porte à ses parents. Et de fil en aiguille, on rebondit d’une histoire à l’autre, elles s’enchevêtrent pour former un tout complexe et riche à la fois.
Dernièrement, pour évoquer la bombe atomique, il y a eu Tasmania de Paolo Giordano et Manhattan Project de Stefano Massini, ou encore Oppenheimer de Aaron Tucker. Avec ce récit, c’est encore une nouvelle façon de l’aborder.
Et le titre ? Là encore une autre histoire… Cette fois-ci avec Tchekhov… Mais à vous de découvrir.
« Ne sois pas un rampeur, mon fils, m’enjoignait ma mère lorsque j’étais enfant. Une terreur enfouie qui ne cessait d’affleurer. Autrement dit : ne cède pas, affirme-toi, sois toi-même. »
- All
- Gallery Item

Les étoiles se sont rapprochées
de Mylène Bouchard
Editions Mémoire d’Encrier
sortie le 4 octobre 2024
«il faut essayer nos rêves (…)
comme des enfants, tout ce qu’on imagine est
aussi tout ce qu’on peut être»
Mylène Bouchard, qui est la cofondatrice des éditions de La peuplade, petite maison d’éditions qu’on affectionne tout particulièrement du côté de l’Esperluette (La pêche au petit brochet, Les marins ne savent pas nager, ou encore plus dernièrement Amiante constituent autant de titres publiés par La Peuplade devenus pour nous comme autant de petits fétiches) nous propose de la poésie épistolaire.
Les étoiles, le vide, le lien, l’amour, la mort («l’amoureuse et la faucheuse»), la tristesse, le rêve, le temps, l’attente… Autant de grands thèmes à la charge poétique non démentie, qui émaillent le texte. L’expérience de la désillusion se diffracte tout au long du texte, «entre triomphe et désillusion s’éterniser beaucoup longtemps». Mylène Bouchard a recours à l’écriture comme pour exorciser le vide («un vide d’air intersidéral inexplicable insouciant qui lévite» ; «Je construis à partir de l’insupportable vide. Ecrire, c’est difficilement s’arrêter de fuir» ; «si je cessais d’écrire des livres définitivement, je me séparerais. Mais de quoi ? »). C’est cet inconnu qui traverse le livre («entre la fin de la fin et le début du début le juste milieu le déplacement»), à qui tout cela s’adresse ? Un peu beaucoup à soi, mais sinon ? L’interlocuteur, est-il «l’inconnu sans prénom», ou «l’euphorisant être aimé», à l’instar de «[s]es amoureux tous imaginaires», ou encore un ami inconnu ou une silhouette qui condense une somme d’inconnus ? Au lecteur peut-être aussi. Assurément même.
Mylène Bouchard se fait l’exploratrice avisée de la probabilité des amours, «une chance sur mille milliards», «les chances de se croiser sont nulles sauf la fois à la bibliothèque». Un arrière plan stellaire, une aspiration-inspiration cosmique semblent magnétiser l’écriture : un amour astronomique qui s’enquiert du déplacement des étoiles, de la force d’impact et de collision des météorites, de l’énigmatique de l’attraction : «rien n’égale le déplacement des chances qui vont l’une vers l’autre qui ne peuvent plus rompre l’une vers l’autre elles vont à leur propre rencontre et se racolent dangereusement». Et si l’étoile et l’humain se confondaient dans leur peur de disparaître ?
C’est que le trou, cher à Christophe Takos, menace. Le «trou de glace» dont il faut le hisser, dont il faut se hisser pour sortir vivant. A la recherche de «cette promesse de jours meilleurs, de petits pleins qui forment un tout heureux».
Et la réciprocité devient gageure : «qu’est-ce que tu veux pas dans ce que je veux?» ; «je lui montre la lune, il voit mon doigt».
Mylène Bouchard parvient, poésie faisant, à nous déculpabiliser quant à notre recherche d’absolu mais aussi, dans le même mouvement, quant à nos désillusions. Une écriture qui «aime par la pensée et pense du coeur».
La dernière page refermée, le texte résonne encore en nous. Longtemps. Beaucoup.
«les étoiles ne reviennent jamais en arrière
à la limite elles tournent le dos
inconditionnelles
elles tombent
du plafond
et
suspendent les pléiades sur ta joue»

Girlfriend on Mars
de Deborah Willis
traduit par Clément Baude
«Tout le monde est faible, et désespéré, et vulnérable».
Amber est une ancienne gymnaste, ancienne championne de saut de cheval, diplômée en santé nutritionnelle, son copain Kevin est vaguement scénariste, tient très partiellement des rôles de figurant, est surtout complètement désenchanté : «[s]on but, c’est le rien», variante de la résistance passive d’un Bartleby.
Tous les deux ans il la demande en mariage. Entre temps, vautrés sur leur canapé, ils s’attèlent à développer leur culture de cannabis comme pour oublier la menace rapprochée de l’effondrement écologique. Kevin est peu dans l’initiative et c’est peu dire : «Je n’ai pas eu à réfléchir à ma vie depuis ma rencontre avec Amber. Je n’ai même pas eu à réfléchir à notre vie, car c’était Amber qui avait des projets. Mon rôle consistait à nager derrière elle comme un petit chien, en essayant de ne pas couler».
Amber a finalement la possibilité de s’extraire de ce lieu confiné, elle démissionne de son boulot de réceptionniste pour participer à un concours de télé-réalité, «Mars Now» programme à la main d’un milliardaire spécialiste des technologies de demain, à l’issue duquel les deux gagnants doivent partir en mission sur Mars, voyage sans retour qui devrait permettre de rendre la planète habitable. L’occasion pour elle «de repartir de zéro, de renaître». Elle s’image Mars comme «un lieu au-delà du malheur».
L’ensemble des participants (les marsonautes) à ce show sont tous des archétypes de notre monde moderne, saturés de stéréotypes outranciers -parfaits ingrédients pour déplier une comédie humaine haute en couleur, et le storytelling savamment construit d’épisodes en épisodes empeste de sexisme en tout genre. Mais qu’importe l’audience est au rendez-vous, les followers sont là et à force d’épreuves truquées et de manipulation dans les montages (découverte du frankenbite ou quand un monteur d’image assemble des dialogues provenant de plusieurs sources ou interviews pour faire dire à quelqu’un quelque chose qu’il n’a pas réellement dit), le suspens est à son comble : Amber succombera-t-elle aux charmes de l’irrésistible Adam, un ancien militaire israélien ?
Deborah Willis a recours à un procédé narratif qui lui permet d’endosser tour à tour le point de vue d’Amber puis celui de Kevin (qui regarde Amber sur son écran), permettant de situer, en dépit de leur apparent amour indestructible, leurs écarts d’appréciation des situations vécues. Ou comment Amber et Kevin, prototypes d’antihéros, continuent à être à la dérive, séparément. L’autrice excelle dans l’art de camper ses personnages par petites touches et de les mettre en relation au moyen de dialogues percutants (pas très loin du ton des séries).
C’est bien l’ensemble qu’elle dépeint, des protagonistes de la téléréalité, aux professionnels des coulisses, qui se fait satire d’une société de la consommation, de l’hybris de notre société qui porte au nue des programmes télévisuels dont l’absurdité confine à la supercherie. Mais plus c’est gros, plus ça passe.
Même si le roman empreinte les codes de la dystopie, l’histoire se passe dans un futur qui nous paraît tellement peu éloigné que cela en devient troublant. Ou comment faire un bon usage du rire jaune.
Roman tout à la fois parfaitement inquiétant et tout à fait divertissant. D’un cynisme drôlement acidulé. Quand la réalité est trop fictionnelle, heureusement il y a les romans-téléréalité.
«Il faut que je bouge, que je remette ma vie sur les bons rails, mais le monde extérieur est trop réel»
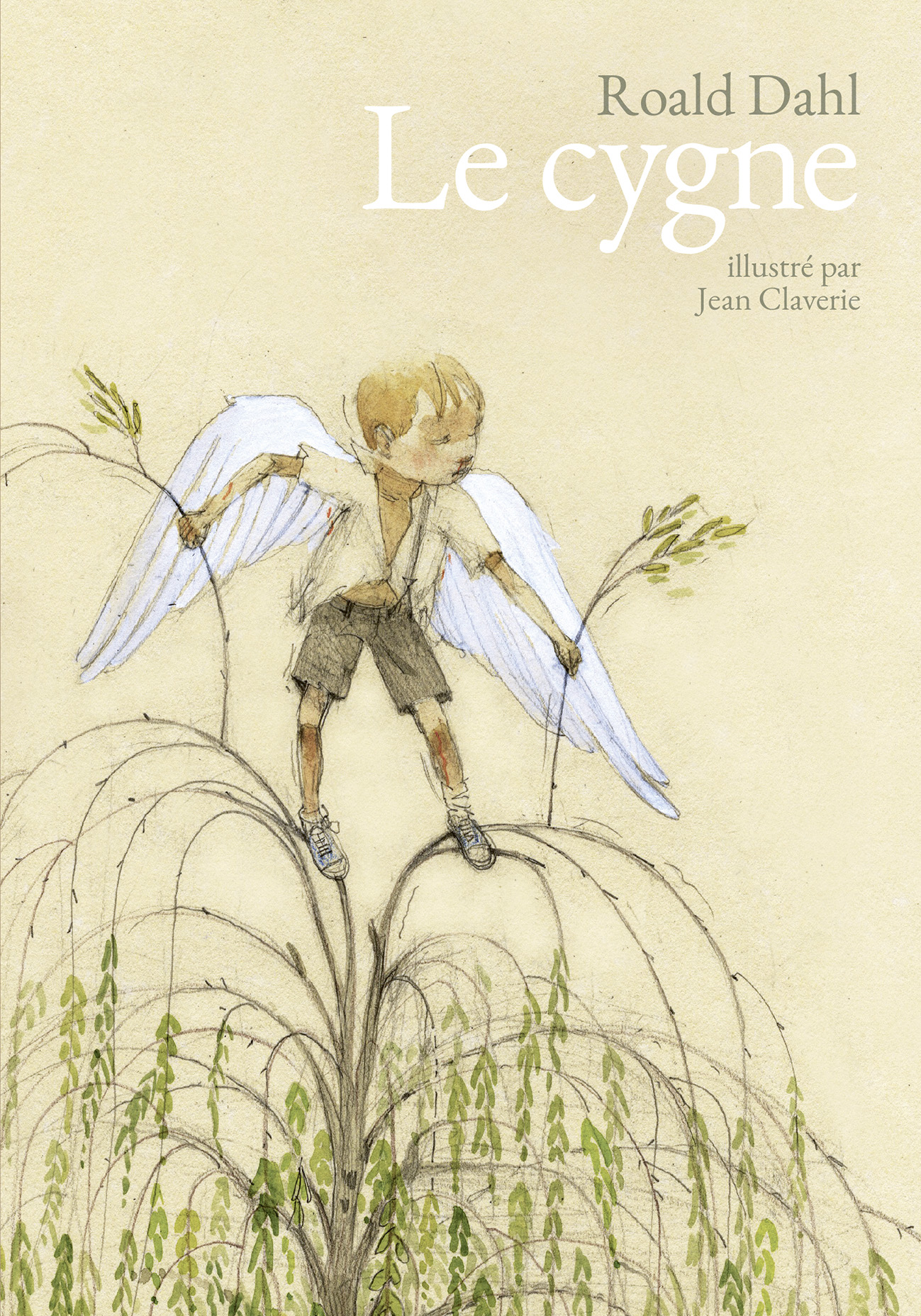
Le cygne
De Roald Dahl, traduit de l’anglais par Jean-François Ménard
illustré par Jean Claverie
Editions Gallimard Jeunesse
« Ces deux-là étaient des fous dangereux. Ils ne vivaient que dans l’instant, jamais ils n’envisageaient les conséquences de leurs actes. »
« Le cygne » est une nouvelle publiée pour la 1ère fois en anglais en 1977. Il faudra attendre 1986 pour que ce texte sorte en français, associé à un autre, « La merveilleuse histoire de Henry Sugar ». Aujourd’hui, Gallimard choisit de le publier seul, admirablement illustré par Jean Claverie.
Autant se le dire tout de suite, la couverture, assez douce et poétique, cache un texte très sombre et cruel. Il est donc déconseillé de le proposer à de jeunes lecteurs de moins d’une dizaine d’années, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’un lecteur adulte (ce texte deviendra alors un formidable support d’échanges sur le harcèlement et la masculinité toxique).
« Le cygne » est l’histoire d’Ernie et Raymond, de jeunes garçons qui aiment tout particulièrement montrer leur force et leur puissance, sans beaucoup de jugeotte, il faut bien l’avouer, et de Peter Watson, jeune garçon particulièrement intelligent et sensible. Comme Ernie a reçu une carabine pour son anniversaire, il décide d’aller à la chasse aux oiseaux avec son copain Raymond. En chemin ils rencontrent Peter justement en train d’observer des volatiles. « Ernie et Watson le détestaient car il était leur contraire presque en toute chose. » C’est alors que commence un enchainement d’intimidations et violences à l’encontre de l’apprenti-entomologiste. Les deux persécuteurs rivalisent de cruauté, face à un enfant tétanisé qui cherche pourtant chaque fois une voie de passage, un moyen d’échapper avec calme et sagesse aux supplices et au risque de mort.
Comme dans un conte, les personnages sont stéréotypés pour mieux amener le lecteur à réfléchir sur le sens de l’histoire. Et Jean Claverie vient avec justesse accentuer encore ces traits, ajoutant des détails aux mots déjà forts de Roald Dahl. On a ainsi le portrait sans ambiguïté d’un père machiste, violent et sans nuance. Le contraste entre la masse corpulente d’Ernie et Raymond et la silhouette frêle et apeurée de Peter est flagrant. Puis, lors des jeux macabres, on ne peut que craindre pour Peter ; l’étau se resserre et l’illustration le représentant attaché aux rails, avec le gros plan sur ses lunettes cassées, les yeux fermés, le nez rouge et les épaules rentrées donne froid dans le dos. Le pouvoir de l’empathie opère à coup sûr.
Un court roman dérangeant mais bien utile pour dire jusqu’où le harcèlement et la bêtise peuvent mener.
« Certains êtres, lorsqu’on leur fait subir trop d’épreuves, qu’on les oblige à dépasser les limites de leur résistance, s’effondrent et abandonnent. Il en est d’autres au contraire, quoique peu nombreux, qui, pour on ne sait quelles raisons, ne se laissent jamais vaincre. »
- All
- Gallery Item
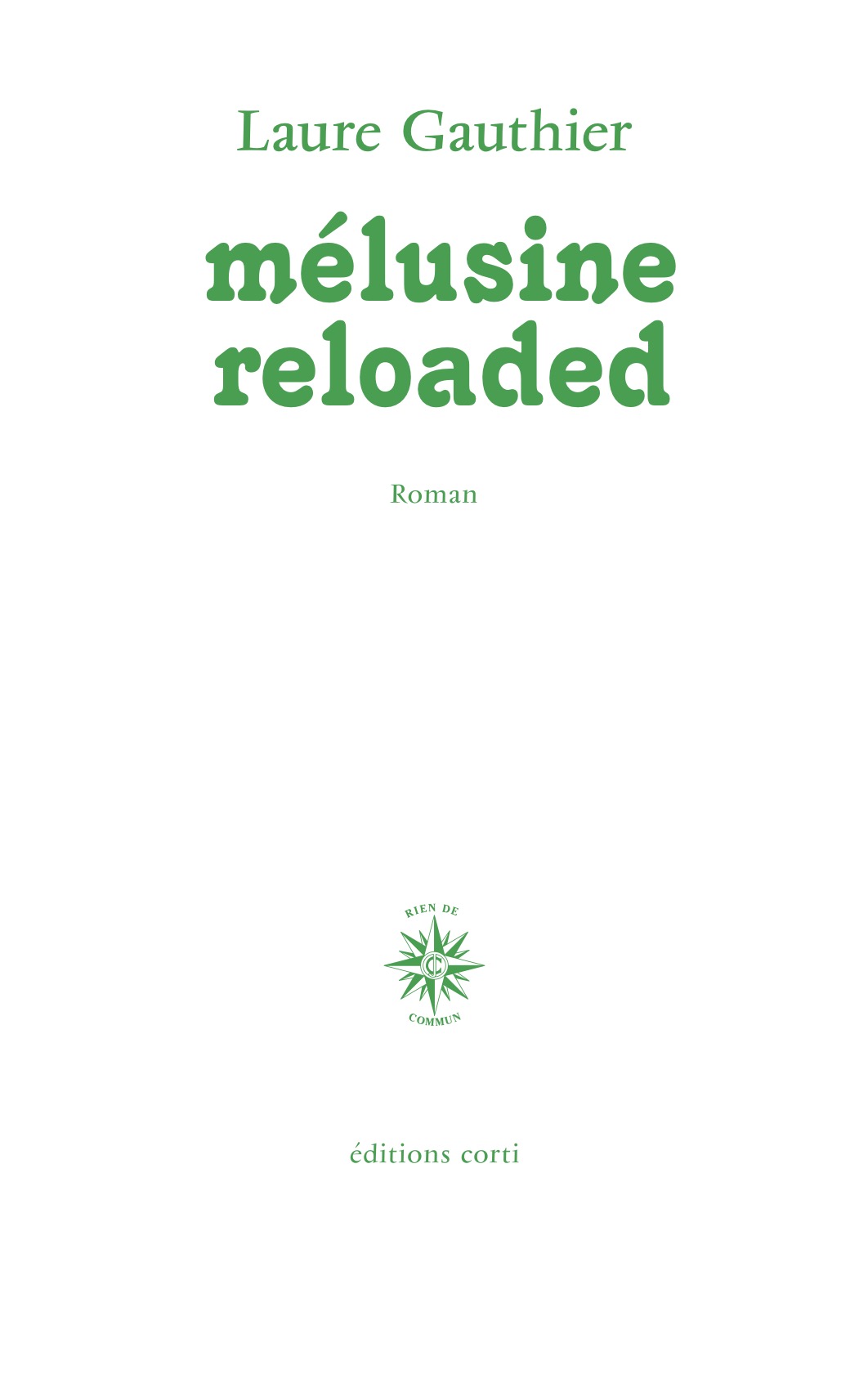
Mélusine reloaded
de Laure Gauthier
Editions Corti
«Le pays ressemblait à un petit enfant qui court de plus en plus vite pour ne pas tomber, un petit enfant qui ne cesse de photographier sa course en souriant mais dont les autres pressentent la chute douloureuse».
Laure Gauthier nous dresse la situation d’un monde post-démocratique aux prises à des désordres infinis, où les acronymes barbares ont pris le dessus sur la langue (TT, VOG, DSCO, ZHC, OPO, NOA …), où la dictature de l’image prime avec un recours massif aux selfies – «la population, absente à elle-même, en était arrivée à ne s’intéresser qu’à son reflet», où les gens conscients que leur situation est irrécupérable produisent des archives sur eux-mêmes, où la bande-son du monde dépérit, les cordes-vocales rétrécissent, où il n’y a plus que l’automne comme saison, où l’on ne peut exhiber de sourires tant les dentitions sont abimées.
C’est le décor au sein duquel vont se mouvoir Mélusine et Raymondin. Mélusine est un être-fée tout droit sortie d’une légende médiévale poitevine (fée dotée de pouvoirs magiques et caractérisée par son hybridation femme-serpent). Légende que Laure Gauthier prend un malin plaisir à dé-conter, pour mieux la recharger (reloaded), la réinventer. «Prendre le chemin de Mélusine, c’est accepter de marcher à marée basse sans objet, cheminer fragiles et équipés sans épopée».
Mélusine et Raymondin s’accordent sur une «union sans papier», et c’est ainsi que Mélusine, la réformatrice, se trouve à présider les affaires de Poitiers et sa région, «architecte des jonctions invisibles», elle conçoit d’autres urbanités, réinvente le paysage, répartit différemment le temps disponible (création, hors de chez soi, de lieu de solitude), invite à renoncer au trop plein d’objets, à ralentir, à se sevrer des selfies, à s’arracher au sentiment de perte.
Un langue ouvragée, qui joue, circule, tournoie «Tu penses à ce présent à venir qui aura été, votre présent passé à venir, en léger hors-champ du monde», qui questionne le sens des mots (à l’instar du passage sur la maternité). Une écriture à même les lisières, qui donne à entendre les fissures. Qui ne se contente pas de rester dans la satire d’une société de l’hyper consommation mais qui propose, sans jamais tirer vers l’essai, des portes de sortie face à cet effondrement, des scénarii alternatifs.
Dans le droit fil de Corinne Morel-Darleux et d’Alain Damasio pour ne citer qu’eux (l’autrice revendique aussi des affinités avec le travail de Lucie Taïeb), Laure Gauthier apporte sa contribution à la bataille des imaginaires, celle-là même qu’évoque Vincent Gerber dans un livre à paraître le 4 octobre et intitulé «L’imaginaire au pouvoir. Science-fiction politique et utopies» (éd. Le passager Clandestin). Son texte ne répond à aucun genre labellisé, et c’est tant mieux ; il alterne entre fiction dystopique, conte merveilleux et récit fantastique, registres qui s’hybrident avec brio comme pour mieux faire advenir une form(ul)e utopique, des lectures plurielles.
Un roman qu’on a envie de relire dès qu’on l’a refermé.
«Parfois, ils imaginaient quand même des fins fantaisistes au monde et riaient jusqu’au point de côté puis se séparaient».

Terres promises
de Bénédicte Dupré La Tour
Editions du panseur
«On ne peut bien aimer le monde que si on en saisit les nuances. Entre le mal et le bien, entre la lumière et l’obscurité, s’étendent toutes les tonalités de la vie. Aux extrémités, il n’y a que la mort, où tout finit par se rejoindre.»
Ce roman est le tissage finement mené de nouvelles et lettres, entre ruée vers l’or et colonisation du Monde Neuf. L’Amérique n’est jamais nommée et il ne s’agit peut-être pas de cette conquête-là. Peut-être cette nouvelle contrée est-elle purement imaginée par l’autrice. En tous cas, cela y ressemble fortement et notre imaginaire n’a de cesse de projeter des images de far west, même si par moment de menus détails nous font dire que cela ne se passe peut-être là où on le pense. Après tout, l’important n’est pas le lieu mais bien cette quête d’UN lieu qui serait LE lieu où s’installer pour vivre en paix et dans la prospérité. Mais il ne s’agit pas d’un conte, loin de là : ces terres promises amènent leur lot de douleurs et ce sont finalement beaucoup de déceptions qui impriment le vécu des occupants et des colonisateurs.
Chaque nouvelle porte le nom d’un personnage qu’on recroisera en filigrane dans d’autres nouvelles du roman, des correspondances s’établissent ainsi, formant une mosaïque vivante de ce nouveau monde et conférant à une dynamique narrative propre au roman choral.
Il y a des femmes (Eleanor Dwight, Kinta, Mary Framinger, Rebecca Strattman) toutes fortes, endurcies par une vie rude, devenues pour la plupart amères et cruelles. Si elles ont cru parfois choisir leur destinée, elles sont souvent victimes d’un monde patriarcal (même Kinta qui vit dans une tribu dirigée par des femmes doit avoir l’aval des anciens), mal ou pas aimées de ceux qu’elles désirent (un homme qui joue sa compagne aux cartes, un amant qui ne reste pas, un père qui refuse la main de sa fille à celui qu’elle désire, une mère possessive qui ne supporte pas que son fils la fuit). Souvent leur relation avec leurs enfants sont complexes et conflictuelles, les liens du sang n’empêchant pas le sang de couler.
Mais les hommes de ce roman (Elliot Burns, Morgan Bell, Bloody Horse-Wakisa, Nathaniel Mulligan) sont également malmenés, empêtrés dans un destin qu’ils n’ont pas choisi ou encore se rendant compte (trop) tard que leurs décisions ne les mènent pas vers la vie dont ils rêvaient.
Comme tout récit de conquête de «nouvelles» terres, c’est aussi un roman où la rencontre entre colons et natifs amène violence, recherche de domination, vengeance et fourvoiements. Sans nous donner la leçon (et c’est peut-être de par cette justesse de ton que l’intention opère), il ressort, au fil de ces histoires où s’enchâssent contingence et choix de vie, que les «terres n’appartiennent qu’à elles-mêmes» et que plutôt que de vouloir les posséder, il s’agit d’abord et avant tout de tenter de s’appartenir.
Un premier roman tout en maitrise : les procédés de mise en abime, les mécanismes de montée en tension et chute propres à chaque partie, l’insertion de six lettres comme ponctuation, tout concourt à l’économie d’ensemble du texte, ou comment exceller dans l’art de l’intrication.
«Hier rien, et le lendemain, ils affluaient comme des abeilles affolées par un rayon de miel tombé à terre. Ils bourdonnaient en un essaim toujours plus gros, s’activant à défigurer la terre, perforer l’immensité à coups de pioche.»
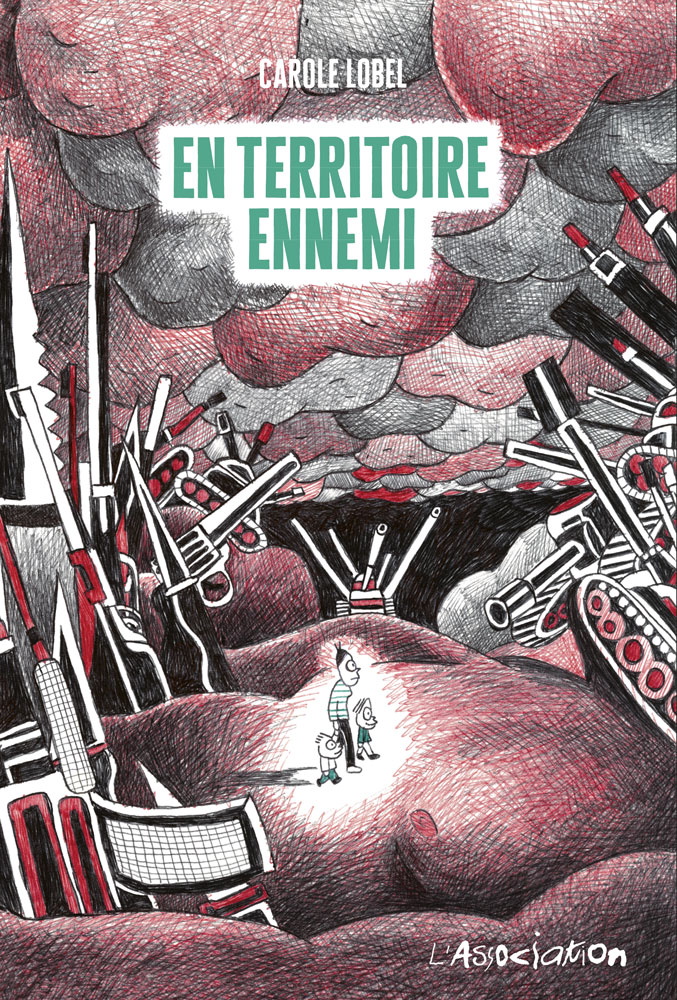
En territoire ennemi
de Carole Lobel
Editions L’Association
Bande dessinée
«Pourtant, il y a des signes, comme si, masqué par le volume sonore de l’orchestre un tout petit violon se trouve désaccordé.»
Ce n’est pas la parfaite entente entre la narratrice et ses parents, entre la violence de sa mère et l’indifférence de son père, elle trouve refuge dans ses études. Elle intègre les Beaux-Arts de Nantes et très vite se met en couple avec Stéphane. Mais très vite une relation d’emprise se dessine, il l’isole de ses autres relations, l’entraine dans une consommation débridée de cannabis, n’a que peu d’attention pour elle, est entièrement tourné vers la satisfaction de ses propres plaisirs. «Son esprit semble inamovible, rigidifié, comme un corps caverneux rempli d’un sang coagulé». Pis encore, il devient colérique, se pose en victime, malsain dans ses réflexions et son attitude. On pense au livre de Tiffany Tavernier, En vérité, Alice qui documente magnifiquement comment le processus d’emprise parvient à prospérer en dépit de la présence permanente de «red flag». Mais là les images sont en plus, des images en trichromie saisissantes, des images phalliques, bienvenue en «virilie».
C’est que Stéphane se fait de plus en plus poreux aux thèses complotistes et masculinistes dont il s’abreuve sur internet, ses obsessions s’immiscent partout («Avec le courage de l’homme d’extrême-droite qu’il est devenu, il impute ses échecs aux femmes, aux juifs, et aux étrangers»). Il la domine tant et plus, psychologiquement et physiquement. Des scènes de sexe, représentées métaphoriquement notamment au moyen d’une hache, sans consentement, légendées avec un glaçant «tchak tchak» qui en dit long, font froid dans le dos. La narratrice prend des douches avec «un maximum de chaleur» comme pour se provoquer des électrochocs.
Les effets de la domination et de la radicalisation se démultiplient après la naissance de leur premier enfant puis du second que Stéphane parvient à contaminer de son idéologie mortifère (les enfants prennent le parti du père, de celui qui les initie au jeu vidéo world of tanks, un des enfants arrêtera ses études pour rejoindre l’armée) faisant jusqu’à culpabiliser la narratrice vis-à-vis de ses enfants «Mais une petite voix vient refroidir mes ardeurs. Un garçon n’allais-je pas générer, d’une certaine façon, mon propre oppresseur ? (…) Et pèse sur moi l’insupportable fardeau d’avoir engendré l’ennemi».
Cette BD vous empoigne par sa justesse, Carole Lobel parvient à décomposer les mécanismes de la domination masculine et de l’endoctrinement aux théories de l’extrême-droite tels qu’ils agissent de manière très concrète au quotidien et sur l’entourage. Parce que beaucoup de scènes convoquent l’effroi et relèvent certainement pour l’autrice de l’ineffable, l’essentiel du propos passe par la grande force évocatrice des illustrations, tout est subtilement suggéré sans recourir à l’explicite.
Une BD dénonciatrice tout à fait réussie et qui se doit d’être partagée.
« Je regarde aussi autour de moi, et le constat est amer, le poison, diffusé sur les réseaux a fait effet, partout en Europe, l’extrême-droite prospère. »
- All
- Gallery Item

Gogoplata, tome 1
de Sophie Couderc
Editions Magnani
Bande dessinée
«Ce n’est pas un jeu, t’es pas en train de jouer avec tes copains, copines, là. Ecoute, c’est simple : tu n’as pas le choix»
De si longs cils, un regard perçant de détermination, les mains prêtes au combat rapproché. Cette intention combattive de Milonga Carbanche annonce la couleur. Sophie Couderc nous entraine dans un combat de lutte concrète, un art martial qui se rapproche du Jiujitsu brésilien. Son héroïne, Milonga, 24 ans, est participante à un tournoi décisif, le Gatoluco, qui va décider quel sera le gagant – Kampsò – qui accompagnera Tuva dans une expédition spatiale, très spéciale, pour aller chercher de l’aide auprès des «animaux latéraux», seuls êtres dotés de pouvoirs à même de venir à bout du Radoxa, champignon toxique invasif qui contamine l’eau de la terre.
Le tableau de la compétition défile, huitième, quart, demi, finale. Invariablement c’est Mil qui s’arrache, qui sait retourner et torpiller ses adversaires avec ses fameuses prises au sol. L’habileté dans le dessin de Sophie Couderc permet de rendre compte de la singularité des traits des visages, de décomposer les émotions tout autant que de décortiquer le mouvement, et l’on se prend à aimer ses mots techniques d’une grande force évocatrice, euphoniques, qui tiennent lieu de grammaire de ce sport de combat rapproché : butterfly sweep, baratoplata, kimura, et bien-sûr, le redouté gogoplata… Ne surtout pas s’inquiétez si l’on n’est pas spécialiste de l’art de la chute ou des clés de cheville et autres techniques d’évanouissement, les combats hypnotisent même les néophytes.
On le doit aussi à cette force superbe des couleurs, dont l’utilisation sous forme d’halo crée une atmosphère à nulle autre pareille. Une virtuosité de l’usage de la couleur comme ponctuation du narratif. Le saupoudrage de couleurs accompagnent délicieusement tous les affrontements, y compris ceux qui ne sont pas sur le ring, à commencer par les petites voix intérieures des protagonistes, leurs doutes, le dilemme moral auquel est aux prises Milonga : doit-elle utiliser ou non le prototype d’arme d’étourdissement conçu par sa mère pour la faire gagner la finale ?
Certaines planches, avec un vernis fantastique et un registre graphique d’apparence enfantine (pp. 7-9, 60-61) ne sont pas loin de nous faire penser à l’univers de Nina Lechartier (Un soir de fête publié également chez Magnani, tiens, tiens…). La présence de petits gnomes prolonge ce sentiment, créatures que Sophie Couderc aime tant dessiner, et qui viennent à point nommer accompagner le chapitrage du récit.
Des choix esthétiques audacieux qui fonctionnent vraiment et l’on attend déjà impatiemment les deux prochains tomes.
Une BD de science-fiction, inspirée de l’univers des manga, au style graphique très inventif. Absolument captivant !
«Gogoplata : technique d’étranglement qui consiste à compresser la tranchée de l’adversaire avec son tibia pour couper l’arrivée d’air. « Gogo » désigne la pomme d’adam en brésilien».

Si les forêts nous quittent
de Francesco Micieli, traduit de l’allemand par Christian Viredaz
Editions Hélice Hélas
«Si les forêts nous quittent, a-t-elle dit,
Alors nous sommes perdus.
Jamais nous n’avions pensé que les forêts pourraient nous quitter.»
L’objet livre est aussi soigné que le texte qu’il contient. La couverture, trouée, nous laisse entrevoir des feuillages – ce qu’il reste de la forêt ? ce qu’on aperçoit de la canopée, lorsqu’on se balade en forêt, les yeux en l’air ? Ce qui est sûr, c’est que cette végétation jaunit par endroit, aurait-elle pris chaud ?
Ce court roman polyphonique inspiré d’ateliers menés avec de jeunes réfugiés et étudiants du Tessin, mais aussi du passé de l’auteur, Francesco Micieli, et du groupe «Les Libellules» auquel il a appartenu, se constitue d’une suite de textes – entre témoignages et poèmes, donnant voix aux membres d’un groupe, le Manifeste du Watter. La nature qui les entoure est déchainée, «C’était l’été des incendies et des orages. Nous étions angoissés. Le monde semblait à l’agonie. Canicule et inondations.»
Chacun est amené à parler de Gingko, cette jeune femme venue de nulle part, apparue au cours d’un été («elle était tombée d’un coup dans notre vie»), et disparue peu de temps après. Il y a Saïd, Bounine, Marcel, Alfi, Isma, Selina, Anina, Esther, Sara, Esma, Daria, Mati. Il pourrait s’agir d’interrogatoires menés pour comprendre la disparition de la jeune femme et tenter de la retrouver, mais la forme renvoie plutôt à des récits personnels, sur leur relation à cette femme et à la nature, entre souvenir «qui n’a tout simplement pas pu mûrir» et rêve éveillé. La forêt en danger, en feu, est bel et bien là. Mais elle est aussi autre («La forêt n’était pas une vraie forêt. La forêt, c’était ma petite vie. La routine quotidienne» indique Anina).
Ces jeunes gens l’ont rencontrée à la terrasse d’un café. Et puis, il y a cette idée de voyage et d’action pour la planète. Tous montent dans le bus de Saïd : «Allons libérer les gens, doit avoir lancé comme ça Marcel dans la nuée de mots.» Nous ne saurons pas grand-chose de cette action, pourtant elle semble importante pour tous les membres du groupe. Tout autant que rester ensemble, avec Gingko. Alors sa disparition déstabilise, inquiète, laisse un vide bien sûr, et n’est pas tout à fait réelle pour certains («Pour moi, Gingko n’a jamais disparu. Elle est là, simplement nous ne la voyons pas.» confie Alfi).
Des vers tirés de poèmes de Federico Garcia Lorca («les enfants mangent pain bis et lune exquise»), de Virginia Woolf («les lumières du monde sont éteintes. Là se tient l’arbre devant lequel je ne peux pas passer.»), des extraits d’Engel, Nick Drake, D. H. Lawrence et bien d’autres, viennent ponctuer, ajouter matière aux paroles des jeunes interrogés.
En refermant le livre, nous pourrions presque nous demander si nous n’avons pas nous-même rencontré, rêvé Gingko. Elle et ses comparses flotteront, c’est sûr encore un long moment dans nos souvenirs.
Avec ce texte polymorphe, nous sommes clairement dans le sensible. Sa forme se prêterait tout à fait à une adaptation théatrale.
«Cet été-là, nous croyions tous ce qu’elle disait.
Elle avait la voix juste, l’expression juste.»

Les hommes manquent de courage
de Mathieu Palain
Editions L’Iconoclaste
«J’ai pensé à la fuite qui est la pire des options et au passé qui ne passe pas, qui nous rattrape, qui remonte depuis les abysses pour éclater en surface».
Basé sur le parcours de vie d’une femme qui décide de contacter l’auteur via Facebook, «les hommes manquent de courage» est construit comme un Road movie en région parisienne. Récit au phrasé précis et au rythme haletant, il met en scène la relation orageuse entre deux êtres malheureux qui se cherchent en s’évitant. Jessie, prof de maths abonnée aux connards mais qui ne manque pas, elle, de courage et son fils Marco, ado en roue libre pour qui le shit ne calme ni la déprime ni la colère. Leur histoire commune bascule à la suite de la révélation d’un viol. Lors d’une soirée vraiment spéciale, les trop lourds non-dits sur les héritages familiaux et les violences masculines volent en éclats.
Avec ce troisième roman, Mathieu Palain, qui s’est fait connaître pour ses papiers dans Libération et ses portraits dans la revue XXI, continue de s’imposer comme la voix d’un écrivain du réel qui compte.
YE
«C’est une nuit qui remonte à la surface. Je l’enfouis sous des couches de souvenirs, mais elle remonte, elle se fraye un chemin, elle me surprend devant les élèves, en salle des profs, à table au milieu d’une phrase avec des amis, le soir en prenant ma douche, le matin, au réveil, assise au bord du lit».
- All
- Gallery Item

Permettez-moi de palpiter
de Pauline Picot
Editions Vroum
poésie
«Et embrasser avec tout mon corps,
tout mon cœur
Avec tout ce qu’il y a d’âme en moi
La responsabilité de la joie».
Quel bonheur que de découvrir ce premier recueil de poésie de Pauline Picot publié aux éditions Vroum.
Les pages de gauche sont conçues comme un flipbook-qui-ne-serait-pas-muet où l’on peut faire défiler les pages. Tout en étoilement, d’une petite silhouette singulière à une forme de voie lactée, de l’intime au plus grand, de soi aux météorites, le corps se diffractant dans l’univers («huit mille combinaisons de nos corps»). Une poésie sensible, tout en originalité se décline sur les pages de droite.
C’est très satisfaisant que de manipuler ce petit objet ouvragé graphiquement avec talent par Vincent Menu. En amont de toute lecture, ou bien pendant ou bien après, on peut ainsi s’amuser à faire défiler la silhouette de Pauline Picot dans cette posture arc-boutée vers ce qui nous dépasse, de donner corps à l’autrice. Cette continuité de la page gauche et de la page de droite viennent traduire en acte en quoi ce qui fait corps peut être poreux à la poésie.
50 fragments pour dire, parfois de façon amusée, parfois de façon troublée, l’ «imparfait» du monde tel «qu'[il] passe à travers [son] corps». 50 façons de déplier ces petits et grands étonnements, de «déverser sa solitude», de traduire sa générosité («je veux vous rassasier et toi et l’univers») en geste poétique, qui fait «trembler le ventre» et «déborder le cœur». L’autrice empoigne les formes de cynisme qui se multiplient, face à la guerre, face au flot d’information continue, comme pour les faire valdinguer, comme pour mieux rappeler «le violent coup du hasard» que c’est de vivre dans un «confort total». Pauline Picot se moque de l’approche quantophrénique de nos vies, de leur moyennisation, autant de subterfuges ou de sophistications trouvées pour mettre la souffrance à distance.
Et que dire de tout ce temps perdu à devoir se justifier, prouver, quémander («tous les jours du mois de septembre»), ça vise dans le mille et on applaudit. La comédie humaine en prend un coup, à commencer dans les rames de métro, et le prix à payer est affiché.
Comme une attention au temps présent, une invitation à s’affranchir de toute tentative d’invisibilisation de l’autre, pour redonner plus de place à la reconnaissance («personne ne te nomme») et la consolation : «Chaque personne ici-bas a le droit fondamental qu’on refasse les lacets de son âme, lui essuie le coin de la vie et lui mouche le coeur». Et l’urgence à le faire («Ainsi fond fond fond, mon enfant tant attendu, qu’en 2024 on ne peut plus, l’accueillir dans sa maison, car la maison a fondu»). Comme un miroir à nos impuissances.
Pauline Picot nous saisit à l’âme avec ce recueil qui n’en finit pas, lecture après relecture, à venir entretenir la flamme sur la marmite des possibles. Avec ce recueil, la «combustion poétique» opère résolument. Et l’on se réjouit de recevoir Pauline Picot le 17 octobre prochain. Sortez vos émotions et venez donc palpiter avec elle.
«Quand il n’y a plus
Moyen de comprendre
Ce qui cauchemarde
Dans le réel
Il faut se coucher
Avec les animaux
Et dans leur masse respirante
Se faire pardonner»
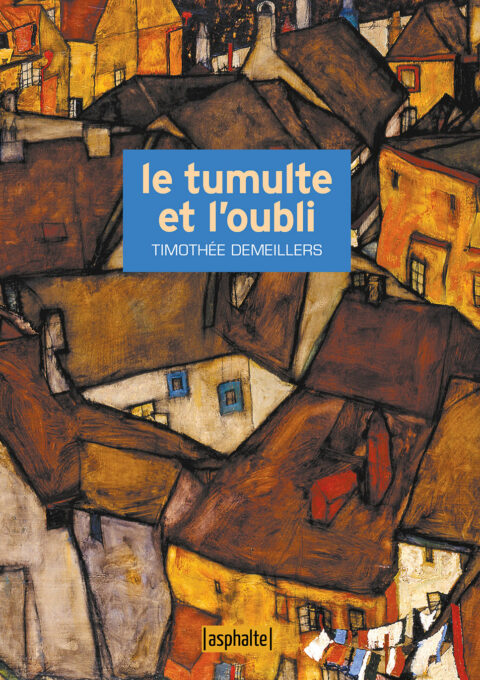
Le tumulte et l'oubli
de Timothée Demeillers
Editions Asphalte
roman
«Un monde nouveau était à construire, une nouvelle nation débarrassée du poids de l’oppresseur, une idéologie nouvelle à répandre, un monde de projets à faire fleurir sur une terre vierge, mais il flottait tout de même dans la vapeur de la griserie des hommes en armes, ce soir noir et glacial du 24 décembre 1945, un étrange sentiment, comme un petit pincement au cœur, une pointe de nostalgie.»
Timothée Demeillers imagine une petite ville, Tannberg pour les Allemands – Jedlov pour les Tchèques, qu’il situe dans les Sudètes, et nous narre sur un peu plus de 500 pages sa vie tumultueuse de 1938, alors qu’elle est annexée par Hitler, à nos jours. Car, oui, Tannberg/Jedlov est bel et bien un des personnages principaux, si ce n’est le principal, de cette grande fresque historique et littéraire. Elle tente tant bien que mal de survivre, de réunir ses habitants mais souvent, malgré elle, les sépare. Ell résiste pour survivre en paix, se voit éventrée, malmenée, transformée par le passage des nazis, puis des Russes, du communisme et du capitalisme effréné. C’est aussi un lieu de métissages et de ségrégations : Allemands, Tchèques et Tsiganes s’y croisent, se côtoient, souvent non sans mal. Et pour mieux nous faire part des horreurs mais aussi élans d’espoir qui traversent cette ville, l’auteur choisit quelques vies significatives et symboliques qu’il déploie et tisse avec finesse. Il y a Sieglinde, l’Allemande, qui a 9 ans lorsqu’Hitler prononce son discours glaçant justifiant l’annexion des Sudètes (c’est d’ailleurs par ces mots que débute le livre). Ses parents souhaitent cette annexion et détestent les Tchèques. Pourtant Sieglinde tombe amoureuse d’un Tchèque, Mirko… Il y a aussi Ivetka, jeune Tsigane de 14 ans lorsqu’elle se marie, quitte son petit village pour Jedlov. Fervente communiste, elle est aussi la 1ère femme tsigane à suivre des études. Fière, libre, le regard affuté. Et puis, les amis de Mirko, tchèques, avec qui il a un groupe de musique. La fin de la guerre les sépare, faut-il suivre les Russes ? soutenir une Tchécoslovaquie libre ? Simplement tenter de vivre ?
Si le début de ce roman s’attache surtout aux tensions entre Allemands et Tchèques, la question des Tsiganes prend peu à peu de plus en plus de place, devient un enjeu dans cette ville. D’autres Tsiganes apparaissent alors : Toni Gabor, Michal Tulej, Tereza, Milan.
La violence, les oppressions (envers les Tchèques puis les Allemands, et quelle que soit l’époque envers les Tsiganes), la misère, la drogue traversent ce roman rude où l’espoir émerge à peine, subrepticement. Rien n’y fait, l’histoire semble bégayer, les hommes répétant les mêmes erreurs, dans leur incapacité à s’apaiser et cohabiter. Un roman ambitieux qui en inventant une ville symptomatique des tensions à l’œuvre arrive avec brio à embrasser la grande Histoire sans piétiner les petites.
« Il n’y a pas de nuit qui ne soit suivie de jour mais aussi de jour qui ne soit suivi de nuit. »
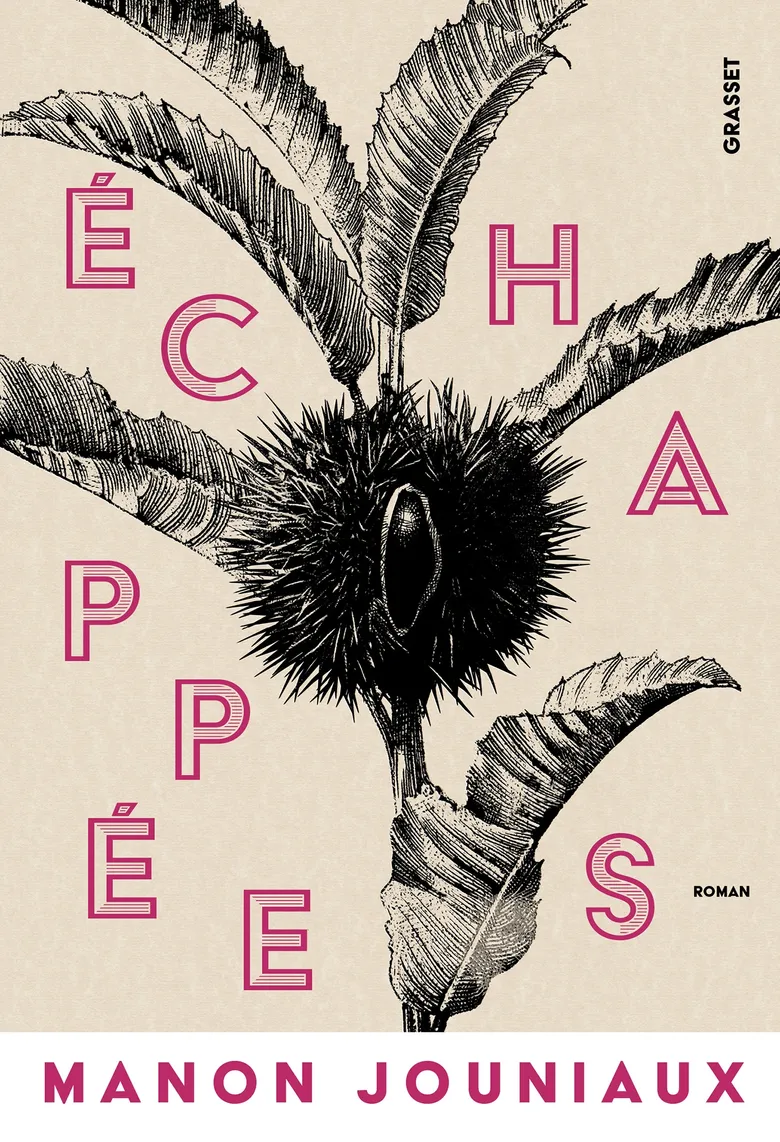
Echappées
de Manon Jouniaux
Editions Grasset
roman
«Ce qui fait de nous ce que nous sommes, c’est ce qui est planqué derrière ces foutues grilles».
Manon Jouniaux nous entraine dans une châtaigneraie isolée de tout, dissimulée au coeur d’une île. On y retrouve 7 femmes, leurs enfants, «une myriade infantile et braillante», leurs démons et leur passé. Les «mères murailles» qui vivent ensemble dans ce qui s’apparente tantôt à un refuge, tantôt à une prison («un paradis sarcophage»), sous l’aile de la matriarche Anita, véritable mémoire des lieux. Entre le phalanstère et la gynécée, on comprend rapidement que toutes ont fui la violence, les pères sont absents, une absence qui en dit long. Ces femmes qui semblent collées au lieu («à force on ne sait plus si ce sont les femmes qui portent sur elles l’odeur de la châtaigneraie ou bien si c’est elle, la maison, qui est saturée de leurs parfums») constituent un collectif protecteur des enfants, lesquels ne cessent d’agripper «les cous sucrés des mères» – chorégraphie des corps qui se tiennent, s’enveloppent et se supportent. Un entrelacs féminin avec un fonctionnement quasi de meute.
Les journées se suivent et se ressemblent, partagées entre taches domestiques, activités liées à la culture de la châtaigne, et confidences. La convivialité jamais en reste, autour d’une pulenda, d’un peu d’ivresse avec un calme toujours provisoire. «Elles ont l’ordre en horreur, le chaos est toujours prêt à éclater, ici, dans leur maison fébrile, remplie à ras bord de tous ces corps électrisés, entre crises de larmes et gorges déployées c’est le choix du vacarme, la survie euphorique».
Un «royaume de femmes», une «troupe d’amazones» traversée par son lot de non-dits, challengée par les enfants qui grandissent : mais qu’en était-il de la châtaigneraie avant ? Qu’est-ce qui justifie leur présence ici ? Jusqu’à quand la communauté peut-elle contenir et taire les violences subies ? Et que recèle cette clairière, derrière les grilles, aux abords de la propriété ? L’Enfant et Nour réclament des éléments d’explication auprès de leurs mères, auprès du groupe.
L’autrice zoome à partir du présent de la châtaigneraie sur l’indicible, la fabrique de la violence masculine qui s’est exercée à l’encontre de Sophie et de l’Enfant, de Cléo et Zéphyr, de Miriam et Nour, ce qui en ont fait des «guerrières vengeresses». Le passé reflue et avec lui le fragile et le drame à portée de destin.
Dans l’embrasure de l’écriture de Manon Jouniaux affleure des éléments un brin merveilleux, comme pour nous sortir du «trop de réalité» cher à Annie Lebrun, comme pour exorciser toutes ces souffrances qui s’additionnent. Avec ces bordées d’onirique, elle joue à la perfection avec ce qui caractérise les éléments protecteurs du dedans et l’agression, fascination-répulsion du dehors, et ces va-et-vient, entreprise métaphorique et elliptique qu’avait admirablement bien menée Corinne Morel-Darleux dans La Sauvagière. Avec ce même sentiment qui prédomine, que ce soit pour les protagonistes de l’histoire, proche de ce que Donna Haraway nomme «vivre avec le trouble».
Un magnifique premier roman.
« Aux enfants, on ne dit rien, mais ils savent tout. »
